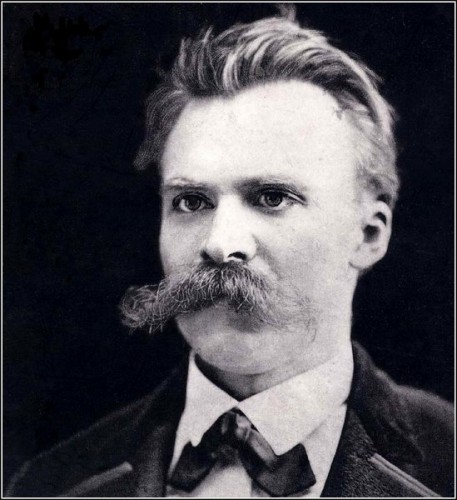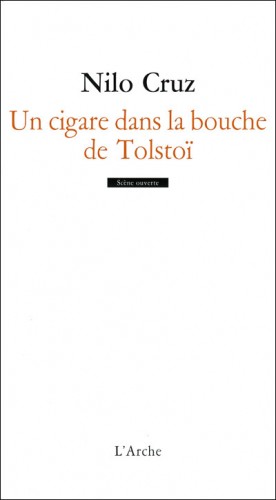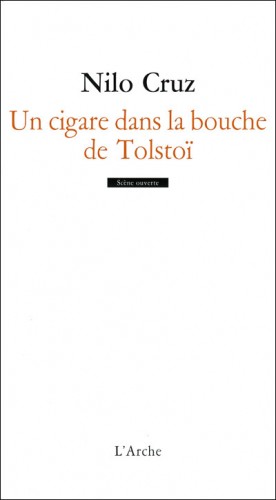
(Article initialement publié sur le Ring : ICI.)
Pascal Adam : Autant être pour une fois positif et dire d’emblée : Un cigare dans la bouche de Tolstoï est une bonne pièce [1]. Enfin, c’est plutôt une bonne pièce. Pour être tout à fait honnête, je dirais que c’est hélas une bonne pièce, non sans ajouter que, peut-être, c’est le marasme de rien moins que presque tout le reste qui me contraint à trouver cette pièce bonne – ce qui, tout de même, n’est pas si mal ; disons que c’est une question : je me demande si je ne trouve pas cette pièce intéressante que par défaut.
La personne – elle ne signe pas – qui, aux éditions de L’Arche, a écrit la présentation du livre, bien involontairement sans doute, me donne, mais en creux, la raison pour laquelle cette pièce, hélas donc, me paraît bonne :
« Il y a donc chez Nilo Cruz un sens de l’élégance et de la cohérence qui est presque à l’opposé de la fragmentation caractérisant la structure de nos autres pièces occidentales. Question de culture. Comme de lecture. »
Tout est là, donc. Je veux bien que l’élégance puisse n’être pas primordiale à la réussite d’une œuvre dramatique ; et admettre qu’elle peut être superfétatoire – en quoi il me semble, au vu du glorieux passé de la littérature dramatique française, faire une concession rien moins qu’énorme. Mais qu’à cette absence d’élégance se joigne une incohérence avouée, mieux : revendiquée – quoique dissimulée ici sous l’ « euphémisant » terme de fragmentation et mal compensée par l’impropre emploi de celui de structure – donne une idée assez juste de l’innommable cochonnerie [2] européenne dans laquelle s’ébrouent ici des centaines, des milliers de cochons dramaturgiques réclamant à grands gueulements leur glandée.
Mais je demeure positif et ne chicanerai point à Nilo Cruz l’élégance ni la cohérence. C’est certainement, oui, une question de culture ; d’ailleurs, la pièce est très lisible. Très loin au-dessus des productions de « textes de théâtre » made in Europa, la pièce s’élève pour ainsi dire jusqu’au niveau d’un très passable roman.
Aurélien Lemant : Ladite présentation ne tient d’ailleurs pas compte un seul instant de l’Histoire de cet autre théâtre occidental, le nôtre, donc. Comme s’il n’avait jamais existé avant, mettons les années 60. Tu parles de la littérature dramatique française, mais où sont passés Marlowe et Schiller, par exemple ? Réponse : on lit aujourd’hui – à supposer qu’on lise encore du théâtre, en général, on va plutôt le voir – des auteurs (tu dis des cochons, d’accord) qui ne resteront pas, qui ne laisseront rien. L’important est de comprendre qu’il n’y a plus vraiment d’auteurs, ou que tout le monde en est devenu un ; de comprendre que l’on n’écrit plus pour être lu mais pour la scène. N’était le fait qu’écrire pour la scène, quand on écrit du théâtre, c’est la moindre des choses. La moindre en effet. Car si je sais, avec Molière, tiens, que le théâtre est fait pour être vu, je dis qu’il n’y a pas grand chose à penser d’un théâtre qui ne serait pas un peu écrit pour le lecteur, ou dont le lecteur ne serait qu’un artiste ou un technicien du spectacle. Le texte théâtral devient-il un accessoire, un prétexte à faire une mise en scène, un support et baste ? Tu me disais toi-même il y a peu qu’on n’écrit plus de critique des textes de théâtre, en France – effectivement, seuls les spectacles sont aujourd'hui chroniqués par la presse. Et regarde, Libération vient de supprimer sa page théâtre. Ce n’est pas une crise. C’est un aboutissement.
PA : Je suis bien d'accord. Corneille, Marlowe, Schiller ont été passés par la fenêtre, comme presque tout ce qui est d'avant 1960 (sauf Dada et ses affidés). Et tout doit devenir éphémère, au premier chef les textes, afin que rien ne soit conservé - et d'un certain point de vue, il faut bien admettre que c'est justice. Par « cochons », je n'entendais pas seulement les auteurs, mais avant tout les metteurs, puisqu'ils détiennent le pouvoir économique et fabriquent objectivement ce post-théâtre-là , souvent en passant des commandes. Ce qui, bien sûr, n’exonère les auteurs ni de leur médiocrité ni de leur servilité. (Il n’y a aucune raison de « défendre les auteurs dramatiques contemporains », en général ; la seule raison de défendre un auteur, c’est d’aimer ce qu’il écrit.)
Le post-théâtre, le show, dans lequel l'Europe est entrée ne peut plus se permettre la formule américaine - de facture juridique romaine autant que biblique, finalement - : Your word is law. Il faut voir comme ici l'obligation faite aux metteurs en scène par Beckett puis ses ayant-droits de respecter les didascalies est devenue incompréhensible. C'est une chose qui n'est plus qu'anglo-saxonne. On sent, pour revenir à nos moutons, que c'est cette conception-là qui régit encore le théâtre américain dans lequel Cruz s'inscrit.
AL : En France, on met un point d’honneur à ôter les didascalies. Horovitz écrit cette indication, en exergue à l’un de ses textes dramatiques : « Jouez la vérité, vous en serez récompensés. » Pour les européens, les didascalies, et partant les indications, ne font pas partie de la vérité ! Beckett a voulu se prémunir. Tu dis d’Un cigare dans la bouche de Tolstoï qu’elle s’élève au niveau d’un roman. C’est vrai, et j’y reviendrai, mais tiens-tu le genre romanesque pour supérieur par définition, ou bien est-ce encore une fois par seule comparaison avec le marasme ?
PA : De toute façon, comme le laisse entendre la présentation du livre de Nilo Cruz, ici, les choses n’ont plus guère de sens. Si l’on peut faire entrer en scène Andromaque à poil et pendue à un croc de boucher, mettre un point d’honneur à dire correctement le texte de Racine n’est qu’une aberration de plus. Ce qui est réellement étonnant, en fait, ce n’est pas que les metteurs en scène aient fait sauter les didascalies, c’est qu’ils aient conservé les dialogues ! Mais ça y est, ils ont enfin commencé de se débarrasser de ce pesant et bien trop contraignant archaïsme-là et ils pourront bientôt faire tout le n’importe quoi qu’ils « délirent ». Ils seront enfin de purs « créateurs » dégagés de tout souci d’interprétation, comme d’ailleurs de tout souci de connaissance historique. (D’où la juste disparition de la page théâtre de nos camarades libérationnants.) Ces anticonformistes de ministère auront juste besoin de scénarios de spectacles, c’est-à-dire des textes les moins écrits possibles, aux répliques de plus en plus brèves pour être sur- ou sous-titrées sans perte, ce qui va développer une langue standard d’une pauvreté à pleurer, c’est-à-dire exactement la langue de communication globalisée impérativement nécessaire à ce monde qu’ils prétendent critiquer, attaquer, rejeter, vomir, vilipender, vouer aux gémonies… Et c’est très drôle, au fond, parce qu’ils sont morts (et comme j’ai décidé ce jour de ne pas dire du mal des morts, je n’en nommerai aucun !).
Quant au roman, il n’est bien sûr pas, en tant que genre, supérieur ou inférieur au théâtre, et si le roman de notre époque est assez misérable, c’est encore dire quelque chose du théâtre de noter qu’une bonne pièce aujourd’hui peut se lire comme un roman très passable ! Dire que la pièce de Nilo Cruz peut se lire comme un roman, c’est dire aussi qu’elle renoue – du moins pour nous, lecteurs européens – avec toute cette tradition d’un théâtre soumis à des règles éprouvées d’écriture dramatique grâce auxquelles un auteur sait que ce qu’il écrit, c’est une représentation.
Un cigare dans la bouche de Tolstoï s’ouvre d’ailleurs sur une didascalie très belle, aux antipodes de l’esthétique de nos « scènes », défendant en quelque sorte la décence et la dignité des personnages : « Note aux costumiers : ces ouvriers étaient toujours bien habillés. Ils portaient beaucoup de lin blanc et beige, et leurs vêtements étaient toujours amidonnés et repassés. » 
AL : L’exact opposé de nos acteurs en noir et gris, couleur bureaucratie pour la version française (Patrice Chéreau, Jean-Pierre Vincent…), ou t-shirts fluo et pantalons rouges pour la version allemande (Thomas Ostermeier…) [3]. Tu remarqueras que je ne dis aucun mal des morts, je regarde et je constate. A leur décharge, il est vrai que le théâtre de Shakespeare ou de Musset ne livre pas de notes aux costumiers.
Blague à part, le texte de Cruz offre à ses personnages une élégance qui ne s’en tient heureusement pas qu’à la tenue vestimentaire. Les dialogues, puisqu’il s’agit de cela. De la poésie, souvent. De la littérature, quelques fois. Les protagonistes sont tous issus d’un milieu populaire – les ouvriers dont il est question dans la didascalie que tu cites travaillent dans une fabrique de cigares qui sera le principal lieu de l’action. Lorsqu’il leur a distribué leur partition, Nilo Cruz ne s’est pour autant pas complu dans la vulgarité qui est de mise quand on dépeint aujourd’hui des prolétaires au théâtre. Voici donc une pièce qui ne se soucie guère de quotidienneté et de réalisme social dans ses dialogues, privilégiant l’hypothèse selon laquelle les acteurs l’insuffleront de toute façon.
A cet égard, la scène cruciale que j’appelle scène du cigare, faite de descriptions des fumées et arômes d’un havane que chacun se transmet rituellement, vaut bien certaines analyses picturales, et toutes les publicités du monde, puisque c’est à qui parlera le mieux de ce petit objet de consomption : un cigare « au fond de cerise », « doux comme une mangue », qui « brûle comme un rêve bleu », « parle des forêts et des orchidées » et « soupire comme un coucher de soleil ».
PA : Voilà une manière de parler et faire parler des ouvriers qui, en effet, pour détoner avec la représentation admise des ouvriers, et spécialement des ouvriers américains, n’en est pas moins réaliste. C’est que la pièce se passe en 1929, en Floride, dans une fabrique artisanale et familiale de cigares peuplée de Cubains émigrés aux Etats-Unis. Or, la tradition, importée de l’île, c’est que, tandis que les ouvriers, pour la plupart analphabètes, travaillent, un lecteur, c’est-à-dire un homme exclusivement employé à cela, leur lit à voix haute, dans le cours des semaines ou des mois, quelques-uns des chefs d’œuvre de la littérature mondiale. Ce que raconte la pièce, en somme, est l’arrivée d’un nouveau lecteur, Juan Julian, et ce que provoquent sur les couples travaillant là et sa personne et la lecture qu’il fait à voix haute d’Anna Karénine, de Tolstoï (d’où les titres, oui, Un cigare dans la bouche de Tolstoï étant la traduction fort peu littérale d’Anna in the tropics.)
AL : Le titre original de la pièce résonne comme une comédie musicale américaine. On entend bientôt les chœurs volontaristes, l’ascension de violons aigrelets, partition de Rodgers, livret d’Hammerstein. Et il y a quelque chose de très musical, en effet, et de très américain, dans ce drame d’exilés, d’îliens partis rouler des cigares sur les côtes de Floride. A commencer par ces grandes scènes d’usine, ouvriers se lançant le dialogue comme on s’envoie des balles, figurants qu’on imagine multitude dans les recoins de la fabrique, femmes qui attendent le bateau sur le quai alors que leurs hommes parient sur les combats de coq. Et encore ces didascalies qui proposent le rire, à chaque page, à l’ensemble des comédiens, de prime abord de façon pénible. Un système. Puis, l’on se dit qu’entre l’automatisme des rires enregistrés à l‘américaine d’un côté, le ricanement réflexe du public français en toute circonstance de l’autre, et l’enthousiasme contraint des applaudisseurs de plateaux télévisés au centre… finalement, se faire voler son rire par des personnages, et assister impuissant au spectacle de la joie – même jouée par des professionnels – peut devenir une belle chose.

PA : Ce que la pièce donne à voir, c’est l’évolution de ces ouvriers pour la plupart en couple – et il faut à la finale compter le personnage de Cheché comme appartenant à un couple, sa femme l’ayant plaqué pour un précédent lecteur –, à mesure que la lecture de cet adultère russe se déploie dans les consciences et les imaginaires et que la personnalité du lecteur leur devient familière. Tout cela finira mal, car lire est dangereux et que l’on ne propose impunément à des gens qui ne vous demandaient rien, ou au contraire seulement cela, d’entrer dans l’imitation, certes plus ou moins consciente selon les niveaux de lecture (ou plutôt : d’audition) de l’adultère Anna Karénine. Notons que Santiago, le plus âgé des personnages, patron de la fabrique, joueur invétéré et conséquemment criblé de dettes, trouvera son « salut » quant à lui non pas dans l’imitation d’Anna mais dans celle de Lévine, qu’il comprend comme s’étant « dévoué toute sa vie à sa ferme » ; et de reprendre en main sa fabrique.
On est d’emblée, mais sans aucune ostentation ou forfanterie formelle, dans le théâtre dans le théâtre, et avec une telle évidence que c’est à peine si l’on s’en rend compte. A la finale, on est davantage proche d’Emma Bovary que d’Anna Karénine (après tout, le lecteur de Madame Bovary qui aurait l’idée aussi saugrenue que courante de se moquer d’Emma Bovary, omet fréquemment le fait qu’il accomplit exactement la même chose qu’elle : il lit ; et certainement pas mieux.) Emma Karénine, c’est moi.
Mais ce n’est pas la seule dimension. Ou plutôt, elle en croise une autre, non moins politique, à la faveur toujours du personnage finalement central de Cheché, qui est celle de la modernité, et partant celle de la machine, de la technique – publicité incluse. Du fait de l’absence relative de Santiago, le patron, comme aussi du fait de la concurrence, la question se pose de moderniser l’outillage de la fabrique, afin de ne pas se laisser distancer. L’idée d’introduire des machines, et donc, du fait du bruit, de virer au premier chef le lecteur, est en réalité apportée par ce même Cheché, qui est plus ou moins le frère du patron et veut le pouvoir, non moins qu’il est, du fait de son histoire intime, l’ennemi du lecteur.
JUAN JULIAN. – Regardons les choses en face : les cigares ne sont plus très populaires. Les films de cinéma montrent maintenant des stars qui fument des cigarettes : Valentino, Douglas Fairbanks... Ils fument tous des clopes, fini les gros cigares. Vous n’avez qu’à aller à Hollywood et proposer nos cigares aux producteurs.
CHECHE. – Vous devenez cynique…
JUAN JULIAN. – Je vous mets en garde. Cette façon de vivre à cent à l’heure avec des machines, des voitures, ça freine la consommation de cigares. Et vous voulez savoir pourquoi, señor Chester ? Parce que les gens préfèrent tirer deux trois taffes rapides, le genre de taffes qu’on attend d’une cigarette. La vérité, c’est que les machines, les voitures, ça nous empêche d’aller faire une promenade, ou bien nous asseoir sur un banc dans le parc, pour fumer un cigare lentement, au calme. Comme il se doit. Vous voyez, Chester, vous voulez la modernité, mais la modernité est en train de détruire notre propre industrie, elle détruit jusqu’à l’acte de fumer un cigare.
AL : Cheché est aussi le seul américain à proprement parler, le seul « native » du drame, les autres étant tous des expatriés cubains. Lui, Chester le continental, le demi-frère en tant que parent et en tant que traître, est l’homme de la modernité, cette Amérique que tous sont venus chercher, tout en continuant de scruter depuis le port les arrivages de lecteurs en provenance de leur Cuba natale. Chester est celui qui ne regarde plus vers l’île, mais vers l’Ouest. Il est le mécanicien, l’homo ex machina, l’ouvrier co-machinisé du futur, et le futur c’est maintenant, c’est lui.
PA : Il ne faut pas oublier donc, que nous sommes en 1929, à la veille d’une grande crise, d’un changement de monde. Le temps de la machine arrive, celui de la lecture s’en va.
Le danger sous nos yeux change de gueule ; plus précisément, il va perdre sa figure humaine. Le lecteur meurt à la fin, et la poursuite de la lecture que fait Palomo aux tous derniers instants de la pièce, alors même que le lecteur était l’amant de sa femme et qu’il le sait, est d’une portée toute symbolique, au deux sens du terme : parce que c’est symbolique, et parce que ce n’est plus, déjà, que symbolique.
Une note, à la toute fin du livre, précise :
« A partir de 1931, les lecteurs disparurent des fabriques ; les ouvriers du cigare n’étaient plus que des Américains sous-payés qui faisaient marcher des machines. Fin d’une tradition. »
AL : Des Américains sous-payés. Des Cheché.
PA : La modernité, depuis, a vaincu bien d’autres choses, et pas seulement aux Etats-Unis. Néanmoins, je trouve amusant que cette pièce américaine et contemporaine parle à ce point de tabac, et pour l’associer à une manière de civilité et de civilisation, et non point à la maladie, la mort ; et sans doute, que l’on y fume sur scène (je ne vois pas tellement comment on pourrait faire autrement).
AL. : Les Amériques, de haut en bas, sont un fumoir où s’élèvent de fascinantes spirales en guise de rite de passage. Quand les mexicains mâchent ou fument le peyotl, les sioux s’échangent le calumet et les cubains se passent le havane. Compréhension par la combustion. Les volutes du cigare exhortent le fumeur au déchiffrement du monde.
L’auteur note, c’est dans le texte, c’est une didascalie : « le cigare ne doit jamais être passé directement à celui qui doit le fumer. Il doit y avoir un médiateur pour faciliter la communication avec les dieux. » Ne pas respecter le rituel constitue « une offense ». Or donc, un fumeur va enfreindre la règle, et offenser Juan Julian, le lecteur débarqué de Cuba, vécu comme un intrus. Parce qu’il est un peu plus jeune que les emplisseurs de cigares. Parce qu’on lui prête le pouvoir du comédien. Parce qu’on lui accorde d’éprouver, dans la réalité, la passion qu’il fait vivre à son auditoire, dans la lecture : celle d’Anna et Vronski du roman de Tolstoï. Le non-respect des coutumes sacrées – on ne couche pas avec une femme mariée, on ne passe pas directement un cigare – semble être le coeur de la pièce. Or c’est la raison même du théâtre. Toute la tragédie s’articule autour de cela, le refus d’une règle, l’abandon d’un code, et le châtiment final. Puisque le cigare qu’on tend à Juan Julian, au lieu d’être une marque de respect, devient affirmation d’un mépris, proposition de duel. Et désigne le lecteur comme victime expiatoire. Or c’est encore cela qu’un personnage de tragédie, la tragédie de ces personnages : cet oubli du code, qui les laisse devant la porte de secours, sans pouvoir pénétrer plus avant dans la rédemption. Ici, le dernier havane créé dans la fabrique porte le nom de l’héroïne russe et romanesque, le titre du livre lu – en hommage à la littérature bien plus qu’à Juan Julian le lecteur, certes, mais reste que ce lecteur y sera, dans la mort, associé pour l’éternité.
PA. : Voilà tout ce que Nilo Cruz traite dans sa pièce, finalement de façon très simple. Pour être un peu plus dur, on pourrait trouver facilement le rapport à Tolstoï très insuffisant : une poignée de citations, pas toujours simples à contextualiser, qui paraissent d’une façon ou d’un autre toujours un peu anecdotiques, doivent valoir pour la lecture d’une grande partie de cette énorme roman russe ; et c’est là précisément que, du fait de la dimension romanesque de la pièce, précisément, le roman manque. Il est frustrant de devoir se contenter d’une dizaine de citations et en même temps, il est évident qu’on ne va pas lire l’intégralité en scène d’Anna Karénine. C’est une question de temps et elle ne peut guère être résolue : le temps de la représentation n’est pas le temps de la lecture et il est très difficile de faire entrer le temps de la lecture dans celui de la représentation (alors que l’inverse pose beaucoup moins de problèmes).
AL. : En annexe, à la fin de son ouvrage, Cruz resitue les citations empruntées dans le roman originel, page par page. Une invitation à les retrouver dans leur contexte, justement. La question à présent est : peut-on relire Anna Karénine sans penser à Palomo et Juan Julian ?
PA : Oui, quand même, je crois. Ce qui n’empêche pas Un cigare dans la bouche de Tolstoï d’être une vraie bonne pièce. Finalement.
Un cigare dans la bouche de Tolstoï, de Nilo Cruz. L’Arche éditeur, 2009. Texte français de Fabrice Melquiot.
[1] La pièce a par ailleurs reçu le Pulitzer théâtre 2003 et non pas 2001, comme l’annonce le bouquin. [PA]
[2] J’avais initialement écrit « porcherie » et, plus loin, « porcs » ; mais je me ravise : je suis décidé à choisir toujours l’insulte la plus faible, la plus « basse intensité » non parce que je me « dégonfle », mais parce que cette faiblesse même me semble intéressante, parlant elle aussi de ceux dont je parle : le mot porc est, je ne sais pourquoi, plus fort, et donne l’idée que les gens que je critique ici sont eux-mêmes forts, ce qui est erroné. Ce sont de pauvres gens. [PA]
[3] Quand je vais au théâtre, j’ai de plus en plus le sentiment que les acteurs s’habillent comme chez eux. Avec leurs propres fringues. Au vrai, ce qui me gêne, c’est de constater à quel point nous nous habillons mal. [AL]
(Les photos de spectacle sont de Ken Howard.)