Ce qui est saisissant, dès les deux premières pages de La Route, c’est l’impression très forte, très nette, qu’aucun écrivain français n’aurait pu écrire aujourd’hui deux pages comparables, ni au surplus les achever ainsi :
Il ne savait qu’une chose, que l’enfant était son garant. Il dit : S’il n’est pas la parole de Dieu, Dieu n’a jamais parlé.
(C’est que nous sommes, nous, ici, en France, et je n’ai guère de raison de m’exclure magiquement de cela, dans le monde qui fait le malin, comme avait dit Péguy. Il faut faire le malin ; et pour entrer dans la carrière d’écrivain monter jeune à Paris, si l’on n’y est pas né, et vasouiller dans le milieu en compagnie d’écrivaillons, d’éditueurs et de journaleux ; et finir tout asséché par raconter en détails l’histoire d’amour ratée, forcément ratée, mais torride, funèbrement romantique, de sa bite et de son nombril – les dames transposeront.)
McCarthy, lui, ne fait pas le malin.
Il écrit.
Ça n’a rien à voir.
Ça va tout droit. Il n’y a pas de digressions.
Une langue simple, précise, directe, presque sans virgules.
De la très haute poésie, très dense.
La catastrophe a eu lieu. Quelle est-elle ? On ne sait pas, et on ne cherche pas à le savoir ; d’ailleurs, on ne peut sans doute pas.
Le monde est mort, couvert de cendres, l’air difficilement respirable, le froid et la pluie incessants. Il n’y a plus d’électricité, plus de moyens de communication ou de transport. Il n’y a plus de civilisation.
Les hommes survivent, comme ils peuvent. Retournent à grande vitesse aux temps primitifs.
C’est moins de la science-fiction qu’un grand roman anthropologique.
Ce qui est effrayant, souvent, dans ce roman, c’est la sensation que ce monde d’apocalypse est aussi le nôtre, déjà.
Le roman est un seul fil tendu. Du début à la fin nous suivons ces deux personnages-là. Personne ni rien d’autre.
L’homme et le petit. Ainsi que la narration les nomme, et elle ne les nomme pas autrement.
Le petit appelle l’homme Papa. L’homme parfois dit le mot Dieu.
Ces mots-là sont des fictions.
La narration dit l’homme et le petit.
Ces deux fictions-là, Papa et Dieu, dont il n’y a aucunement à douter, même si l’épreuve est telle que les deux personnages préféreraient être morts, les maintiennent dans l’humanité. Seuls.
Le père est concret pour son fils. C’est Papa. Et même Dieu n’est pas un dieu de la théologie, c’est un dieu immédiatement concret, présent, dans un monde effroyable et tout entier signé de son absence.
Il y a la parole. Ces deux-là se parlent. Peu. Difficilement. Mais ils se parlent. Malgré tout.
Ça va aller. C’est ce que dit le père, souvent. Et, répondant au petit, non moins souvent : On ne va pas mourir.
Ces deux humains-là tentent de survivre dans un monde dévasté, sans animaux, sans plantes, où les arbres sont morts ; dans un monde où l’homme pour se nourrir chasse l’homme, où se reconstituent des tribus avec leurs rites païens, leurs esclaves, leurs femmes, etc., dans la violence la plus crue.
L’homme et le petit évitent les hommes.
Ils sont sur la route avec un caddie. Ils vont vers le sud. Vers la mer. Il reste deux balles dans le revolver.
Ils sont les gentils. Ils se cachent des méchants. C’est ainsi que le petit, du moins, dit les choses. L’homme ne trouve rien à y redire.
L’homme a connu le monde d’avant. Pas le petit.
Ils étaient sur la route avant que le roman commence. Depuis quelques années.
Cherchant leur nourriture dans les maisons abandonnées. Marchant vers le sud. Crevant à moitié de faim.
Refusant de tuer l’homme pour manger. Des gentils. Que les mots Papa et Dieu instituent encore dans l’humanité quand il n’y en a plus.
Pour protéger le petit, l’homme tue un autre homme. Le petit ne parle plus.
J’aurais dû être plus prudent, dit-il.
Le petit ne répondait pas.
Il faut que tu me parles.
D’accord.
Tu voulais savoir à quoi ressemblent les méchants. Maintenant, tu le sais. Ça pourrait se reproduire. Mon rôle c’est de prendre soin de toi. J’en ai été chargé par Dieu. Celui qui te touche je le tue. Tu comprends ?
Oui.
Il était assis, encapuchonné dans la couverture. Au bout d’un moment il leva la tête. On est toujours les gentils ?
Oui. On est encore les gentils.
Et on le sera toujours.
Oui. Toujours.
D’accord.
Il n’y a plus qu’une balle dans le revolver.
Elle n’est pas nécessairement destinée à un agresseur potentiel.
Quand il y en avait deux, et dans le cas où ils ne pourraient plus échapper à la capture, l’homme aurait pu tuer le petit et, avec assez de temps, se tuer ensuite.
Ils sont traqués. Fouillant une maison apparemment à l’abandon, ils sont tombés sur une cave où quelques êtres humains mutilés attendaient d’être mangés, l’étaient déjà, vivants, pour partie. Traqués.
Ils étaient plaqués au sol, dressant l’oreille. En es-tu capable ? Le moment venu ? Le moment venu il ne sera plus temps. Le moment c’est maintenant. Maudis Dieu et meurs. Et si le coup ne part pas ? Il faut que le coup parte. Mais s’il ne part pas. Pourrais-tu écraser avec une pierre ce crâne chéri ? Y a-t-il en toi une pareille créature dont tu ne sais rien ? Est-ce possible ? Tiens-le dans tes bras. Juste comme ça. L’âme est prompte. Presse-le contre toi. Embrasse-le. Vite.
Ils échappent. Reprennent la route. Chaque jour à marcher. Pour trouver quoi ?
La route, de Cormac McCarthy, Editions de l'Olivier, traduit par François Hirsch
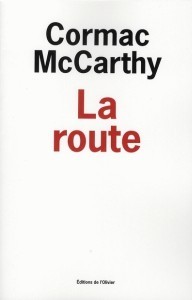
Commentaires
C'est beau.
chiant comme la goutte au nez.