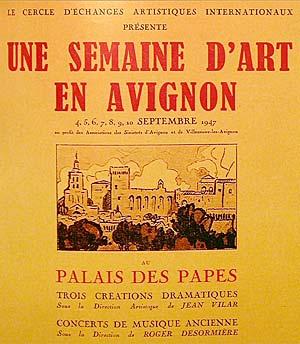Le Commandement de la Machine (1)
**
Deuxième série de coupes :
63. Les guerres sont commencées. Simultanées, elles se chevauchent. Personne ne vous demande de choisir : vous appartenez à un camp, ou à un autre. Que cela vous plaise, ou pas, n’est pas une question. Fort heureusement, il est des choses auxquelles on n’échappe pas.
97. De son point de vue, qui est exactement la totalité des divers points de vue qui peuvent ou non s’exprimer, la Machine te cerne totalement ; d’autant plus même qu’elle te somme de choisir entre ses points de vue celui ou ceux dont, toi-même étant monnaie et marchandise, tu devras faire commerce. Ta vie, cette illusion fondamentale que la Machine a intérêt à ne jamais t’ôter, cette illusion au contraire qu’elle se doit de te faire développer toi-même, oui, ta vie même, elle l’appelle dès sa naissance à disparaître en elle, dans sa matière immense, en une fusion matricielle par laquelle ta mort même est judicieusement anticipée. Alors quoi ? – Mais moi, je te dis qu’il n’y a pas à choisir entre ces différents points de vue fabriqués tous à l’identique, mais à prendre en soi la totalité même de ces points de vue, oui, à prendre en soi le point de vue de la Machine. Et bien sûr, c’est impossible.
121. Ta petite volonté imbécile d’échapper aux lois de la reproduction, d’échapper en somme à la génération et à la corruption, littéralement, ne compte pas à part. Elle prouve au mieux, cette croyance que ton destin individuel serait séparé de celui de l’espèce, ton imbécillité ; or, ce n’est pas du tout là que les choses se jouent. Ce calcul, en tant justement qu’il est calcul, appartient de fait à l’ordre de la Machine ; il lui est donc utile.
249. On ne lutte pas contre la Machine, mais seulement contre ce qu’on prend pour elle – qui est fonction d’échelle. Et ce fait même d’attaquer un fantasme de Machine tient à l’illusion nécessaire, fondamentale, de la vie. Ta force de négation demeure ici seulement explétive.
1026. Mais comment peuvent-ils à ce point détester leurs enfants, leurs propres enfants ? Et comment, non moins, trouvent-ils encore le moyen d’ignorer cela même ? Parce que, putain, cela crève les yeux – et justement, sans doute est-ce cela qui les leur crève… L’Europe des loisirs, où gouverne une nouvelle gentilité, saisie d’un effroi rétrospectif, extatique et inintelligent dont la durée trahit sans doute une reddition définitive à la raison inférieure, semble avoir décidé de ne plus commettre d’erreurs, c’est-à-dire de crimes, ce qui est en soi sa plus grande erreur et partant, son crime le plus ignoble – mais sans doute le dernier. Aussi la voit-on attaquée de partout, et par des ennemis qui n’hésitent plus à se nommer, mais elle a décidé unilatéralement qu’elle n’avait plus d’ennemis et que, donc, il était bienséant de ne pas se défendre, et de poursuivre son divertissement – je veux dire : son suicide. Quand on menace de mort toi et ta famille, tu prends des anti-dépresseurs ou tu retournes au cinéma ? Les deux, ah bon… l’un, puis l’autre. C’est formidable, ce qu’ils appellent la tolérance… La crainte et l’espérance étant les deux faces d’une même attente, on peut dire qu’il n’y aura pas, ou très peu, de survivants, car pour qu’il y en ait demain, il en faudrait aujourd’hui. L’histoire est action, conflit et finalement sélection ; en tout cas, elle ne connaît pas la paix. De sorte qu’il n’est finalement qu’un moyen de sortir de l’histoire et ce moyen, c’est d’en sortir en fumée. Bon vent.
1035. Tout serait tellement simple et livré d’emblée au surplomb ridiculement bas de ceux qui passent pour des esprits critiques, si le Commandement de la Machine, nie-toi toi-même, derrière sa face apparente et massive n’en cachait une autre, elle réellement sensée. – Celui qui appartient à la masse et obéit à un Commandement qu’il n’est pas en capacité d’entendre, à un Commandement en somme dont il n’a pas conscience, choisissant parmi les possibles, se nie lui-même et l’ignore. Mais celui qui, entendant le Commandement pour ce qu’il est réellement, voulant y obéir et y obéissant de toute la puissance de son être, autre chose lui étant parfaitement impossible, que fait-il donc sinon se trouver ?