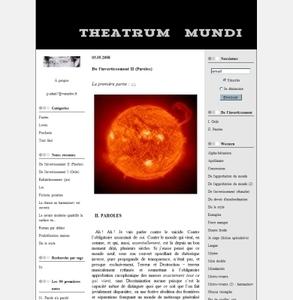La femme parle en premier :
– J’ai fait repeindre en rose la prison ; tu ne sortiras pas d’ici vivant.
– Et alors ?
– Je t’imaginais davantage aimer la liberté. Mais cela même, tu es trop fier pour l’admettre.
– Du temps que je régnais, je ne faisais nul cas de la liberté, et ce faisant, la laissais libre. Vous ne m’en privez pas, ma petite fille ; car vous ne me pouvez priver que de ce qui m’appartient.
– Tu vas souffrir ici, mon oncle.
– Certainement. Mais cela du moins est à moi.
– Il faut que tu croupisses et souffres et meures ici. Toi ôté, le monde est libéré, chacun fait selon son désir. Nous n’avons plus besoin de soldats, nous n’avons plus besoin de devoirs.
– Vous n’avez plus d’honneur.
– Qu’importe, je n’aurai pas d’enfant.
– Ton monde meurt, imbécile. Quel âge as-tu à présent, Ingrid ?
– Moins que celui que je parais, puisque je ne parais évidemment pas mon âge.
– Tu as toujours ce visage d’enfant butée, mais comme ciré, et cireux. Ton visage d’enfant est un masque de mort.
– Non. Tu me hais.
– C’est une décision que tu as prise. Je ne te hais pas. Simplement, il te fallait ma place, vite, toute ma place, tout de suite, quitte à me marcher sur la face. Je ne te souhaite pas qu’un jour tes enfants à leur tour t’imitent.
– Mes enfants ? Quels enfants ? Je les tue dans mon ventre. Quant aux autres enfants de la Cité, ils me seront soumis. Comment ne reconnaîtraient-ils pas en moi la révolte, leur révolte, la matrice même de toutes les révoltes ?
*
Voilà, c’est tout. C’était une page de carnet, griffonnée ce matin dans un quelconque buffet non fumeur d’une charmante gare de Province. J’ai simplement imaginé d’inverser le rapport de pouvoir liant Antigone et Créon. Le vieux homme en tenue militaire approximative est arrêté, placé dans une cellule – bizarrement ? – rose (fluo). Nantigone (oui, Nantigone, pourquoi pas ?) lui rend visite – peut-être, pour plus de transparence, les protagonistes sont-ils séparés par une vitre blindée.
Une autre note (très approximative et schématique), la veille :
« Nantigone, fille de Nœdipe, pour exister, doit fantasmer son père en une espèce d’Hannibal Lecter. Elle doit le transformer en Hannibal Lecter, quitte à récrire l’histoire entière. Et par extension tout homme plus âgé qu’elle… » Pour Lecter, je pense surtout aux films, et donc à Anthony Hopkins. De Thomas Harris, j’ai seulement lu Dragon rouge, probablement peu après sa sortie en France, dans les années 85 (au pif).
Je l’ai appelée Ingrid, finalement, (je voulais un prénom charmant et froid, papier glacé, qui sente le Nord, i. e. la Réforme) et lui est anonyme. Nommer (ou évoquer) Antigone, ou même Créon, les eût rendus illisibles. « Mon oncle » a l’inconvénient de rappeler le Fou dans King Lear, et « Cela du moins est à moi », à propos de la douleur (ou de la souffrance, je ne sais plus), est de Claudel (Mesa, je crois, dans Partage de midi).
Restons-en là.