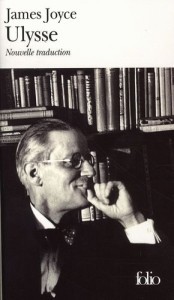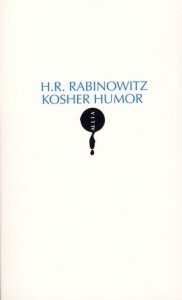Peut-être vous souvenez-vous de cette émission de FR3, diffusée à 20 h entre 1987 et 1994, intitulée La Classe, véritable Comique Académie avant l’heure, présentée par un (pré)nommé Fabrice, laquelle émission a gratifié notre beau pays d’une pleine génération de comiques pas drôles, dont à peine s’excipe un Bigard, apparemment chargé de faire consister dans la réalité même l’invention idéologique du « beauf » en lui servant de miroir et partant, d’influer jusque sur la façon dont parle le chef de l’Etat – lequel, ordinairement pas plus drôle que Dieudonné, peut en conséquence également prétendre au titre envié de comique.
Quel rapport avec la rentrée littéraire (sic), me direz-vous ? Aucun, sinon qu’attrapant l’autre soir par l’internet l’émission intitulée Café Littéraire en date du 17 octobre 2008, sur France 2, j’ai tout de suite pensé à La Classe, émission que je n’aimais guère et que je ne regardais, en fin d’adolescence, que pour fuir la demi-heure de propagande n’importe-quoïste de prétendus journaux télévisés. La différence, toutefois, tient à cela que si La Classe, bourrée de comiques, m’arrachait parfois, à grand-peine, un sourire, l’émission Café littéraire de cet excellent Picouly m’a littéralement fait pleurer de rire, ce qui n’est tout de même pas si fréquent.
Il faut dire que cet animateur de salle des fêtes avait su s’entourer d’une kyrielle de comiques involontaires assez performante.
Un premier « salon », appelons ça comme ça, réunissait, outre un Picouly parfait dans son rôle de naïf prompt à s’émerveiller de n’importe quelle broutille imprimée, Michel Onfray et François Bégaudeau. Le premier, sûr de lui, teigneux, intolérant, ne doutant pas de ses effets ni de son talent – ce qui, déjà, est à se tordre –, vantant la prétendument érotique Shiva contre saint Paul, réduisant par de pompières outrances le christianisme à la seule mortification, balançant je ne sais combien de fois, pour désigner tout ce qu’il n’aime pas, le mot de catastrophe, et présentant son catastrophique Souci des plaisirs. Face à lui, excellent en roquet hystérique, vivante publicité pour la destruction de toute intelligence, frôlant le miracle en parvenant à donner chair à la vacuité même, cirant atrocement les pompes de son vis-à-vis avant de se retourner contre lui pour une affaire de basse police éditoriale, François Bégaudeau, venu vendre son Antimanuel de littérature, lequel n’est certainement rien d’autre qu’un prétentieux manuel d’anti-littérature, cet auteur étant à la littérature ce que Rocco Siffredi est au septième art. C’était beau, déjà.
Mais Picouly, pas trop avare d’effets comiques voyants, fit alors entrer sur le plateau l’inénarrable Pierre Assouline, blogueur de son état, étrangement drapé d’une sorte de dignité sans doute taillée pour l’occasion, venu défendre son dernier livre en date, Brèves de blog, dans lequel, si j’ai bien compris, se trouvent quelques paroles peu amènes évoquant notre brave Bégaudeau. L’échange, entre Assouline (le critique sans critique) et Bégaudeau (le BHL nouveau est arrivé et nous en avons pris pour trente ans au bas mot), de morceaux disparates de phrases convenues concernant le point de savoir ce qu’est la critique littéraire, fut un grand moment d’anthologie. Le non-sens le disputait à l’odieux. C’était vraiment très drôle. Ne fallait-il pas, d’ailleurs, en termes de mise en scène, pour qu’Assouline parût digne, que Bégaudeau redoublât de bassesse, tâche dont il s’acquitta en surpassant quelque peu ses propres capacités, bassesse dont Assouline se vengea amphigouriquement en défendant l’ « érotique » Onfray sinon sur ces conceptions de la laïcité (ne nous mouillons pas), du moins sur les tempêtes bloguesques qu’elles déclenchaient dans un verre d’eau virtuel…
La scène fut interrompue avant l’enlisement définitif par la décision de Picouly d’aller dans un autre salon interviouver un dénommé Grangé, grand vendeur de bouquins. La séquence fut décevante (à moins qu’il ne faille penser que Picouly sait ménager ses effets, alternant temps forts et temps faibles). Grangé, en effet, est un garçon tout ce qu’il y a de plus normal, et dépourvu, malgré les millions d’exemplaires de romans ratés que débite son éditeur, de toutes prétentions farfelues. Il ne prétend pas, en somme, faire autre chose que ce qu’il fait, id est des livres de divertissement. Il acheva de me décevoir, et perdit ainsi toute chance d’être promu à la haute dignité de comique, lorsque, mis par Picouly face à une critique pour le moins assassine de son dernier bouquin, il répondit simplement que, publiant des livres, il se savait exposé à la critique. Cette honnête sobriété d’artisan à l’ancienne est, je trouve, du plus mauvais aloi.
Picouly revint au premier « salon », dans lequel l’attendait un duo de choc composé du vieil Ormesson et de la toujours improbable Josyane Savigneau. L’ex-terroriste en chef du Monde des livres (sic) me surprit par sa modestie rigoureusement calibrée, laquelle me sembla adoucir son visage que j’avais jusque là toujours trouvé quelque peu calviniste, en admettant être journaliste et non pas écrivain, ce qui est pour être exact n’en est pas moins navrant, tandis qu’Ormesson, en laissant entendre avec une fausse modestie éculée qu’il était, lui, écrivain et non pas journaliste, parachevait un mensonge plus vieux que Philippe Sollers (cette phrase finit étrangement, je sais).
Il s’ensuivit (comme si c’était logique) la retransmission d’une interviou d’un Salman Rushdie enfin libéré de ses gardiens, revenant brièvement sur un islam jadis tolérant, et visant même le Nobel (double syndrome de Stockholm?). Montage étrange. Quelques phrases sur son dernier salmigondis romanesque – la globalisation version XVI° siècle, entre les luxurieux bordels musulmans d’Inde et ceux, à forte teneur homosexuelle, de Florence, si j’ai bien suivi –, suivies d’un long discours de soutien à Barack Obama dépeint en Sauveur (rien moins) de l’Amérique (« Obama, nous voilà, devant toi, le Sauveur d’ l’USA… » parodierais-je volontiers), lequel discours très original convaincra sans doute les 5% de Français inconscients prêts à voter McCain de changer de camp, afin que triomphe soviétiquement le premier, dans cette élection à laquelle ces mêmes Français ne prendront pas part (nous ne sommes pas aux USA, je le rappelle). Très amusant, aussi.
Cette émission s’est achevée sur une interviou de Claire Castillon, écrivain dont je ne savais rien du tout et que ce formidable Picouly, sans doute pour m’éclairer, a présenté comme ayant eu une liaison avec PPDA – ce qui, peut-être, la situe dans le « paysage littéraire ». La critique de son bouquin, dont le titre m’échappe, fut abandonnée à un écran d’ordinateur, dans lequel trônait une journaliste de chez Marianne, Anna Topaloff, manifestement chargée de valoriser ledit bouquin en en proposant une critique d’une imbécillité crasse certes, mais aussi d’une vulgarité sans frein.
Fin de l’émission. Rien de littéraire là-dedans, mais quelle rigolade !
Conclusion (que me souffle à l’instant ma Kamarade Roselyne Bachelor du ministère de l’Hygiène physique et mentale :)
PICOULY NUIT GRAVEMENT A LA LITTERATURE.
Ce qui n’a aucune espèce d’importance, puisqu’il n’y en a plus.