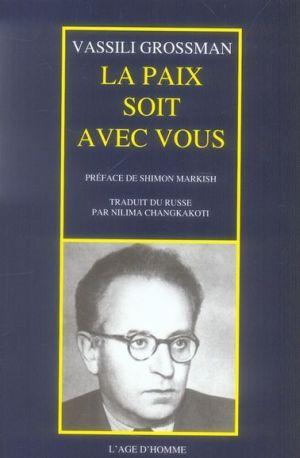Yazid tue Simon.
En novembre 2003, dans le XIX° arrondissement de Paris, France, dans un parking.
C’est un « fait divers ».
(Comme on dit. A tort. Un « fait divers », ça ne veut rien dire.
Quand un journal regroupe en une seule rubrique, parce qu’ils apparaissent mineurs ou superfétatoires, plusieurs faits reliés entre eux par rien (ou par rien d’autre que de les ranger là ensemble), il est tout à fait fondé à nommer cette rubrique : faits divers.Mais quand, pour une raison ou une autre, cette raison serait-elle un roman, on isole de nouveau un de ces faits, eh bien que voulez-vous ? ce fait demeure un fait, tout bonnement ; n’a aucune raison de devenir un « fait divers ».)
Yazid tue Simon, donc.
C’est un fait.
Ce fait est le point de départ du roman.
C’est également son point d’arrivée.
Le roman commence par le récit du meurtre, s’achève par celui de l’enterrement.
Entre les deux, il y a l’enquête.
Qui remonte le temps. Qui remonte vingt ans.
L’enquête, ici, n’est pas menée par la police.
Enfin, pas par la « vraie » police, je veux dire : la police officielle.
Le roman n’est pas un roman policier.
Non, c’est bien pire.
L’enquête, ici, est menée par un journaliste, un journaliste « médiatique » (ce qui laisse entendre, comme si la presse écrite elle aussi n’était pas un média, que le bonhomme passe à la télévision, voire même y produit quelques émissions, etc…), à la demande d’un Ministre qui, d’ailleurs, n’est pas Ministre de l’Intérieur, mais qui pourrait le devenir ; enfin, qui aimerait bien…
Le Ministre est de droite (comme on dit), le journaliste de gauche (idem). Ceci dit, le journaliste n’enquête pas pour « révéler » (comme on dit), mais pour étouffer (?).
Voici comment commence l’enquête (p.22) :
« – Tu comprends bien qu’il ne faut pas qu’on dise qu’à Paris des Arabes tuent des Juifs. Tu imagines les unes des journaux. Et le plaisir de nos chers amis américains. CNN, tout ça. Trop contents… Moi je ne peux pas bouger. Mais toi vas-y. Va voir. Fais parler les uns et les autres, mène ton enquête. Regarde ce qui s’est vraiment passé. Raconte-moi. Après tout, tu es aussi journaliste, merde.
– Et Juif.
Il esquisse un sourire gêné.
– Je vais y aller dès demain. Je te tiens au courant. »
Et comment elle finit (p. 330) :
« – Tu sais je n’ai rien fait d’extraordinaire. Tout le système politique, judiciaire et médiatique s’est spontanément mis à mon service. Je n’ai rien eu à demander, encore moins à exiger ou menacer ; je n’ai eu qu’à surveiller que chacun faisait ce que tout le monde désirait. Comme si l’autruche médiatique préférait se mettre la tête sous le sable. Encore une minute, monsieur le bourreau ! Même le journaliste israélien a fini par rentrer au pays. Dégoûté.
– Excellent ! Excellent ! »
Yazid tue Simon.
Prenons les cartes d’identité (fictives, puisqu’il s’agit d’un roman) des personnages.
Yazid, qui est Français, tue Simon, qui est Français.
C’est une histoire entre Français.
Mais ça ne veut plus rien dire. Et plus personne n’y croit.
Ce n’est pas la carte qui ne veut plus rien dire, c’est l’identité.
Il n’y a plus d’identité, il n’y a que des différences. Du moins est-ce le Credo fondamentalement séparatiste, communautariste de la religion en cours.
Ce qui pèse lourd, pour le Ministre comme pour tout le monde finalement, c’est que Yazid est Arabe et que Simon est Juif.
Yazid, qui est Arabe, tue Simon, qui est Juif.
Voilà pourquoi l’affaire (le crime) doit être étouffé.
Il ne faut pas qu’on dise qu’à Paris des Arabes tuent des Juifs.
Les Français, au fond, personne n’y croit. (C’est fini.) A commencer par le Ministre, donc. (Non sans raison, qui sait ?)
Il est trop tard.
L’enquête de notre narrateur « antiraciste » va venir explorer tout cela, très concrètement, dans cet immeuble parisien du XIX° au nom champêtre « La-Grange-aux-Belles ».
Le lecteur apprendra comment un immeuble où des gens d’origines et confessions différentes venus en France dans les années 1980 parvenaient à s’entendre, à vivre somme toute chichement mais décemment, finit vingt ans plus tard par être le théâtre de cet assassinat ; comment chaque personne (ou presque) fait repli sur sa communauté d’origine (réelle ou supposée) ; comment dès lors la rivalité mimétique joue à plein, monte aux extrêmes, insensiblement d’abord, puis de plus en plus vite.
Jusqu’au meurtre.
Jusqu’à ce prodrome de la guerre civile qu’est le premier meurtre.
Prodrome romanesque puisque, je le rappelle, ce livre est un roman.
Petit frère. N’entend-on pas là, très assourdi par la distance et le contexte, un écho de l’histoire de Caïn et Abel ?
Quand je dis que chaque personne (ou presque) fait repli sur sa communauté d’origine (réelle ou supposée), c’est inexact.
Le catholicisme, ou le christianisme, ne fait plus communauté. C’est fini. (On le savait, remarquez.)
Mais le fait d’être Français non plus finalement. (Plus là, en tout cas. Peut-être ailleurs, en province, dans les milieux ruraux, je ne sais pas. Mais plus là, à Paris, dans le XIX°.)
Plus encore que le concierge de l’immeuble débarqué de son Orléanais natal, Charles Boucher, qui voit lentement se dégrader les conditions de vie de son immeuble (p. 177-118)…
« […] après avoir fermé le jardin, on avait installé les codes, édifié une porte blindée à l’entrée de sa loge, puis muré l’ancien passage entre les caves des différents immeubles. L’héroïne avait complété le haschich, les téléphones portables étaient plus maniables que les BMW ; un jeune camerounais avait été pris chez lui avec 50 000 francs ; les frères Mokhtari, au gré de leurs fréquents passages en prison, avaient pris du galon […]. (…) Il reconnaissait le vendredi aux innombrables djellabas d’un blanc immaculé que revêtent les hommes, à leurs babouches dorées aux pieds et leurs petites calottes de tricot blanc sur la tête. Il attendait la retraite pour se retirer dans la campagne verdoyante de l’Orléanais. »
… me paraît réussi, émouvant, pathétique, le personnage (pourtant fugace) de son fils, Kevin Boucher, qui (p. 220-221) :
« voulait « faire ramadan ». Il l’avait annoncé à ses parents sur le ton d’un enfant-roi de dix ans. Kevin Boucher avait la peau rose de son père et les yeux bleus de sa mère. Kevin Boucher en avait assez d’être traité de « cochon de Français ». De halouf. Kevin Boucher en avait assez d’être « traité ». Il souhaitait, dans les toilettes, boire au robinet des « musulmans » et ne plus être relégué à celui honni des « Français ». »
Yazid, qui est Arabe, tue son ami d’enfance, Simon, qui est Juif.
C’est encore beaucoup trop simple, évidemment.
Yazid, qui est un petit dealer « rebeu » mis au « chômage » par ses propres chefs, qui vient de faire un séjour en hôpital psychiatrique (ce qui permettra de ne pas donner de suite pénale au crime), qui est récemment retourné à la mosquée, qui est manipulé par l’imam Al-Mansour à la voix douce mais qui lui bourre littéralement le crâne à l’antismétisme islamique (ou islamiste si vous y tenez, mais bon) tue son ami d’enfance Simon, qui est Juif, qui réussit comme DJ et qui donc commence à avoir du pognon (voire même, fin du fin, je ne sais trop quelle Audi TT), qui sans cesse voyage de Paris à Miami etc., qui n’a plus besoin de son ami Yazid pour porter le matériel et accessoirement fourguer de la came aux bobos…
Yazid qui a échoué, tue Simon qui réussit.
Yazid qui est Arabe, tue Simon qui est Juif.
Yazid qui est à présent musulman tendance lourde, tue Simon qui s’en fout d’être juif.
Même s’il prend, grâce à son boulot de DJ, sa carte verte pour les « States ». Tout en défendant les Arabes, prenant toujours l’exemple de son copain Yazid, qui est comme son grand frère. Mais, comme le lui dit un de ses nouveaux « amis » Juif français émigré à Miami en entendant qu’il faut rester optimiste (p. 208) :
« Dans les années trente aussi il y avait des optimistes et des pessimistes. Les pessimistes ont fini à Hollywood et les optimistes à Dachau. »
(C’est amusant, cette histoire de majuscule qu’il faut mettre, ou pas, au mot Juif.
Si je dis que Yazid est Arabe et que Simon est Juif, il n’y a pas de souci : je mets des majuscules partout.
Si je dis que Yazid est musulman (et que donc, je parle de confession religieuse), faut-il écrire que Simon est Juif, ou qu’il est juif ? En bonne logique, qu’il est « juif ».
Ce qui est compliqué, ce qui défie la logique, ou du moins : la symétrie, c’est que Yazid n’est pas Arabe : il est de nationalité française, et de religion musulmane. Sa mère Aïcha, entrée en France enceinte de lui, est Marocaine, et si Yazid était né de l’autre côté de la Méditerranée, lui aussi eût été Marocain. En aucun cas Arabe.
Mais il y a l’usage : un maghrébin (pas de majuscule, ce n’est pas une nationalité), en France, qu’il soit ou non Français, on l’appelle un Arabe. C’est comme ça. C’est l’usage. Ca vient – j’imagine – de la couleur de la peau, qui se repère évidemment, tandis que la nationalité, elle, ne se repère pas « au premier coup d’œil »…
Tout cela est très compliqué.
L’auteur du roman lui-même a tendance à mettre une majuscule au mot « Juif » (moi aussi, du coup). Mais pas là, par exemple (p.331) : « – Tu sais ce que disait mon père : un Juif riche est un riche, un Juif pauvre est un juif. » (C’est le Ministre qui parle, mais c’est moi qui souligne.)
Qu’est-ce qu’un « Juif de France » ? (Et l’ « islam de France » ?)
Majuscule ou minuscule ? « L’usage est partagé pour le nom Juif. » dit Grevisse (1993) en son Bon usage.
Il n’y a pas à dire : un Albanais du Kosovo, c’est plus simple.
Après tout, il suffit de faire un sort à l’idée d’Etat-Nation. Rejeter l’idée de Nation – de natio, dérivé de nasci, naître –, en la voulant confondre à je ne sais quel nationalisme, pour défendre mordicus l’idée légitime de droit du sol – jus soli accordant la nationalité à toute personne physique née sur le territoire national –, c’est se priver de l’âme, et dévoluer en Administration l’Etat et la Nation. D’où cette espèce de guichet de service qu’est devenu l’Etat sans Nation mais accroché à la prime administrative à la naissance…
Bref, on comprend que l’auteur, roman oblige, utilise les dénominations les plus simples, les plus communes : un Juif, un Arabe.)
Le grand intérêt du roman, c’est que l’enquêteur béhachélien, antiraciste professionnel, n’est pas étranger sinon au meurtre, du moins à la dégradation des conditions qui l’ont « permis » (p.326).
« Parfois, quand j’observais l’évolution de la situation française et la montée du « fascislamisme », que je dénonçais désormais sans me lasser, il m’arrivait de m’interroger. Avions-nous déclenché la bonne guerre ? Avions-nous livré les bonnes batailles ? »
Ou (p. 329) :
« Qu’est-ce que la gauche aujourd’hui ? Suis-je encore de gauche ? Mon progressisme n’a-t-il pas été le paravent commode à l’abri duquel j’ai pu faire fortune ?
[…]
Je me sens responsable de la mort de ce petit. Et de tant d’autres qui risquent de venir. »
Il semble bien qu’avec le temps aussi, indépendamment de leurs réussites respectives et des rôles qu’ils doivent tenir dans la comédie des apparences, les opinions profondes du Ministre et journaliste se soient inversées ; le journaliste doute du Bien différentialiste et multiculturaliste qu’inlassablement il a promu – et sans doute pour cela commence d’écrire en secret le récit de cette affaire qu’il a pourtant charge d’étouffer –, le Ministre adopte dans sa pratique de Maire d’une ville de banlieue toutes les pratiques de Dialogue pseudo-consensuelles qu’il a longtemps combattues. Etc.
L’auteur ouvre son roman avec une citation de Finkielkraut : « L’antiracisme est le communisme du XXI° siècle ». Le narrateur l’achève par une citation du Talmud : « Celui qui fait preuve de miséricorde envers le cruel se conduira bientôt avec cruauté envers le miséricordieux. »
Petit frère est un bon roman.
Certains ne manqueront pas, n’ont pas manqué de dire qu’il est à thèse.
C’est assez malhonnête.
Je ne doute pas pourtant que Zemmour ait des opinions (mais une thèse ?) ; elles sont assez connues, apparemment.
Cette thèse, si elle est, est tue. Aucune solution, dans ce bouquin.
L’auteur en son roman ne trouve guère de porte-parole.
Son narrateur même ne professe pas les opinions de l’auteur.
(On peut peut-être dire que les remords du narrateur tombent dans les opinions de l’auteur.)
Mais qui veut nous faire croire à l’existence d’un auteur neutre, hors du monde et comme objectivé ?
N’ayant pas un personnage par lequel s’exprimer, l’auteur est contraint de s’exprimer en tous.
(Au théâtre, j’appelle ça la dramaturgie. Je me laisse parfois aller à dire en plaisantant qu’écrire du théâtre commence quand on met ce qu’on pense soi-même dans la bouche d’un imbécile.
Et sinon dans la bouche d’un imbécile, dans celle d’un personnage point unique, c’est certain. Il me semble parfois que la dramaturgie, technique mise à part, est commune au roman et au théâtre – cf. les notes de Corneille sur ce qu’il appelle le roman dans la pièce.)
Petit frère est un bon roman.
Il y manque donc beaucoup de choses : toutes celles que j’aurais aimé apprendre sur les personnages, et que je n’ai pas apprises. Manques qui se transforment en questions…
Au vu de ses prétentions légitimes – décrire une « société » à son moment « critique », et plus encore les causes de ce moment que ses effets –, le livre est un peu court.
Le livre est chez Denoël.