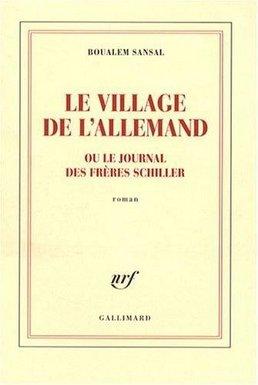Il y a quelques années, les journalistes et les écrivains (sic) ont inventé un nouveau sous-genre prétendument littéraire : l’autofiction, laquelle consiste, apparemment, en une espèce de journal intime plus ou moins sommairement romancé – disons, avec une idée du roman tellement basse, ou tellement contemporaine, qu’elle n’existait certainement pas avant 1950, même dans les rêves les plus sinistres des écrivains les plus modernes –, parfois aussi en une production nombriliste de sortes de mémoires…
Raconter sa vie, bien sûr, demeure l’une des hypothèses de la littérature, quoique cela ne soit à cette dernière ni intrinsèquement nécessaire ni évidemment suffisant. Notons enfin qu’il n’était pas venu à l’esprit de Joyce, de Proust ou de Céline, ni même de Bukowski, de nommer cet exercice autrement que roman ; et que Saint-Simon lui-même s’était contenté du banal mot mémoires. Mais ceux-là n’avaient pas sans doute l’extrême talent de nos contemporains.
En fait de suffisance, le plus gênant, finalement, dans toutes ces autofictions – ne salopons pas ici davantage le mot roman, qui se salope bien assez tout seul – de Catherine Millet ou de Christine Angot, par exemple – ces stars du que dalle –, ne tient pas à ce que leur vie est minable – cela arrive que des vies soient minables, cela n’arrive même que trop, quoique pas sans raison, même si, comme dit ma bouchère quand il pleut : « C’est la vie… » –, le plus gênant, finalement, dis-je, c’est que, de ces vies minables parmi tant d’autres, ces autofictions ne sont pas foutues de rigoler, même un peu.
Les voilà donc parties, nos bougresses, à exhiber leurs symptômes, ou leurs grandes lèvres, quand ce n’est pas les deux, mais en posant, si j’ose m’exprimer ainsi, à la grande tragédienne renversée, avec la conviction imbécile autant que moderne que l’exhibition même produira à elle seule ce que je rechigne ici à nommer un écart critique – conviction qui relève de ce que Freud appelait la pensée magique et qui se révèle en effet, à la lecture, dénuée de tout fondement.
A force de hurler au tragique, nos autofictionneuses finissent intégralement pathétiques, certes, mais dotées. Il faut bien avouer, à leur décharge (sic), que l’époque, depuis ce paumé de Rimbaud au moins, est à la valorisation mercantile des pathologies les plus diverses (ce ne sont partout qu’originaux, paumés, déviants, marginaux, malades. Lesquels ne sont finalement rien d’autre, sous forme de pilules livresques, que l’exotisme de la bourgeoise – bourgeois inclus, l’époque renversant la norme également dans la langue –, son aventure, son anti-dépresseur, et, en dernière analyse, si l’on me permet le mot, sa mouillaison finale, abstraite). Et de leurs vies minables, fort harmonieusement, nos écrivaines fabriquent des bouquins minables itou ; et l’on ne distingue plus, dans ce déluge de bassesses, de quoi exactement elles sont le plus satisfaites. Toujours est-il qu’elles et leurs saloperies se vendent, et que l’on voit mal à quelles autres fins possibles les éditeurs ont édité ces merdes-là. Il leur faut donc poser, même après l’âge, aux demi-mondaines parigotes, toujours prêtes à l’emploi, le nombril en troisième œil cyclopéen, l’inconscient à ciel ouvert et les ovaires en sautoir. Dans ces jeux de miroir déformants, où la réalité même n’est plus jamais en vue, au point que s’il était écrit aujourd’hui, le théâtre de Jean Genet pourrait passer pour une impardonnable naïveté, les éditeurs maquereaux posent au curé ou à l’entraîneur, encourageant leurs ouailles, leur faisant même accroire, dans l’hypothèse où eux-mêmes ne seraient point dupes, qu’elles travaillent à l’extension du patrimoine littéraire national…
Comprenez-moi bien. Je n’aime guère la féminisation des noms ; si je l’emploie pourtant ici, c’est qu’elle me semble, en elle-même, disqualifiante, à la condition toutefois de replacer les choses dans leurs contexte historique :
Madame de Lafayette, Madame de Sévigné, par exemple, sont des écrivains.
Christine Angot, Catherine Millet, puisque j’ai jeté ce soir mon dévolu sur ces deux pointures-là, sont, comme le veut l’époque, des écrivaines.
Mais ce n’est pas seulement une histoire de genre naturel et de genre grammatical, puisque je maintiens ici que les deux n’ont pas nécessairement à se recouper :
Aussi puis-je bien vous avouer que Marc Lévy aussi est une écrivaine, par exemple. Mais non moins que Bernard Werber, Yannick Haenel ou Annie Ernaux.
Je regarde la rentrée littéraire, donc, cette opération marketing qui a transformé les écrivains (sic) en écoliers, et pire, en écoliers contemporains, prêts à surenchérir dans la connerie jusqu’après même le crime au nom de je ne sais quel élitisme de la nullité ; autant dire que l’épithète littéraire est non seulement galvaudée, mais tombe à plat, dans une flaque de rien. C’est tout juste de la « littérature » de magazine féminin (j’aime bien lire les magazines féminins, et l’on m’entend généralement rire depuis les chiottes…) ; et finalement, c’est peut-être de la littérature « féminine », au « sens » où les magazines sont féminins – il y a d’ailleurs, désormais, des magazines féminins pour hommes – : je veux dire par là que ce sont un ramassis de conneries écrit pour les femmes (hommes inclus, donc), et auquel les femmes mêmes, la plupart du temps, ne croient pas. Seulement voilà, les femmes sont des femmes, elles se doivent d’accomplir un certain nombre de rituels bizarres, parmi lesquels on trouve la lecture de ces magazines. La rentrée des écrivains sent donc le magazine féminin à plein nez, ce qui ne serait vraiment pas grave si, pour encore passer pour littéraire, nos littérateuses des deux sexes ne se sentaient l’obligation de parler de leurs déjections mondaines et prétendument littéraires avec un sérieux de plomb (mais c’est aussi ça qui est le plus drôle).
Maintenant, je vais vous dire un truc : si vous trouvez misogyne ce que je viens d’écrire, c’est certainement que vous avez des femmes une conception pour le moins méprisante, pour ne pas dire : féministe, quelque puisse être par ailleurs votre sexe, enfin, votre genre, ou je ne sais quoi. Passons.
Passons sans nous poser le problème de l’œuf et de la poule. Est-ce parce qu’il y a de plus en plus de femmes publiées (hypothèse de la poule), que les livres sont de plus en plus mauvais ? Ou est-ce parce que la littérature s’est effondrée (hypothèse de l’œuf), que les femmes se sont massivement mises à écrire ?
Il est préférable de simplement constater aux étals : il y a de plus en plus de femmes publiées et les livres sont de plus en plus mauvais.
Pour conclure, je dirais volontiers que les deux Maigret, de Georges Simenon, que je viens de lire pour cinq euros chez le bouquiniste me semblent valoir bien mieux que ce tas de cochonneries industrielles.
J’en donne de suite les titres :
Maigret chez le ministre : où l’on comprend que la politique d’aujourd’hui n’est pas davantage corrompue que celle d’hier, mais que tout ce qui rendait vivable ce monde a été interdit, puis supprimé. (Alexandre Vialatte notait, mais je cite de mémoire, que Maigret parvenait à la vérité par le calvados et l’andouillette…)
L’affaire Saint-Fiacre : un monde âpre et dur, avec ses inégalités de classe, intégralement (ou presque) disparu au profit d’un monde immensément meilleur et donc diamétralement opposé, c’est-à-dire âpre et dur, avec ses inégalités de classe. Aucun rapport entre ce monde rural d’hier, et notre monde urbain d’aujourd’hui, sinon cette pourriture sur pieds qu’est invariablement l’homme (femmes incluses, je précise).
Et hoc sufficit.