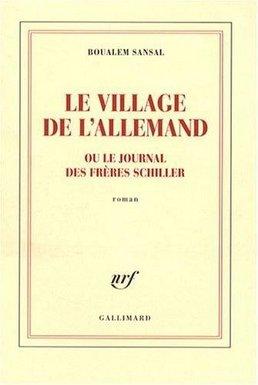Le Village de l’Allemand (ou le Journal des frères Schiller) n’est pas seulement un roman sur la proche parenté – descendance, pourrait-on dire ici – liant le nazisme d’hier à l’islamisme d’aujourd’hui ; c’est aussi un roman sur la lecture et la connaissance historique. Et le fait est qu’on aurait tort, me semble-t-il, de ne voir là qu’un roman à thèse, fût-il très habilement construit : tout simplement parce qu’un constat n’est pas une thèse, contredirait-il l’amour maladif de l’époque pour le déni de réalité.
Rachel et Malrich sont frères, sont nés en Algérie, vivent en France, ont quatorze ans d’écart. Leurs parents – père allemand, héros du F.L.N., mère algérienne – vivent à Aïn Deb, près de Sétif. Rachel – contraction de Rachid Helmut – est cadre dans une boîte internationale, vit avec Ophélie dans un petit pavillon ; son frère cadet, lui, zone avec ses potes dans la cité, a échappé de justesse aux imams recruteurs de martyrs d’Allah, ne fréquente guère son frère qui l’emmerde avec sa morale, etc.
Lorsque Rachel apprend, le 25 avril 1994, par les informations télévisées que ses parents ont été assassinés dans leur village d’Aïn Deb, il se rend sur place. Fouillant dans les affaires de son père, il découvre que celui-ci fut auparavant un officier SS ayant servi dans les camps d’extermination. Il ne dira rien à son frère, ni à Ophélie – qui le quittera –, descendra seul aux enfers en mettant ses pas dans ceux de son père, sillonnant l’Europe, la Turquie et l’Egypte, puis se suicidera aux gaz d’échappement le 24 avril 1996, dans le garage de son pavillon, après s’être rasé le crâne et avoir enfilé un pyjama rayé. Voilà, pour aller vite, ce qui s’est passé avant que le roman ne commence.
Le roman proprement dit est l’histoire de la lecture par Malrich – contraction de Malek Ulrich –, qui n’a même jamais entendu parler de la Shoah, du journal de Rachel. Lecture qui va le pousser à tenir à son tour son journal. Même s’il ne sait pas très bien écrire.
Le roman s’ouvre sur cette épigraphe de Malrich : « Je remercie très affectueusement Mme Dominique G.H., professeur au lycée A.M., qui a bien voulu réécrire mon livre en bon français. Son travail est tellement magnifique que je n’ai pas reconnu mon texte. J’ai eu du mal à le lire. Elle l’a fait en mémoire de Rachel qu’elle a eu comme élève. (…) Elle dit qu’il y a des parallèles dangereux qui pourraient me valoir des ennuis. (…) »
En effet. Dans un premier temps, Malrich, qui ne sait pas grand-chose de l’Allemagne nazie ni de l’Histoire en général, d’ailleurs, rechigne à suivre son frère dans la condamnation de son père, tient évidemment à la mémoire de son père (c’est un soldat, il n’a fait qu’obéir, un ordre est un ordre, etc), puis se documente, fait lui aussi le périlleux voyage d’Aïn Deb, et commence, si j’ose dire, de « comprendre ».
Malrich, à la différence de son frère, ne plongera pas maladivement dans le passé. Parce que son frère l’a fait pour lui, sans doute ; mais aussi parce que ce qu’il découvre du nazisme, il le voit autour de lui se mettre en place en temps réel : ce qu’il exprime ainsi dans une lettre, qu’il sait au demeurant parfaitement vaine au Ministre de l’Intérieur de la République française (nous sommes alors en février 1997) : « Les islamistes ont colonisé notre cité et nous mènent la vie dure. Ce n’est pas un camp d’extermination mais c’est déjà un camp de concentration, ein Konzentrationlager comme on disait sous le Troisième Reich. Peu à peu, nous oublions que nous vivons en France, à une demi-heure de Paris, sa capitale, et nous découvrons que les valeurs qu’elle proclame à la face du monde n’ont en réalité cours que dans le discours officiel. N’empêche et malgré toutes nos tares, nous y croyons plus que jamais. Tout ce que nous nous interdisons en tant qu’hommes et citoyens français, les islamistes se le permettent et nous refusent le droit de nous plaindre car, disent-ils, c’est Allah qui l’exige et Allah est au-dessus de tout. A ce train, et parce que nos parents sont trop pieux pour ouvrir les yeux et nos gamins trop naïfs pour voir plus loin que le bout de leur nez, la cité sera bientôt une république islamique parfaitement constituée. Vous devrez alors lui faire la guerre si vous voulez seulement la contenir dans ses frontières actuelles. Sachez que nous ne vous suivrons pas dans cette guerre, nous émigrerons en masse ou nous nous battrons pour notre propre indépendance. »
Ce roman est admirablement construit : si l’on y lit en alternance le journal de Malrich et des morceaux de celui de Rachel, c’est à Malrich (et à Mme G.H.) qu’il faut attribuer la paternité de ce « montage » romanesque. Le narrateur principal n’est pas loin, donc, d’être analphabète ; quant au professeur qui « réécrit en bon français » son livre, rien ne dit qu’elle revendique le statut absurdement envié d’ « écrivain ». La prose de ce roman est donc très simple, ne vise pas apparemment le grand style littéraire. Ce qui me semble la marque la plus sûre du grand talent dramatique de l’auteur.
Boualem Sansal, qui est Algérien et vit en Algérie, où ses livres sont censurés, est un homme courageux.