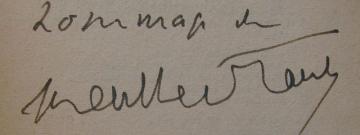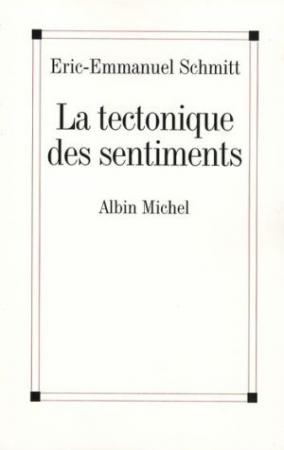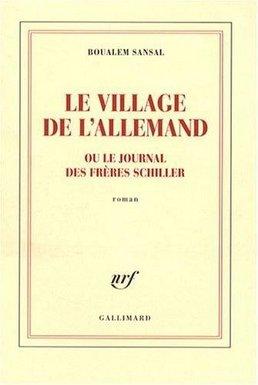Jour de poésie, sans doute (« Le français se cache pour mourir »). Le texte qui suit est de 2006 et je dois vous avouer qu’à l’époque, j’avais encore l’impression d’exagérer quelque peu…
…Je publie donc ici, non sans une générosité certaine que mes détracteurs réactionnaires ne manqueront pas de me reprocher, ce modèle universel de lettre de candidature, de lettre de demande de subvention, de lettre de motivation, voire même, moyennant quelques changements légers, de lettre à un éditeur subventionné, modèle universel à l’usage de mes collègues auteurs dramatiques (1)… Ce geste charitable, totalement gratuit, devrait valoir aux signataires leur obole. J’ai moi-même à maintes reprises testé ce modèle ; toujours avec succès. Je recommande de conserver son titre (j’allais dire son « générique ») : Placet beau, lequel contient un jeu de mots de la plus belle facture impayée (comme ceux qu’on peut lire dans le quotidien Libération).
Pour parler comme mon personnage : l’Ôteur, je dirai que : l’obligation de me citer n’est pas obligatoire.
(1) On croyait savoir que la SACD s’occupait des auteurs et compositeurs dramatiques, dont elle est la société ; mais l’extension bien légitime d’une part de la notion d’auteur, la montée en puissance de l’analphabétisme égalitaire d’autre part, ont conduit à reconnaître, pour le seul spectacle vivant, des auteurs de : théâtre, théâtre musical, mime, arts du cirque, one man show (en français dans le texte), arts de la rue, opéra, spectacles de sketch(es) (idem), chorégraphie, comédie musicale, sons et lumières. C’est dire si mon aide est précieuse.
L’ÔTEUR. – Ce placet beau, très beau, est vidament dédiécassé au Citoyen Suprême, lequel bien sûr ek-siste ainsi que tout le monde le suce. Faut-il le dire que le Citoyen Suprême c’est je-tu-vous dès lors qu’il n’y en a plus rien du tout de l’individuel dedans, c’est n’importe lequel des qui qui ne se l’envoie pas dire et le dit lui-même de lui-même que c’est lui. Ou toi. Mais surtout moi. Parce que l’Etat c’est moi et que moi, l’Etat je lui chie sur sa gueule.Voilà pourquoi que mon teste, beau comme ma semence, en même temps c’est vachement digne de se faire recevoyer par vous, ô Citoyen Suprême ! Et donnez-moi seulement du popognon et je serai guéri de pas recommencer encore. J’espère que vous me comprendez. D’autant que j’y ai droit à le pognon, vu la rage de révolte dedans que j’ai. Car parce que c’est là que je la fais, ma référence humblement. Car en tant qu’artisteur globalisé je me comprends moi-même déjà pas mal. Oué. Même que j’en ai causé avec des amis à moi qu’ils étaient bien d’accord après des bières que mon teste il est génial.
Bref, tout ça le théâtre c’est que pour dire que les artistes ils sont comme les citoyens, je veux dire unis ensemble mais avec des grumeaux de communautés rouges plein partout dedans quand même en plus, comme les morceaux de fruits dans les yaourts je sais plus lesquels. Car c’est du yaourt superpositif oué, la Républicité de la démocrasse. Mais aussi que si les artistes ils sont comme les citoyens alors aussi l’inverse c’est vrai que les citoyens ils sont comme les artistes, y a pas de raison. Bref quoi, ici c’est suprême qu’il est le Citoyen, surtout qu’il lutte contre. Car parce que c’est un rebelle avant tout, tu vois ? que le citoyen sans rien, en fait il a tout dedans qui fait qu’il est pareil que les autres, quoi. C’est un artiste, si tu veux. Comme nous tous si qu’on veut, merde. Et on va tout niquer le pays comme une pétasse dans la tournante.
Voilà, Citoyen Suprême, c’est pour toi ce placet beau subversé, et puisque c’est kif-kif c’est aussi de toi un peu qu’il est, ce placet ; et si que je le dis c’est pour dire merci comme quoi tu nous a éduqués bien dans ta sorbonne d’où qu’on vient. Qu’on est là nous aussi pour les péter les enculés de gens pas-qui-résistent, oué, et faire sur les trottoirs des flaques de sang comme une grosse et virginique œuvre d’dard. Oué. Merci. Casse-toi, Président de mes couilles et merci pour les susventions de la culture.