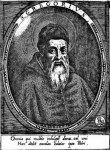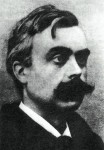
La première fois que l’Esprit du Sabaoth parla de moi, ce fut pour que les hommes n’oubliassent pas qu’on m’avait vue tout en flammes au seuil de l’Eden perdu.
J’étais, en cet ancien jour, une épée de feu dans la main de feu du Chérubin qui gardait par moi le sentier de « l’arbre de vie ».
La Famille humaine s’enfuyait sous l’épouvantable ironie de Dieu, à travers les épines d’un monde inconnu, désormais ensemencé de malédictions, où les gigantesques animaux, – hostiles déjà, – la regardaient s’enfoncer.
Ah ! on était, alors, de tristes Dieux, bien étrangement dénués ! On agonisait de jeunesse et l’inexpérience de la Douleur correspondait, en ces deux Etres qui devaient tout enfanter, aux lassitudes inexprimables des derniers temps à venir de l’Humanité.
Il est probable qu’on ne rêvait pas beaucoup dans les crépuscules de cet exil. Les monts et les fleuves d’avant le Déluge étaient vainement prodigieux et les plateaux étalaient en pure perte leurs végétations emphatiques.
Le soleil avait pâli pour toujours et l’immense tristesse de l’Orgueil était accroupie sur la Création. On se souvenait trop de moi et on se souvenait trop du Paradis.
Un jour, enfin, longtemps après le premier Meurtre, exécuté je n’ai su comment, il arriva qu’un terrible garçon, sorti de l’Homme à la main sanglante, forgea quelque chose de resplendissant qui me ressemblait. Le Jardin des délices n’ayant existé que dans la mesure de l’humaine convoitise des Cieux et le Chérubin se lassant de préserver un symbole que ne menaçait plus la nostalgie d’aucun exilé, je reçus la permission d’incorporer ma brillante image et d’aller ainsi par toutes les vallées de la Mort, comme l’attestation du Châtiment et le rappel divin des Extases.
*
Aussitôt je devins la Guerre, et mon redoutable Nom fut partout le signe de la Majesté.
J’apparus l’instrument sublime de la providentielle effusion de sang et, dans mon inconscience merveilleuse d’élue du Destin, j’épousai, le long des siècles, tous les sentiments humains capables de l’accélérer.
La Colère, l’Amour, l’Enthousiasme, la Cupidité, le Fanatisme et la Démence furent servis par moi d’une façon si parfaite que les histoires ont eu peur de tout raconter.
Pendant six mille ans, je me suis soûlée, sur tous les points du globe, de massacres et d’égorgements. Il ne m’appartenait pas d’être juste ni d’avoir pitié. Il suffisait que je fusse indiciblement sainte par ma Vocation et que j’aveuglasse de tant de larmes les yeux des mortels que les plus orgueilleux en vinssent à tâtonner humblement du côté du ciel. J’ai tué des vieillards qui ressemblaient à des palais de la Douleur, j’ai tranché les mamelles à des femmes qui étaient comme de la lumière et j’ai percé des petits enfants qui me regardaient avec des yeux de lions mourants.
Chaque jour, j’ai galopé sur le Cheval pâle dans l’avenue des cyprès qui va de « l’utérus au sépulcre », et j’ai fait une fontaine de sang de tout fils de l’homme qui se trouvait à ma portée.
Si je n’ai pas frappé Jésus, c’est que j’étais trop noble pour Lui. J’étais trop auguste pour qu’Il acceptât la mort que je donne.
C’était bon pour Ses apôtres et pour Ses martyrs, pour Ses vierges et pour leurs bourreaux, qui périssaient à leur tour. Je n’étais pas ce qu’il fallait à cet Agneau de l’Ignominie.
*
J’ai, sans doute, le droit d’être fière, car je fus passionnément adorée.
Etant la messagère ou l’acolyte du Seigneur Très Haut, jusque dans l’apparente iniquité de mes voies, on s’aperçut que j’accomplissais une besogne divine et il vint un jour où l’héroïsme occidental me donna précisément la Forme sacrée de l’instrument de supplice qui m’avait été préféré pour la Rédemption.
Le monde alors fut en extase pour ma beauté. Les chrétiens adolescents rêvèrent de moi, je reçus le dernier baiser des monarques agonisants, les conquérants treillissés de fer s’agenouillaient en me regardant et des continents furent ensanglantés de la prière dont j’étais l’inspiratrice.
Lorsque l’enthousiasme de la Croix s’éteignit, je condescendis à l’investiture de ce que les hommes appelaient l’Honneur, et, dans cet abaissement, je parus encore assez magnifique pour que l’Europe entière se précipitât aux pieds d’un seul Maître qui m’avait placée dans l’ostensoir de son cœur.
Assurément, il ne priait pas, cet Empereur de la Mort, mais, quand même, je répandais, à l’entour de lui, l’œcuménique oraison du Sacrifice et du Dévouement, – la terrible oraison rouge qui se vocifère dans les abattoirs de peuples.
Ah ! ce n’était pas aussi grand que le passé, mais qui dira combien ce fut beau ? J’en sais quelque chose, moi, l’Epée, dont il est écrit que je dois tout dévorer à la fin des fins !
*
En attendant, je suis humiliée par des pollutions indicibles. Il n’a pas fallu moins de dix-neuf siècles de christianisme après tant de fois mille ans d’idolâtrie, pour qu’on en vînt à me prostituer ; mais aujourd’hui, c’est irrémédiablement accompli et voilà pourquoi la Tueuse impassible se désespère !
Ah ! sans doute, on m’a vue souvent passer en des mains étranges, mains d’oppresseurs, mains de bourreaux ou mains de bandits. On m’a vue même dans la sacrilège main des lâches d’où je m’enfuyais aussitôt qu’ils entendaient gronder le tonnerre.
On ne sait pas ce que je pèse dans la balance inique des victorieux et on ignore combien je me fais légère au poing léger des adultères ou des parricides. Car mon royaume est exclusivement de ce monde, je domine sur le vaste empire de la Chute et toutes les catégories d’expiations m’appartiennent. Les gens à courte vue peuvent donc, à la rigueur, tout me reprocher, puisque je suis à la fois le Crime et le Châtiment.
Mais ce qui se passe en cette rognure de siècle désavouée par la racaille de l’Abîme est si dégoûtant que je ne sais pas où l’Exterminateur devra me tremper un jour, pour me dessouiller des usages inouïs que l’on fait de moi. Je suis devenue la ressource dernière et la fatidique salope des maquereaux en litige ou des journalistes oblats dont la purulence eût épouvanté Sodome !…
*
On voit des semblants d’hommes, de corpusculaires Judas, paraissant avoir été obtenus par les fétides accouplements de quelques sales et vénéneux vieillards, qui, non contents de s’être versé réciproquement sur la tête leurs âmes de fumier, s’ingèrent encore de vider par moi leurs querelles de lupanar.
Ils osent, de leurs mains pourries, capables d’oxyder les rayons du jour, toucher à l’Epée des Anges et des Chevaliers !
Ils osent m’offrir leurs poitrines, leurs impurifiables poitrines que n’épuiserait aucun vidangeur céleste et du fond desquelles semblent monter les borborygmes effrayants de leur courage militaire !
En d’autre temps, lorsqu’il y avait encore des êtres faits pour commander, ils eussent assurément gardé de très beaux cochons sur la pisseuse lisière de ces mêmes forêts que déshonorent aujourd’hui leurs malpropres combats.
Ils eussent été trop heureux de pâturer à l’ombre des chênes, en rêvant de carotter quelques additionnelles pitances aux nobles chiens du Seigneur, sans trop s’exposer à la trique de l’ergastulaire.
Ces drôles immondes vivent aujourd’hui, comme s’ils étaient les concubins de la gloire et le troupeau de groins qu’ils paissent a vraiment l’air d’être les trois quarts de l’humanité contemporaine, devenue assez liquide pour se choisir de tels pasteurs.
Abusant effroyablement de la Parole dont ils ont fait une ordure, ces hermaphrodites avortés pérorent dans les journaux ou les assemblées et se badigeonnent entre eux de leurs excréments et de leur sanie.
Les coqs de France n’osent plus chanter et les trois au quatre derniers aigles qui se sont obstinés à vivre pour être les témoins du prochain déluge, ne savent plus où reposer leurs tristes ailes fatiguées de les soutenir au-dessus de ce dépotoir.
C’est ainsi qu’on peut contempler dans l’un ou l’autre crépuscule, sous les frondaisons désolées, de pâles charognes s’aligner pour de dérisoires escrimes où il est parlé d’honneur !
Et c’est moi, le très vieux Glaive des Martyrs et des Chefs de guerre, qui suis employé à cette besogne de dégoûtation !
Mais qu’ils y prennent garde, les nocturnes palefreniers de la jument populaire.
Je dévore qui me touche et j’en appellerai de moi-même à moi-même pour punir mes profanateurs.
Mes lamentations sont mystérieuses et terribles. La première a percé les cieux et noyé la terre ; la seconde a fait couler deux mille ans des Orénoques de sang humain ; mais à la troisième, que voici, je suis sur le point de reprendre ma forme antique. Je vais redevenir l’Epée de flammes et les hommes sauront enfin, pour en crever d’épouvante, ce que c’est que ce tournoiement dont il est parlé dans les Ecritures !…
(1890)