« La croyance au progrès est une socialisation de la vengeance. »
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
« La croyance au progrès est une socialisation de la vengeance. »


Il est plus simple de se rappeler ce que Hegel a dit des comédies d’Aristophane : « Si on n’a pas lu Aristophane, on peut difficilement savoir de quel contentement l’homme peut se satisfaire, à quel point sa gaieté est vigoureuse et immodérée. »
La formule de Hegel nous rappelle les obstacles qu’il faut franchir en lisant les comédies d’Aristophane. Car si nous désirons comprendre, apprécier et aimer les comédies d’Aristophane, il est nécessaire que nous soyons d’abord dégoûtés par elles. Les moyens qu’emploie Aristophane pour nous faire rire incluent la médisance ou la calomnie, l’obscénité, la parodie et le blasphème. A travers ce brouillard épais et nauséabond, nous voyons des paysans rustiques, pris de boisson ; de bonnes natures ; jaugeant les femmes, libres ou esclaves, comme ils jaugent un cheval ou une vache ; dans leurs moments les meilleurs ou les plus gais, ceux qui ne sont dupes de personne, fût-il un dieu, une femme ou un glorieux capitaine, mais moins enragés qu’amusés d’avoir été si souvent trompés par eux ; aimant le pays et ses coutumes ancestrales et éprouvées, méprisant le genre nouveau et sans racine qui fleurit en l’espace d’une journée dans la cité, parmi les fanfarons survoltés ; incroyablement familiers du beau, de sorte qu’ils l’apprécient chaque allusion à la moindre tragédie d’Eschyle, de Sophocle et d’Euripide ; et incroyablement experts en beauté, de sorte qu’ils ne tolèrent pas une parodie qui ne soit pas, à sa manière, aussi parfaite que l’originale. Le public d’Aristophane est composé d’hommes d’une telle naissance et d’une telle stature – ou en tout cas la partie la meilleure ou qui fait autorité de son public (ce qui est le cas pour tout poète non méprisable). Le public auquel s’adresse Aristophane ou qu’il invoque est la meilleure démocratie qui soit, telle qu’elle fut décrite par Aristote : la démocratie dont l’assise est la population rurale. Aristophane nous fait voir ce public dans sa plus grande liberté et sa plus grande joie, de sa périphérie fruste et vulgaire à son centre d’une délicatesse sublime ; nous ne le voyons pas aussi bien, même si nous le sentons bien, pour ce qui est de ses chaînes et de ses limites. Nous ne voyons qu’une moitié de l’humanité, apparemment la moitié inférieure, en fait la moitié supérieure. L’autre moitié appartient à la tragédie. La comédie et la tragédie ensemble nous montrent la totalité de l’homme, mais de telle manière que la comédie doit être sentie dans la tragédie et la tragédie dans la comédie. La comédie commence au plus bas du bas alors que la tragédie demeure au centre. Aristophane a comparé la muse comique ou plutôt le Pégase du poète comique à un bousier, une petite bestiole méprisable qui est attirée par tout ce qui sent fort, qui semble combiner la prétention avec une distance absolue à l’égard d’ Aphrodite et des Grâces – monture qui, quand on peut la décider à s’arracher de la Terre, monte plus haut que l’aigle de Zeus : elle permet au poète comique d’entrer dans le monde des dieux, de voir de ses propres yeux la vérité en ce qui concerne les dieux et de communiquer cette vérité aux mortels. La comédie s’élève plus haut que tout autre art. Elle transcende tout autre art ; elle transcende en particulier la tragédie. Dans la mesure où elle transcende la tragédie, elle présuppose la tragédie. Le fait qu’elle présuppose et transcende la tragédie trouve sone expression dans les parodies de tragédie qui sont si caractéristiques de la comédie d’Aristophane. La comédie s’élève plus haut que la tragédie. Seule la comédie peut représenter les hommes sages : des hommes comme Euripide ou Socrate, des hommes qui en tant que tels transcendent la tragédie.
Ce n’est pas pour nier que la comédie d’Aristophane abonde en éléments ridicules du plus bas niveau. Mais cette comédie ne tourne jamais en ridicule ce que seuls des hommes pervers pourraient trouver ridicules. Elle reste dans les bornes de ce qui est par nature ridicule. Il y a des fessées mais non des tortures ou des meurtres. Ce qui provoque véritablement la terreur doit être absent, et tout particulièrement ce qui provoque la plus grande peur : la mort, c’est-à-dire le fait de mourir – distinct du fait d’être mort dans l’Hadès. Doivent être aussi absents ce qui provoque la compassion et ce qui est vraiment noble.
Leo Strauss, « Le problème de Socrate », preimière conférence, dans La renaissance du rationalisme politique classique, Gallimard, collection Tel, traduit par Pierre Guglielmina
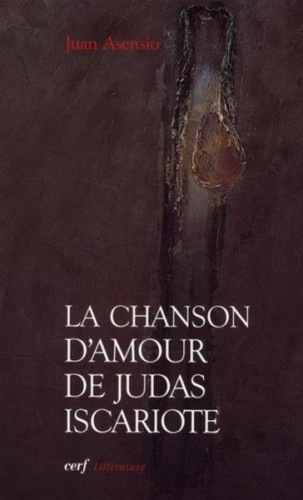
Il nous paraîtrait lourdement préférable, pour différents motifs qui ne lésinent pas à se contredire entre eux, de ne pas parler de ce livre. Témoigner de la lecture de ce livre, si c’est bien cela qu’un critique doit faire, nous obligerait à admettre d’emblée que nous ne pouvons honnêtement témoigner, ou pour le dire autrement, d’une manière apparemment paradoxale, que notre lecture est incapable de témoigner d’elle-même ; pire, que notre lecture avoue seulement que nous ne savons pas lire. Ce qui n’est pas chose très plaisante. Nous allons donc, en assumant notre peu reluisante malhonnêteté, ne surtout pas nous demander en quoi ce livre pourtant lu nous ferait admettre que nous ne savons pas lire, et banaliser, comme on dit badiner, c’est-à-dire parler à côté, ne serait-ce que pour le plaisir pervers, qui ne compense au fond rien, qu’une critique, même débile, en existe quand même. Il ne s’agit bien sûr, de façon passablement ordurière, par un tel exercice, que de faire porter au livre en question le chapeau de notre incapacité, de reporter sur lui notre entière responsabilité. Le silence, donc, eût été préférable. Mais banalisons, donc. Et poussons notre évidente lâcheté jusqu’à mettre en situation, à notre convenance, notre propre lecteur, c’est-à-dire : vous.
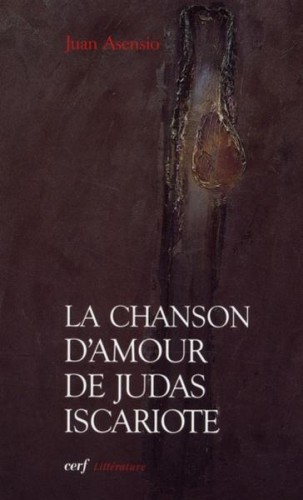
Voici l’image la plus nette de l’état de damnation, sous la plume de l’errant chérubinique :
« Vraiment pauvre est celui qui ne tend plus vers rien.
Que Dieu même se donne à lui, il ne Le prend. »
On m’objectera que, dans l’esprit de Silesius, il n’y a là rien d’autre que la nécessité extatique d’abolir, pour trouver Dieu, toute volonté propre. Rien d’autre encore qu’un paradoxal distique dont l’énormité de la proposition, en offrant à l’esprit du lecteur l’ascension du rugueux avers de la déraison, veut suspendre le fade processus de cristallisation de son contraire, et faire souffler sur la raison le vent froid de la folie.
Juan Asensio, La Chanson d’amour de Judas Iscariote