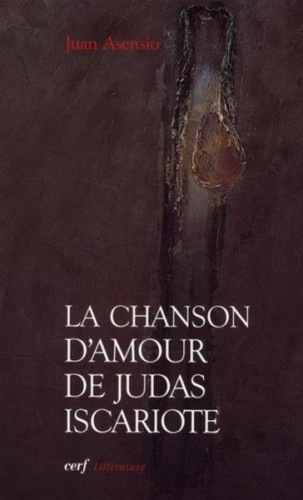
Il nous paraîtrait lourdement préférable, pour différents motifs qui ne lésinent pas à se contredire entre eux, de ne pas parler de ce livre. Témoigner de la lecture de ce livre, si c’est bien cela qu’un critique doit faire, nous obligerait à admettre d’emblée que nous ne pouvons honnêtement témoigner, ou pour le dire autrement, d’une manière apparemment paradoxale, que notre lecture est incapable de témoigner d’elle-même ; pire, que notre lecture avoue seulement que nous ne savons pas lire. Ce qui n’est pas chose très plaisante. Nous allons donc, en assumant notre peu reluisante malhonnêteté, ne surtout pas nous demander en quoi ce livre pourtant lu nous ferait admettre que nous ne savons pas lire, et banaliser, comme on dit badiner, c’est-à-dire parler à côté, ne serait-ce que pour le plaisir pervers, qui ne compense au fond rien, qu’une critique, même débile, en existe quand même. Il ne s’agit bien sûr, de façon passablement ordurière, par un tel exercice, que de faire porter au livre en question le chapeau de notre incapacité, de reporter sur lui notre entière responsabilité. Le silence, donc, eût été préférable. Mais banalisons, donc. Et poussons notre évidente lâcheté jusqu’à mettre en situation, à notre convenance, notre propre lecteur, c’est-à-dire : vous.
… mon semblable, mon frère
Le livre est devant vous. Il a pour titre La Chanson d’amour de Judas Iscariote. L’auteur en est Juan Asensio. L’éditeur est Cerf, la collection Littérature. La couverture est belle ; elle reproduit un détail d’une peinture de 1977, Crocefisso, de William Congdon. Vous déduisez de cela un certain nombre de choses : éditeur religieux, chanson d’amour, Judas, crucifixion. D’autres choses encore, selon que l’auteur vous est ou non connu, et ce que vous pouvez bien en penser. Mais enfin, c’est un livre. Comme tant et tant d’autres. Et il n’est pas bien gros. Cent vingt-six pages. Quelque goût des Anciens ou mépris des Modernes, à moins que ce ne soit l’inverse, ou pire, quelque défense inspirée de l’égalité de tout devant rien que vous affichiez, vous êtes un lecteur moderne, c’est-à-dire pressé. Peut-être même pressuré. Vous vivez d’ailleurs, que cela vous plaise ou cuise, dans une recherche permanente d’informations, en quête jamais vraiment atteinte, non sans raison, de ce qu’il faut savoir, dire, peut-être même penser, et cela affecte, plus ou moins consciemment certes, la façon dont vous lisez, même les romans. Qu’est-ce que cet écrivain va me dire qu’il pense du monde, de la société dans laquelle je vis ? Est-ce que je suis d’accord, pas d’accord ? Est-ce que ce qu’il dit est important ? Me convainc-t-il où je ne suis pas d’accord ? M’emporte-t-il ? Me ravit-il ? Au contraire, crime des crimes dans un monde abandonné à la vitesse, m’ennuie-t-il ? Quand bien même vous sauriez, ou plus exactement répétiez, qu’un roman est une œuvre d’art, une fiction, c’est-à-dire, presque canoniquement, un mensonge qui dit la vérité sur le mensonge ; que ce n’est pas simplement, que l’on y traite de la dernière mode ou de la géopolitique du futur, du journalisme avec des personnages ; que ce n’est pas d’abord une source d’informations, ou pas une source d’informations comme les autres, vous avez tendance à les lire d’abord ainsi, toujours à la recherche de ce qu’il faut penser et du monde et de vous, même ceux que vous trouvez… comment dire ? bons. Peut-être même surtout ceux-là, d’ailleurs. Car il faudrait être fou, dussiez-vous dire le contraire en société pour satisfaire à je ne sais quelle idéologie intellectuelle, pour ne pas dire commerciale, pour vouloir lire un roman qui ne serait pas bon, qui, mieux, ne vous serait pas bon, bon pour vous, agréable jusque dans les affres narrées, c’est-à-dire stimulant, ces stimulis devraient-ils vous mener, palier après palier, jusqu’à quelque extase débile secrètement espérée qu’il demeure de bon ton, esprit critique oblige, de relativiser aussitôt, avec une mauvaise humeur ressemblant à s’y méprendre, dans la douleur qui s’y trahit, à une descente de shoot. Ce qui ne vous incite pas pour autant à renoncer au dogme moderne, passablement illusoire pourtant, que la littérature, et même la culture en général, rendent plus lucides – car en ces matières comme en toutes, il faut toujours plus de plus, ainsi que l’avait formidablement formulé Philippe Muray – sur le monde et sur soi. Vous hurleriez de laisser même entendre en société que vous vivez en somme votre vie de lecteur moderne sous cette institution confortable des « Droits imprescriptibles du lecteur » – véritable arche imbécile scellant l’alliance, par-dessus la tête d’auteurs injustement idolâtrés, de l’éditeur et du lecteur – qu’avaient torchés jadis le fade Daniel Pennac dans le très symptomatiquement intitulé Comme un roman. Ces « romans » qui disent tous exactement la même chose, vous les connaissez tellement par cœur, comme un enfant sa récitation, que vous pouvez les lire la main devant les yeux, l’ôtant parfois pour vérifier, tout de même, que tout est bien en ordre, que vous les savez déjà bien… Vous n’êtes pas du tout prêt à admettre, vous, lecteur assidu de nos romans modernes, véritable terminal de l’industrie du livre participant en aveugle du règne statistique, que le premier péquenot de paysan quasiment illettré et muni de son simple solide bon sens en sait peut-être plus long que vous sur cette effroyable chose que l’on appelle la vie, que vous fuyez dans les livres en daubant qu’il est tout de même incommensurablement plus atroce que lui la fuie vulgairement devant sa télé ; et encore moins que son silence est incomparablement plus sage que votre incessant pépiement de type qui a son avis sur la question, comme aussi sur toute autre, bavardage cachant à peine que vous êtes considérablement paumé à force de chercher partout ces certitudes d’opinions qui seraient salvatrices, imaginez-vous, si elles ne se dérobaient incessamment – alors précisément que là se trouve leur fonction propre, celle qui justement vous doit pousser à la consommation, junkie cherchant sa dose. Seulement voilà, cette inavouable et pourtant bénigne divagation sur le roman, vous fait comprendre tout à coup que, justement, vous ne trouvez nulle trace, aux premières pages ou à la quatrième de couverture, de quoi que ce soit indiquant quel est le genre de cette Chanson d’amour de Judas Iscariote.
Alors quoi ? Un roman ? Un essai ? Un poème ? Un drame ? Ce n’est pas écrit. Faut-il se fier au titre, alors, et penser qu’il est dépositaire du genre ? Un coup d’œil à l’intérieur du livre vous fait bien comprendre qu’en fait de chanson d’amour, on est loin d’Edith Piaf, ou de qui vous voulez. La première phrase de la présentation, en quatrième de couverture, parle de « texte déroutant à bien des égards ». Va pour « texte », alors. Dénomination plancher pour un bouquin sans images. Tant pis. Pourvu tout de même que cette « chanson d’amour » vous dise quoi penser, avec ou contre elle, peu importe, de Judas Iscariote. Et éventuellement, pour les soirées de discutes à bâtons rompus entre gens qui se comprennent, de ce Juan Asensio… Peu importe, pour l’heure. Cent vingt-six pages. Vous en avez au max pour deux heures. Ouais.
Avertissement
La première page est un vrai tir de barrage. Rafale de quatre citations. T.S. Eliot. Mario Brelich. Dominique Autié. Paul Gadenne.
L’avertissement – deux pages – suit, amenant quelques explications préliminaires à ce « texte déroutant ».
Mais les explications sont, elles aussi, déroutantes. Tout le corpus d’œuvres évoquant Judas, des Evangiles à nos jours, sert ici de « façade » à une « méditation angoissée sur l’exigence propre de la parole que doit mener à son terme absolu (…) », le mutisme plutôt que le silence, « celui qui fait acte d’écriture (…) ». Rien que ça.
L’auteur ajoute : « On jugera sans doute que l’extrême prétention de la tâche n’a d’égale que l’apparente faillite de l’entreprise. » Selon lui-même, l’auteur n’aurait donc pas failli à sa tâche au moins herculéenne, et il s’en trouve assez satisfait pour, au lieu de le taire, nous en prévenir en préambule par la délicate épithète qualifiant la faillite, laquelle nous eût servi sans doute de prétexte à lire le livre à charge si nous ne l’avions immédiatement mise en balance avec ce « on jugera » ouvrant la phrase, et qui, lui, semble nous avoir déjà prévu. Outch.
Sont ensuite nommés – second tir de barrage – Gadenne, Roberto Calasso, Rimbaud, Lautréamont, Albert Camus, Reimarus, Klopstock (qui sont ces deux-là ?), De Quincey, Maître Eckhardt, Angelus Silesius, T.S. Eliot, Faulkner, Shakespeare, Claudel, Perutz, Pagnol, Caillois, Celan. Bien. Pour nous dire quoi ? Au moins cette clé que le pastiche « est la perspective de lecture qu’il faut toujours garder à l’esprit », ce qui est tout de même bon à savoir ; qu’un « passage » inspiré des deux auteurs qui nous sont, même de noms, inconnus nous livrera un « monologue de Judas » ; que dans le livre, que nous les reconnaissions ou non, nous allons « frôler voire croiser » les auteurs susmentionnés (entre autres) ; qu’un certain nombre de citations ne sont pas traduites. « Plus un texte est beau, plus il est intraduisible ».
L’avertissement s’achève sur cette phrase : « Pour le reste, je suis bien certain que chaque lecteur apportera à ces pages sa parcelle de science ». L’ironie, ici, est tellement profonde qu’elle peut même ne pas du tout apparaître.
Les dates d’écriture de cet avertissement, qui valent peut-être pour le livre entier, laissent apparaître douze années, de 1997 à 2009. Manière de laisser entendre, peut-être, qu’à cent vingt-six pages en douze ans, on est très loin de ces contractuelles deux cent vingt-quatre pages annuelles ou bisannuelles permettant aux pondeurs de romans de nous bégayer quarante annuités de long leurs inepties récréatives.
Cet avertissement donne certes quelques explications ; mais surtout, il fait formidablement bien son boulot d’avertissement, qui est, comme chacun sait, de dissuader.
Vous qui entrez, laissez toute espérance
Quoi de mieux, vous dites-vous peut-être, que la première phrase, l’incipit tant aimé et tant craint, tellement travaillé parfois qu’il est plus intéressant que tout ce qui le suivra et qu’il peut ainsi ruiner tout un bouquin même piètre, pour se faire une idée d’où l’on met les pieds, pour être un peu éclairé sur le type d’ouvrage que l’on s’apprête à lire ? Celui-ci est foutument abrupt, et si l’espoir vous était jamais venu d’en apprendre davantage sur le ou les personnages, vous en serez carrément pour vos frais, cette question vous étant d’emblée renvoyée, miroir somme toute peu engageant :
« Qui suis-je donc ? »
Si vous ne saviez pas qu’il devrait être quelque part dans ce bouquin question de Judas Iscariote, l’homme de la Vendition, pour parler comme Léon Bloy, du Christ, cette première phrase au fumet cartésien, ergo compris, qui fait office de premier paragraphe vous ferait presque jeter l’éponge ; mais enfin, la question étant lancée, vous voulez connaître un peu la réponse ; laquelle ne tarde pas :
« Je suis l’écrivain de la nuit. »
Là, sérieusement, votre capacité à l’abusion commence à faire défaut et vous ne savez s’il est préférable de penser l’auteur d’une prétention à couper le souffle, ce qui peut provoquer un rire, ou plus réalistement, un hoquet, ou d’une puérilité tellement hyperbolique que les marchands de livres désespèreraient de trouver un public suffisamment crétin, et Dieu sait que l’engeance ne fait guère défaut, auquel intuber d’un coup son contenu ; du moins est-ce là ce que vous vous diriez si cette réponse n’était pas précédée de cette simple phrase préventive :
« Autant répondre sans faire de manières, puisque je n’ai pas peur du ridicule. »
Ce commencement vous paraît donc extrêmement décevant, mais pour ainsi dire volontairement décevant, comme l’avertissement avait été volontairement dissuasif. Ce qui, donc, à la fois réussit et échoue. Et mieux, stimule votre curiosité.
Oui, qui est donc ce narrateur – Judas ? –, à moins que ce ne soit l’auteur lui-même, qui prend volontairement ce parti insensé de décevoir d’emblée, et, si j’ose dire, de trahir son lecteur en jouant de l’effet de surprise ? La réponse, après quelques phrases fleuves évoquant Rimbaud, Napoléon, le Songe de Poliphile ou le froid dans lequel il écrit, vous arrive enfin : cet « écrivain de la nuit » passant sans ambages du je au il, est un vulgaire romancier qui plaît aux femmes, et raconte, avec des détours insensés, comment, même s’il ne sait plus très bien si cette rencontre n’est pas un rêve, il a fui une femme qui l’aimait et qu’il aimait, la réservant en quelque sorte à devenir le personnage d’un prochain roman dont la trame, somme toute navrante, nous est livrée. Romancier qui, s’étant enfui, de peur, n’a pas même songé à en finir. « C’est ainsi qu’il s’est enfui car il a eu peur, d’une femme bien plus que de sa propre mort. Comme Judas j’ai eu peur de trop aimer, d’aimer tout simplement. »
Ainsi finit ce premier passage – page 19 –, et la belle citation de Perutz évoquant le péché de Judas quelques pages plus haut ne suffit pas à dissiper un vague malaise, un accroissement de la déception : Comment, cela ne va donc être que cela, une prétentieuse autofiction de plus, et singulièrement tirée par les cheveux au surplus, cette Chanson d’amour de Judas Iscariote ?
Eh bien, non, en fait. Pas du tout.
Je est Légion
Et puis quoi, il est sans doute inutile ici de séparer l’auteur du narrateur, chaque passage, puisque c’est ainsi que sont nommés dans l’avertissement ces quelques lignes ou paragraphes séparés par une étoile, raconterait-il une histoire aussi piètrement banale que celle de ce romancier trahissant son amour, venant scruter la ténèbre à la recherche de la figure du traître Judas, l’homme qui vendit pour une poignée de sicles ou deniers rien moins que la Parole, et qui la livrant, la sauva, chaque passage, oui, sans tellement se soucier du précédent, se glissant pour ainsi dire à l’intérieur d’une de ces interprétations déjà écrites de l’acte de Judas, revisitant ainsi du dedans sur un mode aussi sérieux que parodique – pastiche, nous a averti l’auteur – tout ce chaos des interprétations ; de telle manière que l’ensemble, tournoyant sans cesse autour d’un centre insaisissable, et repassant, mais sur des axes différents, par des points déjà évoqués, quitte à se contredire sans avertissement ni gêne manifeste, semble finir par les accepter toutes, ces interprétations, n’en refuser aucune, et finalement les renvoyer ainsi, toutes, une à une, à leur chaos, faisant émerger malgré tout un bien trouble Judas, tellement moderne qu’il finit même, à force de mystère et de banalité mêlés, par nous apparaître pour ce qu’il est peut-être en effet, dans ces temps qui ne cessent de plastronner la mort de Dieu, le seul modèle incessamment, inconsciemment, proposé à notre Imitation.
Cette figure trouble, dont les traits ne se dessineront pas nettement, n’apparaît finalement, de façon littéralement paradoxale, que de ne pouvoir être fixée, arrêtée, dite. Judas est ce négatif même que la parole ne peut atteindre, comme un Christ noir, parce qu’aucune certitude, aucune formulation ne tiennent face à lui, porteur se dérobant toujours de cette trahison de la parole ayant permis son sacrifice et sa résurrection, et se perdent dans ce chaos des interprétations, dans cette contradiction incessante à tous les possibles ouverte et trouvant son initiale dans le Nouveau Testament, finalement peu disert, qui parvient à donner à Judas même deux morts – l’une par pendaison après qu’il a rendu le salaire de sa trahison, l’autre les entrailles soudain se vidant dans ce champ acquis avec ce maudit argent –, morts entre lesquelles, déjà, il n’y a aucune raison de trancher… Que ce je qui s’est peut-être réellement assigné, comme il le dit, le but ridicule de tout lire à propos de Judas, ce je qui passe par tant d’états, ce je qui n’est pas seulement un autre, selon la formule rabâchée de Rimbaud, mais qui semble ici être légion, opposant ainsi au « je suis qui je suis » du Dieu de L’Exode le « mon nom est Légion car nous sommes nombreux » du Satan des Evangiles ; que ce je, donc, s’échine à nous causer de gnous intelligents (oui), fasse parler Judas lui-même, pastiche ce même Rimbaud, traître dérisoire à la bavarde marâtre littérature, ou Camus et le Jean-Baptiste Clamence de La Chute, se fasse baleine, rendant hommage à Gadenne ou Melville, file et trame de macabres, pénibles métaphores romantiques pleines de pourritures et de carcasses, images exactement inversées de notre monde publicitaire où il fait toujours beau pour que les filles soient bronzées sur les affiches, ce je échoue toujours, ne serait-ce même que de parler ou, en l’espèce, d’écrire et d’être écrit – et pas seulement parce que, comme le dit Trakl, la poésie ne sert à rien parce que le Christ a existé, et parlé.
« J’ai échoué dans ma tentative, c’est certain, puisque j’écris. » (p. 61)
Phrase assez formidable, écrite au moment de pasticher le déserteur Rimbaud – la référence est assez claire, ici – et trouvant son écho en maints autres points du livre :
« Certes, il est vrai que je suis, comme tant d’autres qui n’ont rien à dire et qui font pourtant de cette absence de raison le motif de leur écriture, tant il est vrai que la maison Littérature est un bordel de vieilles filles rabougries comme des racines de belladone, un bavard, un incorrigible bavard, je ne suis même que cela, un homme qui ne sait pas se taire. » (p. 70)
« Si je veux bien plonger pour voir à quelle profondeur la lumière est dévorée par les ténèbres, c’est uniquement à condition que je puisse remonter à la surface le plus rapidement possible.
Je m’intéresse à l’histoire des damnés et à celle de leur père mais à la condition expresse que ma peur soudaine puisse être jugulée par le simple fait de refermer le livre que je lis.
En un mot, je suis un pleutre.
Si j’ai lamentablement échoué dans la tâche que je me suis donnée, trahir la marâtre littérature, c’est pour la simple raison que j’ai eu peur et que, flairant de loin, l’horrible vérité, j’ai tout simplement reculé. » (p.36)
Qui parle ici ? Et quelle quantité d’épithètes accablantes ou élogieuses ne pourrait-on pas accoler à ce je, selon ce que le lecteur voudra bien prêter, de sincérité ou de calcul, de naïveté ou de perversion, à qui parle ! « L’écrivain de la nuit » étalé là en plein jour ?
Morfil
Ce personnage qui avoue donc s’être donné pour but de lire tout sur Judas, ou le prétend, tel une borgésienne bibliothèque, est-il l’auteur ? Question certainement oiseuse. Comment pourrait-il au demeurant, quel qu’il soit, supposer qu’une allusion ici, en quelque incunable ou en quelque livre non publié ou non traduit en français, pour ne pas même évoquer ce qui sera écrit dans les temps futurs, lesquels donc, ce livre étant, ont commencé, ne lui a pas échappé ? Sauf à prétendre, mais silencieusement cette fois, que la spirale, le vortex, le trou noir qu’est cette Chanson d’amour de Judas Iscariote, ou de Juan Asensio, inclut aussi ce qui viendra, puisque ce qui viendra aussi fondra en tournoyant vers cette insondable ténèbre qu’est la face maudite de Judas. N’en demeure pas moins que les références innombrables du livre, qui eussent pu faire le lit de quelque insipide thèse universitaire de quatre mille pages, ne peuvent sans doute pas être lues, ni comprises, par un lecteur seul, fût-il quelque peu équipé ; et quand bien même il se trouverait de par le vaste monde un hypothétique lecteur ayant lu également « tout sur Judas », il y a fort à parier qu’il n’en aura pas compris ni retenu la même chose, etc… (Peut-être, quelque jour tout à la fois à craindre et espérer, toutes les références – comme si elles n’étaient que cela – de ce livre seront-elles répertoriées, inventoriées, balisant la lecture, la facilitant et la normalisant, permettant à ce livre d’être, enfin ! lu à côté, comme un objet déjà connu, dont on sait par avance quoi penser.)
On peut lire ce passage, p. 119, qui s’ouvre sur le nom d’Agesilas Santander [1], sans savoir que ce dernier, anagramme de « Der Angelus Satanas », provient peut-être de Walter Benjamin, mais il est certain que reconnaître ce motif dans la trame vient éclairer autrement la lecture. Pas moyen, même, d’avoir idée de l’ampleur de ce qui nous échappe, avec ces mots qui, tous, ont servi mille et mille fois, et la lecture de ce livre réduit le lecteur à son je propre, étique.
Aussi dirai-je, quelque mauvais lecteur que je sois en effet, perdu dans les tours et détours du mensonge infectant ce texte, non moins que toute parole, que la pointe la plus acérée, ou son tranchant, de ce texte tient dans la lecture que fait le narrateur de ces deux vers de Silésius ; où ce dernier dit « la nécessité extatique d’abolir, pour trouver Dieu, toute volonté propre », le narrateur trouve, lui, « l’image la plus nette de l’état de damnation » :
« Vraiment pauvre est celui qui ne tend plus vers rien.
Que Dieu même se donne à lui, il ne Le prend. »
Ce n’est pas rien du tout, loin au-delà même de toute sociale « question religieuse », que le salut et la damnation se puissent dire par exactement les mêmes phrases ; s’éclairent ici ces propos répétés dans le texte, donc, sur le mensonge et sur la vérité, vérité perdue et sur laquelle parier (« Y ai-je, d’ailleurs, jamais cru ? » p.34), ainsi que sur la littérature, la fiction, qui n’est peut-être pas, comme on le répète l’air finaud, « mensonge qui dit la vérité sur le mensonge », mais mensonge mentant encore sur le mensonge, redoublant la ténèbre, et justifiant cette conscience que toute écriture, et de toute façon, signe l’échec même de ce pari. De sorte que rien en définitive ne nous assure, malgré le titre de l’ouvrage, la réputation peut-être de son auteur, et son éditeur même, que nous ne tenions pas entre nos mains un livre considérablement plus athée qu’il ne le semblait à l’abord.
Car cette épée de la parole, même forgée de mensonge, ne tranche qu’à l’endroit où elle est la plus fine, pour ainsi dire à l’endroit où elle cesse, devient absente, à l’endroit où ces deux faces du même mensonge disparaissent ; par quoi il lui faut bien une pauvre meule pour y être affûtée, et quelque morceau de cuir, ou de papier, où déposer la limaille, le morfil.
… mon semblable, mon frère (2)
Ah, pardon, c’est vrai, vous vouliez peut-être seulement savoir si nous vous recommandions ce petit livre à la noirceur étincelante ?... Comment vous dire ? J’ose à peine.
[1] Oh, je ne suis pas bien fier, j’ai trouvé cette information-là sur internet ; bizarrement il y est toujours question d’Agesilaus Santander, alors qu’Asensio écrit Agesilas, et je ne sais pas du tout à quoi attribuer cette différence d’une voyelle…