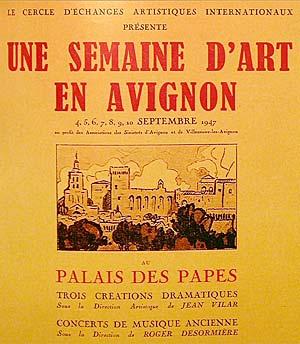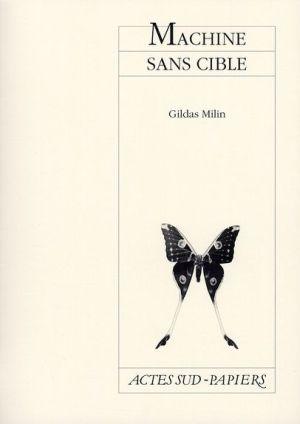En bien voilà, il y a sept personnes dans une pièce un soir d’été, réunies là par l’une d’entre elles, Rodolphe, qui veut les faire causer autour de ce thème : « amour et intelligence » ; et que ça vous serve d’intrigue…
Détaillons (la pièce commence page 9, finit page 69, la numérotation ci-dessous est de mon fait) :
1. D’abord, on branche les microphones, on cherche une rallonge pour brancher un minidisque, on dit bonjour à ceux qui arrivent, bise ou pas bise, on apprend que Rose sera en retard et qu’il va falloir causer au débotté d’amour et d’intelligence, on se demande s’il faut ou non ouvrir la fenêtre, ça prend dix pages (pp. 9-18).
Voici les neuf premières répliques :
MARC. – Alors ?
MORGANE. – Alors tape dans ton micro alors ?
MARC. – Un deux
Marc tape dans ses mains.
MORGANE. – Ah ba d’accord
MARC. – Un deux
MORGANE. – Voilà
MARC.- Ca module ?
MORGANE. – Ca module bien hein c’est bien, cool, Déborah ?
DEBORAH. – Un deux ça va ça module ?
Rires
Autre extrait, page 17 :
MARC. – L’amour et l’intelligence ? Ouah
JULIA. – C’est vaste
ERIC. – Ouais c’est vaste
MORGANE. – Ben on n’est pas rendus tu veux que ça dure combien de temps ? Parce que l’amour et l’intelligence
DEBORAH. – Amour intelligence OK
ERIC. – Amour intelligence OK
MARC. – Amour intelligence
MORGANE. – Amour et et et intelligence ouais
ERIC. – Amour intelligence mais ouais.
JULIA. – On y pense je ne sais pas mille fois par jour mais on n’a pas finalement tellement l’habitude de
ERIC. – D’en parler
2. La lecture de la conversation est interrompue par un poème plus niais que naïf, mais bon (p. 19).
3. La conversation reprend où elle en était, on redit qu’on va parler de l’amour et de l’intelligence parce que Rodolphe écrit un truc là-dessus en ce moment, les gens qui tous se connaissent se présentent puisqu’on enregistre, on décide de faire un café, ça prend six pages (pp. 20-25).
4. Suivent deux poèmes dont le premier est lisible et idiot, le second étant idiot et illisible (pp. 26-27).
5. On se demande si on peut fumer en prenant le café, puis on se dit qu’il faudrait parler d’amour et d’intelligence, ça prend trois pages (pp. 28-30).
Extrait, pages 28 et 29 :
JULIA. – Euh : un truc
(Elle rit.)
Non parce que j’étais en train de me dire est-ce que tu vas nous demander de définir amour et intelligence et je me disais si c’est le cas ça va être très très dur
RODOLPHE. – Non non c’est pas en termes je dirais que c’est pas en termes de
JULIA. – Enfin en soi en soi
RODOLPHE. – C’est pas en termes de définition c’est plutôt en termes de
ERIC. – Ressenti
RODOLPHE. – D’éprouvé de directions multiples de de de sens mais au sens comme ça sensible multidirectionnel
6. Poème débile archi-bégayé dans lequel on apprend, en somme, que les yeux voient et que les oreilles entendent (pp. 31-32).
7. Eric raconte une anecdote sans intérêt, sa parole commence d’être gagnée par le même type de bégaiement sévère que celui des poèmes, ça prend deux pages (pp. 33-34).
8. Poème débile, mais bref (p.35).
9. Et c’est reparti, mon kiki. On déluge quelques banalités sur l’amour, puis on se demande s’il faut appeler Rose qui n’est toujours pas là et Gildas dit qu’il sortira plus tard pour l’appeler, les paroles sont de plus en plus mangées de voyelles, de répétitions, de glossolalies casse-couilles, amour et intelligence toujours, Gildas au bout d’un moment part effectivement téléphoner à Rose qu’il ne parviendra pas à joindre (p. 44), pendant ce temps Rodolphe a sorti un robot d’un carton et explique qu’il est programmé pour se déplacer aléatoirement, les personnages intercalent des poèmes sans poésie ni raison dramaturgique évidente, Rodolphe explique une expérience de ou d’après Konrad Lorenz, laquelle est, semble-t-il, le nœud de la pièce : ce n’est pas à leur mère en tant que telle que les poussins s’attachent, mais à la forme qui bouge près d’eux (et qui, généralement, en effet, se trouve être leur mère)… On se demande si la réciproque est vraie, et Rodolphe explique que ce robot a servi à l’expérience suivante : une fois que le poussin s’est attaché au robot parce qu’il est la forme qui bouge près de lui, et qu’il le suit partout, ce poussin est enfermé dans une cage de verre, et l’on regarde si le robot s’est lui aussi attaché au poussin, et la réponse est oui, ça alors, non c’est pas vrai, on est page 57. Là, on enchaîne bien sûr sur le psychophysique (ou paranormal) et on décide de jouer à attirer mentalement (!) à soi le robot programmé pour se déplacer aléatoirement. On installe donc des feuilles pour bien suivre le trajet du bidule électronique à roulettes, on se demande avec profondeur s’il vaut mieux être groupé ou séparé, quand un téléphone sonne pour nous apprendre que Rose finalement a eu un accident, qu’elle est à l’hôpital, qu’il va falloir ou pas l’opérer, hémorragie interne, tout ça. On décide donc de lui rendre visite immédiatement tous ensemble, on compte les places dans les voitures, il en manque mais en se serrant… Mais pas Gildas. Gildas ne veut pas. Gildas refuse. Gildas, l’ami d’enfance de Rose, pourtant ; on est page 64. Bon. On décide que de l’hôpital, on l’appellera tous les quarts d’heure, le Gildas. Tout le monde part donc sauf Gildas, qui se met à parler pour dire des trucs imbittables jusqu’au moment où apparaît « une forme holographique » qu’il prend pour Rose et à qui ou quoi il demande de répéter ces mots profonds :
je suis vivante – répète – je suis vivante – je fais partie des vivants – voilà c’est bien – je fais partie des vivants je veux vivre je veux vivre je veux vivre je veux vivre je veux vivre
Puis Gildas continue de parler n’importe comment, pour dire à Rose qui n’est pas là qu’il l’aime, il se trouve même intelligent, dirait-on, ce qui est erroné, et continue ses conneries jusqu’à ses quatre vers mirobolants, admirez la construction :
une promesse
une caresse
une promesse
une caresse
A ce moment-là, Gildas s’aperçoit que le robot est venu à lui malgré sa programmation de déplacement aléatoire, on vous laisse conclure et ce serait bête de le faire, la pièce est finie, on est page 69.
Page 70, il y a une notice sur la « création » de la pièce qui permet de comprendre que les personnages portent les prénoms des comédiens leur ayant donné chair. On eût peut-être, jadis, nommé cela un impromptu…
*
Cette pièce, Machine sans cible, est un chef d’œuvre, c’est évident.
D’ailleurs, elle fut jouée – enfin, « créée » – au Festival d’Avignon, en 2007. Et « commandée » par lui.
J’aimerais vous faire comprendre que je ne plaisante pas.
Il ne s’agit bien sûr pas d’art, il ne s’agit pas d’œuvre d’art.
Mais cette pièce, néanmoins, est un chef d’œuvre : elle est en elle-même, par ce dont elle traite, un chef d’œuvre de néant ; et par les moyens qu’elle utilise pour traiter cela, elle est un chef d’œuvre de néantisation.
Pour le dire autrement, Machine sans cible est symptomatiquement sommitale.
Par symptôme, je ne dis aucunement que cette pièce découvre ou traite un quelconque des nombreux symptômes d’agonie de notre « société » – ce qui, selon moi, devrait être aujourd’hui, plus que jamais, le rôle du théâtre –, je dis que ce théâtre-là, au contraire, est en soi-même symptôme, uniquement symptôme, tout entier symptôme.
Symptôme d’une société qui n’a plus rien à se dire, et qui donc le dit n’importe comment, sombrant au bavardage pur et simple, presque « hypostasié » s’il est permis de prendre le mot à contre-sens : car ce bavardage lui-même est « dépassé » par une désarticulation de la langue et, si j’ose dire, une désyllabisation de la langue. Et tout cela avec une complaisance de petit-bourgeois salopiste.
Ce n’est pas une dénonciation du nihilisme – ce qui eût requis des prodiges d’humour, à la Feydeau par exemple –, non, c’est une illustration du nihilisme actif, laquelle tourne à l’apologie, c’est-à-dire : à l’abjection.
C’est une exhibition du néant, une masturbation du néant, et finalement une impuissance totale.
C’est le triomphe du néant.
Cela mérite qu’on s’y arrête. Ce n’est pas rien, ce triomphe du néant. Ou plutôt : ce n’est pas seulement rien, c’est également l’avenir.
Parce que dans ce symptôme complaisamment, pornographiquement étalé là, on trouve toute la modernité. Et si ce n’est pas tout à fait tout, on passe vraiment à la limite.
Comme l’édition du texte donne un sorte de préface intitulée « Au lecteur » et un entretien en guise de postface, je vais m’en servir.
Deux extraits, significatifs, d’ « Au lecteur » :
« Des êtres humains sont là, capables d’avoir une visée ou un ensemble de visées sans but. Entre nous, on parle de l’amour, de l’intelligence, de la nature de ces qualités, de leurs écarts, de leurs rapports. Comment produire, entre les personnages d’une fiction, dans le texte écrit comme dans la mise en scène, du sens qui ne soit pas défini, arrêté mais multidirectionnel, sans cible ? »
C’est très clair. Seul fait sens désormais ce qui n’en a pas.
Ce qui se traduit ainsi dans la « forme » :
« Ensuite, le texte écrit a, j’en réponds, une ponctuation bien étrange, singulière, et ne comporte, par exemple, aucun point. Pourquoi ? S’il est acquis, comme convention, que le point permet au lecteur de comprendre qu’on est arrivé quelque part et qu’il est temps de « fermer le sens » avant de repartir, je ne vois comment laisser un seul point alors que je « n’entends » jamais « la fin du sens », pas même la fin d’une représentation. »
C’est insuffisant. Pourquoi des points d’interrogation ? Pourquoi des virgules, des tirets ?
Pourquoi séparer les mots les uns des autres, alors ? N’est-ce pas là encore une convention, le blanc entre les mots permettant de les identifier facilement, et de les laisser prendre leur sens dans la phrase, laquelle finit parfois, même sans point, par avoir un sens, même fluet, même ridicule.
Milin rêve d’écrire sans phrases. D’un autre côté, il ferait mieux. Sans phrases, sans stylo, sans ordinateur, sans papier, sans dictaphone, sans rien. Il ferait mieux de ne pas écrire ; et c’est ce qu’il fait au fond, mais il le fait en pisse-copies, c’est-à-dire finalement avec un ressentiment monstrueux, une sorte de haine sourde de toute littérature.
Mais cette destruction du sens, et de la langue, ne saurait être ramenée à une chose de pure forme. Non. C’est un projet de fond.
Le thème annoncé de la pièce, amour et intelligence, n’est jamais réellement traité, ni par les personnages, qui bavardent imbécilement autour, ni par l’auteur, qui amène brutalement sa propagande idéologique.
La parole n’a finalement aucune importance, ne reçoit réellement, malgré les fréquents retours à la ligne, aucun traitement dramaturgique ou poétique. On sombre dans le vérisme le plus plat, avec des justifications ineptes d’intello à deux sous. Tout le texte, sauf peut-être les bégaiements glossolaliques à la con, ressemble à cet enregistrement en prise directe qu’un transcripteur quelconque se serait refusé à ponctuer.
Dans l’entretien, lui aussi admirable de complaisance, Milin nous renseigne :
(…) l’on suit la fiction sur un mode beaucoup plus simple, beaucoup plus linéaire : une seule dimension, une seule soirée, un seul lieu, du moins en apparence.
En effet.
Un autre morceau, révélateur, de l’entretien – évoquant la déclaration d’amour finale :
Frédérique Plain. – Vous avez relu des passages célèbres de déclarations d’amour dans le théâtre ? Je pense, par exemple, à la déclaration de Ruy Blas, ou à Claudel…
Gildas Milin. – Non, pas spécifiquement, mais j’y pense. Ce passage de Ruy Blas, c’est sublime. Charlie Chaplin, Claudel, Musset dans On ne badine pas avec l’amour…
(Il cite Perdican :)
« J’ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j’ai aimé. C’est moi qui ai vécu, et non pas un être factice, créé par mon orgueil et mon ennui. »
C’est assez beau, en effet.
Prenons maintenant à son acmé la déclaration de Gildas (le personnage, hein, pas l’auteur) :
« c’est pour toi – c’est pour toi je je je vais – je vais te le dire – je – je meurs – je meurs d’émotion pour toi – je meurs d’émotion pour toi je – je meurs complètement d’émotion pour toi – je meurs d’émotion pour toi c’est ça c’est – c’est exactement ça je je je je je ne sais pas comment c’est ça que je veux te dire je meurs d’émotion pour toi c’est pour toi que je meurs – d’émotion – c’est pour toi c’est toi que j’aime – je t’aime »
Outre que le personnage semble s’adresser à lui-même la déclaration qu’il aimerait que Rose (qu'on suppose mourante) lui fasse ou lui ait fait, à moins qu’on ne marche dans la combine occultiste qui voudrait que, par je ne sais quel entubage psychophysique (ou paranormal), Rose parle vraiment par Gildas, il faut avouer que nous avons là, stylistiquement, un extrait conforme de la belle langue de notre siècle.
Ce sont les outils même du théâtre, des outils assez classiques, que réunit Milin, mais il ne les réunit que pour les mieux anéantir, annihiler. Il néantise le théâtre.
Aucune intrigue viable.
Aucun conflit.
Aucune langue.
Des personnages interchangeables.
(Tous ces gens sont gentils, sociables ; ils sont sympas, en un mot ; ils ont même l'air innocent ; ce sont de grands enfants et leur perversité, en bonne logique, ne paraît pas d'abord. Elle ne paraîtra pas, d'ailleurs : toute leur belle innocence sympa est au service d'une perversion de fond, d'un mode d'ampleur immense...)
Une égalité stricte, en somme. On comprend mieux que la femme absente s’appelle Rose : elle est un programme politique.
Laquelle égalité, sur le fond, est poussée jusqu’au bout :
L’amour est un réflexe neurobiologique.
L’intelligence, quand elle est, est artificielle.
L’homme est l’égal du poussin.
La machine est l’égale de l’homme qui est l’égal du poussin.
Le poussin, l’homme et la machine sont des machines.
Des machines sans cibles.
Ce qui définit finalement la vie même.
La parole n’a pas de sens.
La vie est la vie nue (lisez Agamben).
Tout est multidirectionnel, c’est-à-dire insensé.
Commandé seulement par des forces machiniques, fussent-elles biologiques.
Ces forces nous échappent.
Echappent mêmes aux lois de programmation.
Car nous sommes des programmes, exclusivement, c’est certain. Et le reste (psychophysique, paranormal) nous échappe, naît de l'interaction entre machines.
La psychophysique est une science (versant occultiste du programme socialo-égalitariste).
Les machines ont deux positions : on/off.
Ainsi sont-elles vivantes ou mortes.
L’esprit lui-même n’est qu’une émanation du monde machine.
Il permet les interactions machine/machine. Le principe d’incertitude d’Heisenberg n’est pas loin, et l’observation qui influe sur la chose observée… Toute la physique quantique, mais comment dire : hors proportion, hors sujet. Délire scientiste…
Il n’y a pas de différence réelle entre les formes machiniques animales, les machines prétendument humaines et les machines créées par le prétendu homme.
(Je regrette que l’égalité de l’homme et de la plante verte ne soit pas évoquée, j’aurais enfin ri.)
Etc.
Et le texte finalement, point ou pas point, n’a qu’un seul et unique sens, mais si pauvre, si malingre, si chétif que ses chances de survie sont absolument nulles ; au point que l’envie d’interrompre la lecture, de fermer ce livre inepte est immense, et qu’il faut un courage confinant au masochisme pour s’appuyer jusqu’au bout une telle accumulation dérisoire de lieux communs navrants et, à leur insu, criminels.
Je ne vois là rien qui ne soit pas banal, tellement la haine du théâtre, la détestation du texte, la négation du verbe sont grandes – et grandement encouragées, aussi – chez ceux qui en font aujourd’hui profession…
Cette adéquation malgré tout entre le fond et la forme est tout à fait rigoureuse, tout à fait exemplaire de la saloperie à l’œuvre partout dans notre monde. Voilà pourquoi, dans son genre imbécile, Machine sans cible est un chef d’œuvre.
La seule vraie réussite de ce texte, au fond, c’est son titre, qui donne par ailleurs la mesure de l’humour de son auteur.
La machine sans cible, c’est l’homme selon Milin, c’est l’homme quand il ne lui demeure plus rien d’humain.
C'est l'homme qui désincarne le Verbe.
C’est l’homme qui vient, au fond.
L’invertissement bat son plein.