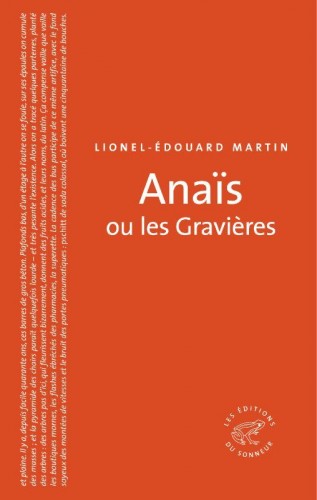
Les morceaux qui suivent ont été écrits séparément, dans la dizaine de jours qui a suivi la lecture ; ils ne constituent pas à proprement parler une critique, même après que leur saisie informatique m’a fait les remanier légèrement : ces corrections m’ont plutôt semblé accentuer les défauts et les imprécisions – tant pis.
*
Je m’aperçois, deux jours après avoir fini ma lecture, que si sa marque est encore vive et fraîche en moi, déjà je ne peux plus me faire une idée précise du déroulé chronologique de ce roman ; non que, d’aspect policier au surplus, l’intrigue soit particulièrement complexe, mais plutôt qu’elle ait été défaite en se faisant, ou faite sur sa défection propre – et partant, rendue à son écriture même. Par association, je pourrais évoquer pour qui veut l’ouvrage de Pénélope, mais sans partir pourtant si loin d’Homère, je préfère m’en remettre à mon étique souvenir, que la lecture d’Anaïs ou les Gravières a je ne sais comment fait surgir, de la conférence – si c’en est bien une – que donne Stephen Dedalus sur l’Hamlet de Shakespeare dans Ulysse de Joyce : il y est question d’Hamlet dont le père a été assassiné – ou non, d’ailleurs – et de ce que c’est cela précisément qu’écrit un William Shakespeare qui, lui, vient d’enterrer son propre fils, prénommé Hamnet.
Il n’est pourtant pas question ici de lier de cette façon, ni même d’une façon absolument comparable, l’auteur du roman à son principal personnage (je ne sais pour ainsi dire rien du premier), mais de la façon dont est lié le narrateur à l’homme qu’il cherche, nommé ou surnommé Mao :
« Mao.
Je dis Mao. Je pourrais aussi bien dire « moi ».
Moi, c’est presque dans Mao.
Mao, c’est presque moi. »
Et, pas une page plus loin :
« Mao.
Où le trouver ?
Où me trouver ? »
*
Anaïs ou les Gravières emprunte quelques-uns de ses traits les plus évidents au polar, mais il est patent très vite que l’enquête ne porte pas tant sur l’identité du criminel – car il y a eu meurtre, assassinat peut-être – que sur celle du père de la victime que l’évènement, pourtant localement médiatisé – et l’enquêteur, pour ainsi dire désœuvré professionnel, travaille au canard local –, n’a pas fait réapparaître ; et cette absence de Mao, le père de la victime, Anaïs donc, que l’enquêteur à ses heures perdues ne cherche en somme que parce que lui aussi a perdu un être proche – non point sa fille, mais Nathalie, la jeune femme qu’il aimait et qu’il avait rencontrée, cela peut être souligné, lorsqu’elle avait à peu près l’âge d’Anaïs –, et cette absence du père de la victime, dis-je, peu à peu lui fait miroir à lui, dont la présence au monde ne tient plus peut-être qu’aux mots qu’il en écrit (du monde et de lui), jusqu’à ce qu’il s’y distingue nettement et le sache – dans ces moments notamment où il va écouter longuement la mère d’Anaïs, lui faisant face dans la cuisine –, jusqu’à ce qu’il se fonde à cette image aussi… Je ne sais plus où exactement Malraux disait – ou qui lui avait dit cela – (la phrase exacte doit se trouver quelque part dans Le Miroir des limbes (Antimémoires ou La Corde et les Souris), à propos du monde moderne, de mémoire : plus personne ne porte le deuil mais un jour sans meurtre à la télévision serait comme un jour sans pain. (C’est un fait que le deuil ne se porte plus, même dans les petites villes de la province française perdue, quoique toujours présente à sa propre disparition, de la France profonde comme on dit avec mépris, sans se douter qu’elle est peut-être aussi l’opposé de quelque France superficielle et dominatrice.) Et cette enquête sur soi-même du narrateur, qui avait apparemment d’abord pris pour objet Mao, ce roman du deuil qu’il écrit, que nous le voyons écrire et dont voyons en quelque sorte l’écriture « se faire », n’est pas seulement descente aux enfers, mais aussi remontée – à partir, notamment, quand le roman bascule, de sa rencontre avec l’inoubliable personnage du légionnaire, reclus volontaire dans sa maison (« Bidon-Cinq ») creusée dans les roches où les nouvelles du monde, presque mystérieusement, parviennent pourtant, mais pour aucun usage mondain.
*
Le narrateur écrit.
Et ce que nous le voyons écrire, c’est le roman de l’écriture de son deuil, descente puis remontée (quoique la question se pose, finalement, de savoir si cette écriture toujours incertaine, la part belle étant faite à l’imagination, par quoi le narrateur se sauve ou du moins le paraît, n’est pas une perte plus grande encore, et sa propre dissolution – mais cela nous entraînerait, peut-être, vers une réflexion sur un certain vice inhérent à l’art romanesque, que nous ne sommes pas du tout en capacité d’examiner, même un peu).
Il choisit ses mots, ses temps ; compose ses souvenirs et compose avec eux ; la narration est cet entrelacs de ce que le narrateur fait, écrit, de ce dont il se souvient, sans qu’il soit possible vraiment de savoir ici quoi cause quoi. Et le roman de cette écriture du roman se déploie dans une langue dont la précision est la poésie même : pas une phrase même banale dont chaque mot et sa place n’aient été exactement pesés.
Il choisit ses mots, ses temps : le présent (« Elle va au lycée »), puis bientôt l’imparfait (« Elle allait au lycée […] ») :
« C’est un temps sinistre, l’imparfait : ça relègue dans de vieilles lunes, ça n’a pas d’ouverture. Ça borne l’écoulement des jours, ça fait barrage. Il faut se retourner, pour voir : jeter le regard par-dessus l’épaule. Et souvent, on n’y voit pas grand-chose, tout est pris de brume et de grisaille. »
Puis, bien plus tard, de nouveau le présent, quand le narrateur a finalement décidé, au tout début du chapitre quatrième et dernier « L’Ange », de donner voix à la jeune fille assassinée :
« « Je m’appelle Anaïs.
J’habite à Poitiers.
J’ai dix-sept ans. (») »
On pourrait dire aussi, avec une pincée de cynisme, que le narrateur (et derrière lui l’auteur) en plus de ses temps choisit ses pronoms personnels ; mais qui ne voit, ou ne pressent, que ce changement de pronom personnel est bien davantage qu’un changement de pronom personnel et ne s’y réduit pas ?
Et nous voilà, pour ainsi dire, en plein théâtre. En plein dans ce théâtre que le narrateur, au tout début du roman, processus long et que nous voyons s’accomplir sous nos yeux, semblait éviter, vouloir éviter, ne pas pouvoir éviter :
« J’aurais dû d’emblée dire quelque chose de moi.
Dans les vieilles pièces, les tragédies grecques, même dans les opérettes, d’entrée de jeu, le personnage est là qui se présente, qui dit « je suis », qui démêle le pourquoi et le comment de sa présence sur la scène. J’aurais dû faire pareil, aller dans mon texte en posant solennellement « qui suis-je ? » et débiter quelques fadaises sur les spectres, genre « dis-moi qui tu hantes », etc. Mais que dire, de moi, qui ne hante personne – ou qui, plus justement, suis hanté par des fantômes ? »
*
Partout sous ce roman, poème et palimpseste, affleure le théâtre, comme si lui seul pouvait dire la vérité du premier. Pas question ici bien sûr de ce qu’on appelle théâtre dans le monde, de ces salles dans lesquelles on s’installe pour assister assis à quelque histoire linéairement dévidée, ou pire. Non, il est ici question des voix et il est question des morts, et de la voix des morts, et de comment elle revient, créée ou plutôt recréée, ancienne et neuve à la fois, imaginée et plus vraie peut-être qu’elle n’avait été, pas moins vivante que celle de ces mortels qui se disent vivants… Et pourtant le roman seul, loin du surjournalisme sociologique qu’il est fréquemment devenu, peut lier ensemble, réellement, par et dans son écriture même, non seulement le narrateur et ce Mao d’abord qu’il cherche, mais surtout ces deux jeunes femmes disparues que rien objectivement ne lie – et pourtant tout.
*
Le livre s’ouvre sur une citation fort belle de George Steiner, tirée de Grammaires de la création, placée en épigraphe par l’auteur.
« Toute œuvre d’art digne de ce nom parle de la genèse de sa propre création. Il n’est pas de forme artistique, peut-on soutenir, qui vienne du néant. Elle vient après. Toujours. »
Aussi belle soit cette citation, et juste – juste en elle-même comme en regard du roman qu’elle ouvre –, elle m’a semblé, étant tout de même de l’ordre de la critique, prendre un tour quelque peu programmatique, assorti peut-être d’une légère prétention tôt avouée, et même faire un peu d’ombre aux premières phrases du livre.
Ces premières phrases du premier chapitre, précédées elles aussi d’une magnifique citation du Journal de Ramuz, eussent suffi ; elles font ce que la citation de Steiner dit que la création fait :
« Des barres d’HLM ponctuent ce large bout de plaine. La géographie locale est comme de la parole qui décroît en force et en signification : les phrases se développent du cœur de la ville, haut juché, bourgeois, vers les berges du Clain ; puis ça remonte, sec et prolétaire, affaibli, vers des coteaux, avant de s’éluder, tout à voix mal audibles, vers le pourtour, qui est de plat pierreux. »