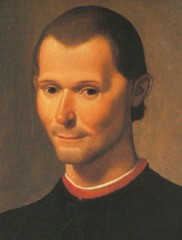L’Italie est un pays qui devient de plus en plus stupide et ignorant. On y cultive des rhétoriques toujours plus insupportables. Il n’y a pas, du reste, de pire conformisme que celui de la gauche : surtout, naturellement, quand il est repris aussi par la droite. Le théâtre italien, dans ce contexte (où le caractère officiel est la protestation), se situe culturellement au niveau le plus bas. Le vieux théâtre traditionnel est de plus en plus rebutant. Quant au nouveau – qui n’est rien d’autre que le long pourrissement du modèle du « Living Theatre » (à l’exclusion de Carmelo Bene, indépendant et original) – il a réussi à devenir aussi rebutant que le théâtre traditionnel. C’est la lie de la néo-avant-garde et de 1968. Oui, nous en sommes encore là : sans oublier le retour de la restauration rampante. Le conformisme de gauche. Quant à l’ex-républicard Dario Fo, on ne peut rien imaginer de plus affreux que ses textes écrits. Peu importe son caractère audiovisuel et ses mille spectateurs (fussent-ils en chair et en os). Tout le reste, Strehler, Ronconi, Visconti, n’est que pure gestualité, matériau pour magazines.
Dans un tel contexte, il est naturel que mon théâtre ne soit même pas perçu. Ce qui (je le confesse) me remplit d’indignation impuissante, étant donné que les Pilates (les critiques littéraires) me renvoient aux Hérodes (les critiques de théâtre) dans une Jérusalem dont je souhaite qu’il ne reste plus bientôt pierre sur pierre.
Pier Paolo Pasolini, extrait du bref avant-propos à Bête de style,
son autobiographie théâtrale, conséquemment aussi sa dernière pièce, ici traduite par Alberte Spinette (Babel n°177)