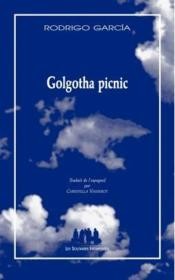
Lire la première partie
Bien sûr, on peut se demander pourquoi tant de textes, et surtout tant de spectacles, entreprennent aujourd’hui de s’en prendre, plus ou moins violemment et plus ou moins directement, au Christ ou à la figure du Christ, c’est-à-dire, en définitive à la représentation du Christ (car c’est bien ce que fait aussi Garcia), plutôt qu’au Dieu de je ne sais trop quelles autres religions. Et il faut bien admettre, même techniquement, que ce Dieu qui s’est fait homme, s’est incarné, a souffert, est mort puis paraît-il est ressuscité, est une aubaine depuis toujours ou au moins depuis que ses représentations ont été autorisées ; et d’un autre point de vue, que même mort, absent, retiré, « néantisé », et que nous le voulions ou non, que cela nous arrange ou non, il demeure notre Dieu, oui, le nôtre, à nous occidentaux – au moins historiquement, au moins culturellement : et même notre athéisme est essentiellement un athéisme de ce Dieu-là, même si nous voulons bien généreusement l’étendre, pour ainsi dire par principe, à tous les autres, dans un louable souci d’égalité… A ce compte-là pourtant, nous sommes en Occident loin d’être tous logés à la même enseigne, la France étant tout de même dans le renoncement au Christ une tête de pont historique. Je veux dire simplement que la réception des textes de Rodrigo Garcia ne sera sans doute pas la même selon qu’il sera joué en Argentine, en Espagne ou en France. Et comme je ne veux pas m’éloigner plus avant du texte Golgotha picnic de Garcia, je n’entrerai pas dans une discussion sur le rapport à l’Eglise catholique ou sur la virulence avec laquelle un certain nombre d’artistes et autres aujourd’hui se retournent contre elle, la situation quant au Christ et à la religion dans les pays protestants anglo-saxons ou scandinaves me semblant relativement différente (voir Jon Fosse, par exemple)…
*
Je reprends ici, à contrecœur, je dois l’avouer, ce texte qui n’est pas vraiment une critique, plutôt une série de notes à l’arraché. Dans la première partie, j’ai volontairement évité de m’appesantir sur cette question du Christ qui, si elle court tout le long du texte, n’est réellement marquée, je dirais presque lourdement, qu’en son commencement et sa fin, son alpha et son oméga… Les grandes proses poétiques de la majeure partie du texte, comme je l’ai dit, me paraissent l’œuvre d’un moraliste raté, d’un moraliste qui aurait préféré avoir autre chose à foutre.
(Et le fait est que, dans certains passages, il aurait mieux fait. Les discours sur le désir ou sur la mort sont toujours un peu ridicules, ou indigents, surtout au théâtre, qui avait pour spécialité de les mettre en situation plutôt que de nous en tartiner du blabla ; et il y a quelques pages bien ennuyeuses là-dessus, ou sur la description de la fosse qu’il dit creuser (alors que l’image de départ était très belle : « Ce que vous voyez du dehors : un type qui n’arrête pas de bouger. Ce qui se passe en réalité : un gars en train de creuse une fosse parfaite […] »), et c’est quand même bien embêtant ces pages sans intérêt dans un texte d’une petite soixante de pages où on revient souvent à la ligne.)
Mais le fait est, j’y reviens, que le texte de Garcia s’ouvre par un discours sur le Christ – discours de contemption à la fois violente et ironique – et, après quelques paroles sur les riches (j’y reviendrai) s’achève sur ce « texte des commandements » que j’ai déjà évoqué, dont les paroles seraient celles du Christ si le Christ était Rodrigo Garcia (ou l’inverse).
Je veux dire ici par avance que les questions de savoir si cela est blasphématoire ou pas (oui, d’évidence), et si le blasphème doit avoir droit de cité dans les ruines du théâtre public français ne m’intéressent pas le moins du monde, pas tellement d’ailleurs parce que je ne sais trop quel progrès les aurait rendues dépassées, désuètes ou obsolètes, ces questions, mais simplement parce qu’elles sont mal posées, passablement idiotes mêmes, et qu’au surplus je ne suis pas flic ni journaliste.
*
Le texte de Garcia commence donc par nous dire ce que le Christ, « vaniteux », pense sur sa croix de ce que l’on fera plus tard de son image (il le peut, « vu qu’il est Dieu »). Et si sa vanité lui fait n’aimer aucune des illustrations qu’on a réalisées (ou qu’on réalisera, c’est apocalyptiquement indifférent) :
« Il approuve, ça oui, la tonalité globale des tableaux et des fresques : une iconographie de la terreur qui part, ironiquement, du mot amour
Il a orchestré une parfaite iconographie de la terreur qui durant des siècles a produit des estampes diaboliques où il tient le haut de l’affiche ».
Les clés majeures de lecture sont données ici : l’ironie et l’amour comme guérilla divine – ou démoniaque, on ne sait trop pour l’auteur si cela diffère ou indiffère… – dans la représentation. (Guérilla dont Garcia conclut, avec une ironie réellement dangereuse et féroce, car on ne se rend jamais facilement à ce qu’il dit ni au contraire de ce qu’il dit, qu’il faut brûler les musées, avec leurs représentations de calvaires, de croix et de larmes, qui lui semblent, dit-il, « de la propagande pour la perversion, le tourment et la cruauté, résultat de techniques raffinées ».)
S’ensuit un portrait du Christ en guérilléro contemporain et des temps futurs (oui, le paradoxe est assumé), un type décrit comme une sorte de handicapé social, « nul dès qu’il s’agissait de parler de foot », ou « incapable d’aller boire des bières, de se lancer dans une discussion sur les filles avec un pote et de rater le dernier bus ». Bref, « ce qui l’emmerdait, c’était de reconnaître qu’il était le seul à ne jamais fondre en larmes, le seul à ne jamais lâcher le moindre éclat de rire ».
Et notre Garcia en vient donc à présenter la doctrine du Christ comme une manière éminemment emprunte de mauvaiseté de se venger de sa propre incapacité foncière à vivre normalement, et jusqu’à se faire un terroriste de l’amour, se sacrifiant en quelque sorte pour le plaisir vaguement puéril de foutre un bordel monstre dans la suite des temps – ce qui, selon le point de vue où l’on se place, peut tout de même sembler avéré…
« Il déclara à propos de lui-même qu’il était un agneau
Mais c’était un foutu démon »
Alors, j’y reviens, on peut bien se formaliser ou ce qu’on veut, crier à la provocation – même à la provocation inutile –, mais la question n’est pas là : elle est plutôt, paraîtrait-elle a priori un brin superfétatoire, pourquoi, ayant d’entrée de jeu cassé la gueule au Christ, ou à sa représentation attendue, Garcia a-t-il à la fin besoin de parler à sa place, depuis sa place, étant Lui ou comme étant Lui. Parce que, finalement, on ne sort pas si facilement de cette question du Christ ? Parce qu’il ne suffit pas de ne pas croire en Dieu pour que tout devienne simple, réglé une fois pour toutes – puisque, d’évidence, nous poursuivons cette histoire, fût-ce contre elle, en héritiers paradoxaux ? Ne comptez pas sur moi pour une réponse ; la belle ironie de Garcia est très judicieusement dissuasive.
*
Il y a un moment, plusieurs moments sans doute, mais disons en gros un moment dans l’histoire de l’art, ou dans l’histoire du christianisme, où la passion et la résurrection ont cessé – et peut-être est-ce là en vrai que la religion a commencé de finir – un évènement toujours contemporain, un évènement sans fin, pour emprunter l’expression à l’historien Alain Boureau, et où leur représentation a cessé d’être traitée de façon contemporaine et a été, pour être grossier, claquemurée dans le péplum, des lieux anciens à l’orientalisme fantasmé. L’évènement enfin était passé. Et le croyant, puis le spectateur, s’est habitué à voir raconter l’histoire de ce bon Jésus dans des décors anciens. Sans doute les peintres ont-ils continué à prendre pour modèles physiques des contemporains (ou eux-mêmes), mais c’en était fini pour environner le Christ des campagnes italiennes, rhénanes ou françaises, de leurs villes, châteaux, montagnes, etc. Les acteurs étaient certes pris sur place, mais embauchés pour jouer au péplum, et bien plus tard le cinéma a donné dans la même veine, quelque différente par ailleurs que soient les films de Zeffirelli, Pasolini ou Mel Gibson… (Il n’est pas interdit d’imaginer ici ce que donnerait une passion du Christ faite dans sa représentation d’éléments seulement contemporains. Quelle Jérusalem ferait, par exemple, New York (qu’est-ce qu’une croix au pied d’un gratte-ciel ?) ou Moscou, ou Pékin ? Ou même Rome ? Et quel uniformes ou costumes rituels porteraient les représentants des différents pouvoirs qui ont condamné ou laissé condamner Jésus ? Oui, quels costumes pour Caïphe, Hérode, Pilate ? Sans parler même du problème de trouver, ou pas, un équivalent au mot Israël…)
Or, il me semble que Garcia, contempteur connu, et à dire vrai désormais attendu, de notre belle société, prend pour modèle dramaturgique, donc point d’abord physique, l’homme de notre temps, singulièrement celui qu’il a sous la main, lui-même, en quelque sorte crucifié par la bêtise et la cupidité contemporaines. Voilà donc le gars avec lequel, ecce homo mais décalé comme disent les guignolesques apologistes de ce qui se fait, puisque Garcia, tout de même, écrit pour la représentation, il va falloir, en quelque sorte, faire Christ ; et comme, je le répète, ce modèle dramaturgique n’est pas d’abord physique, mais humain dans toutes ses dimensions, y compris cette fois les plus basses, il lui faut donc faire Christ d’un homme d’aujourd’hui, passablement cynique, incroyant, athée peut-être, et faire avec lui représentation où, d’une part, on retrouve un certain nombre de traits et d’épisodes de la légende désormais mal connue, et où, d’autre part, paraît un certain nombre d’éléments de notre détestable (ou détestée) société.
« Cloué sur la croix du Golgotha, je suis à l’abri des tâches quotidiennes : je n’ai pas à prendre le métro pour aller travailler, je n’ai pas à réparer la gouttière sur le toit de la maison, je m’évite d’avoir des mensonges à raconter à mes enfants, je me contrefiche des factures de téléphone et d’électricité, les autres n’ont qu’à les payer »
Paradoxalement, donc, cela dit que Garcia fait comme si (car il y a, mise au premier plan d’emblée, l’ironie) l’évènement de la passion et de la résurrection avait continué d’être sans fin, n’avait pas été, pour la plus grande satisfaction de croyants muséifiés, claquemuré au péplum sacro-saint ; et comme si l’homme d’aujourd’hui, dans son propre élément, pouvait se faire (parce qu’il est incroyant) le contempteur du Christ et simultanément, parce que dans cette fiction, dans cette représentation, il doit aussi faire Christ, le contempteur de l’homme d’aujourd’hui, c’est-à-dire de lui-même.
On voit nettement l’aporie, certains parleront peut-être de nihilisme, et seule l’ironie, vraie, puissante, de Garcia, qu’il ne cherche pas à masquer, d’ailleurs, permet de passer outre, au moins le temps que la lecture a lieu.
*
Tout cela amène évidemment Garcia, dans sa conception médiévale-contemporaine cherchant à enjamber, même pour rire, rien moins que les Temps modernes, à inverser quelques propos évangéliques, notamment en ce qui concerne nos amis les riches, lesquels sont très « impopulaires », ce qui permet à des gens d’opinions pourtant différentes de communier dans cette détestation des riches… « Comme si emmagasiner des richesses ne laissait pas le temps d’emmagasiner des connaissances ». Et de dire, au faîte de l’ironie qui ne peut pas simplement être renversée, qu’ « Amancio Ortega, le patron de Zara, connaît mieux les tréfonds de l’être humain que Sigmund Freud lui-même », ou que :
« Si tu veux connaître un tant soit peu le sens de la vie, ne perds pas ton temps ni le prix d’un billet d’avion pour aller rendre visite au Dalaï Lama en Inde
Il vaut mieux passer cinq minutes avec le directeur de Coca-Cola Madrid, si tant est que tu arrives à décrocher un rendez-vous avec lui »
*
Je crois au final que les intégristes catholiques qui se sont scandalisé du titre de la pièce ont un point commun avec les spectateurs boboïdaux du Théâtre du Rond Point de ce brave Jean-Michel Ribes : ils n’ont pas compris grand-chose à la fatrasie libérale de Rodrigo Garcia – ou plutôt, ces derniers n’ont pas remarqué qu’ils étaient au moins autant visés et bien mieux démasqués que les prévisibles intégristes et, l’habitude de se faire enculer aidant, n’ont pas trouvé cela désagréable, un peu étrange peut-être. Mais je crains que dire cela ne soit de ma part quelque peu prétentieux. Il se peut aussi bien que le spectacle ait raconté tout à fait autre chose que le texte lui servant de support. Et que tout cela, au final, n’ait pas tant d’importance. Mais je voulais aller y regarder d’un peu près ; et le texte a toujours cet avantage sur le spectacle qu’il ne peut pas être fascinant. Voilà, c’est tout.
*
Note finale, pour rire. Comme un certain Marino Formenti signe en seconde préface un texte titré « Le piano est un cercueil », dans laquelle il compare assez étrangement les messes anciennes du Quattrocento et Cinquecento aux installations d’art contemporain (sans que je sache si la comparaison est élogieuse ou non selon lui), je me suis demandé qui il était. Eh bien, il est le pianiste, m’a appris internet, qui, à la fin du spectacle, joue à poil une version pour piano des Sept dernières paroles du Christ, de Haydn. Je crois que tant de ridicule m’eût faire rire, car je suis bon public. Et si jamais le message était (c’est possible) qu’il joue en tenue d’Adam la musique de la passion du Nouvel Adam, je crois que je pourrais considérer que le premier couple venu qui aura l’idée de se filmer en train de niquer fait un remake de la Genèse. Mais bon.
*

Et Joyeuses Pâques !
Golgotha picnic, de Rodrigo Garcia, traduit de l’espagnol par Christilla Vasserot, ed. Les Solitaires intempestifs, 2011, 12 euros.