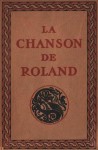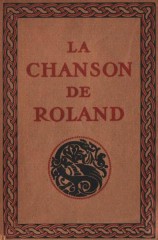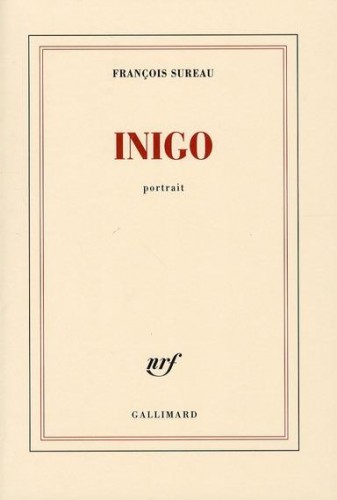
Rien, dans le programmatique tombereau biannuel de marchandises livresques implorant le pilon qu’on appelle avec une bonasse perversion de journaliste rentrée littéraire, ne laissait espérer cet Inigo.
Il y avait bien peu de chances que j’achète ce livre, comme tant d’autres accroupi aux étalages d’octobre. Cet Inigo de titre, en effet, ne m’évoquait rien du tout ; le mot même de portrait où est ordinairement apposé celui de roman, faute peut-être que cet Inigo, donc, m’évoquât quoi que ce soit, me laissait indifférent ; le nom de son auteur, François Sureau, n’était jamais parvenu sous mes yeux ni, je crois, à mes oreilles ; et pour finir, quand même tout ce qui précède aurait éveillé en moi une once de la plus banale curiosité, la jadis prestigieuse collection blanche de Gallimard eût tout à fait achevé de me dissuader d’acquérir pour 12,50 euros cet encombrant objet de 154 pages.
Fait rarissime, c’est le bandeau promotionnel qui m’a convaincu de l’éventuel intérêt du bouquin : « J’ai longtemps détesté Ignace de Loyola ».
Car moi aussi, voyez-vous, je déteste Ignace de Loyola. J’ai même d’excellentes et de très mauvaises raisons pour cela ; les excellentes me semblent tenir à ces quatorze années que j’ai passées chez les jésuites, les très mauvaises au fait qu’en dépit de ces années de traitement-là, je ne sais presque rien d’Ignace de Loyola.
Ce qui m’intriguait, et semblait même pouvoir m’inquiéter, c’était l’idée qu’un de mes contemporains avait passé du temps à travailler sur un sujet aussi peu aimable, que cette étude l’avait fait changer de disposition à son égard, et que, donc, ne détestant plus Ignace de Loyola, il était tout de même parvenu à faire paraître son manuscrit dans une maison dite de littérature générale – expression qui frôle l’oxymore –, c’est-à-dire essentiellement occupée à diverses fredaines et bassesses.
Le risque, tout de même, demeurait qu’un tel livre ne fût que galéjades, moqueries et autres imbécillités diverses. (Il y a de nos jours tellement d’humoristes à deux sous, dont l’humour est d’ailleurs plus ou moins volontaire, engagés dans la carrière des livres ; c’est-à-dire : il y a tellement de gens qui ne voient pas du tout que dans un monde aussi intrinsèquement ridicule que le nôtre, la plupart des tentatives d’être drôle sont exactement redondantes, ne permettent en rien de se séparer, même un peu, de ce monde qu’on rêve pourtant de fustiger, mais au contraire signent la soumission de leur auteur, elle aussi plus ou moins volontaire, à l’esprit – le mot est trop fort mais ce que je cherche à nommer dure davantage qu’une mode – de l’époque.)
C’est paradoxalement le dernier frein qui fit sauter mes préventions. Quand on sait quel usage des contemporains peuvent faire de leur mauvaise lecture formatée de ce pauvre Rimbaud, une épigraphe de ce dernier paraît d’emblée effrayante. Ce fut pourtant cette phrase qui acheva d’emporter mon encore timide adhésion :
« Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d’hommes. »
Bon. On va voir. Ai-je peut-être marmonné en prenant le bouquin.
Après quoi, je vous dirai que j’ai lu ce livre éprouvant le plus lentement que j’ai pu, pour en avoir encore (et aussi, que je ne vais plus vous causer de moi).
Quoique suivant au plus près les accidents de la vie de l’homme, Inigo n’est pas une biographie, moins encore une hagiographie, c’est un livre pour l’essentiel concentré sur un petit nombre d’années de la vie d’Ignace de Loyola et qui emprunte au roman un certain nombre des qualités qui font qu’il n’en est pas un tout de même, mais véritablement un portrait puissamment scrutateur, lequel, et c’est heureux, ne dégoutte d’aucun bénitier, moderne ou ancien ; car ce petit livre est aussi, justifiant largement l’emprunt à Rimbaud de son épigraphe, une descente aux enfers, et une saison en enfer. Et en fait de brutalité, bataille d’hommes ou combat spirituel, oui, on est servi.
Le livre ouvre pourtant sur une brève première partie racontant la mort de cet homme établi dans l’Eglise et dans le monde qu’est Ignace de Loyola, en 1556, dans la maison même de cette Compagnie de Jésus qu’il a fondée, à Rome ; et c’est dans la manière très particulière, pour ainsi dire très ordinaire ou très commune, dont meurt cet homme depuis longtemps malade et dont on peut deviner déjà, ou espérer, qu’il sera bientôt saint Ignace que l’auteur retrouve en quelque sorte cet Inigo dont les quatre autres parties du livre – jusqu’à cette apostille où l’auteur parlant en son nom propre nous apprendra comment il a cessé de détester Ignace de Loyola en découvrant en lui celui qu’il préfère nommer par son basque prénom castillanisé, Inigo, donc – vont nous entretenir. En effet, suite à quelque contretemps, à quelque incompréhension, à Rome, dans la maison de cette Compagnie qu’il a fondée, Ignace de Loyola, qui n’est aucunement foudroyé par la mort mais achève d’agoniser, meurt sans avoir communié depuis deux jours ni reçu les derniers sacrements ; et cet état-là au moment de mourir rappelle d’évidence celui qui fut le sien au tournant de sa vie, entre 1521 au siège de Pampelune et le début de l’an 1523 où il commence d’écrire ses fameux Exercices spirituels (bien avant, donc, la fondation de l’ordre qui n’aura lieu qu’en 1539, et sa reconnaissance l’année suivante).
Ce sont ces années-là que racontent les quatre parties qui suivent. Au siège de Pampelune, où il sera durement blessé à la jambe, Inigo a trente ans. C’est un homme ambitieux, à l’éloquence sèche, prompt à tirer l’épée surtout s’il se trouve là quelque femme à qui plaire, mais capable d’une diplomatie efficace au service de son roi ; c’est aussi un soldat qui n’a pas encore combattu et dont l’idée de la guerre est, comme celle du Don Quichotte de Cervantès, assujettie encore à ses lectures d’Amadis de Gaule. Voilà tout ce qui, ici, malgré l’héroïsme réel dont il fait preuve au combat, va commencer de voler en éclats.
« On peut rêver à une autre histoire, où Charles-Quint et François Ier ne subsisteraient que pour expliquer, au terme de l’enchaînement des causes et des effets, la vocation d’Ignace de Loyola et l’influence qu’elle a eue, non seulement dans le monde visible, mais aussi dans l’invisible. » (p.22)
On pourrait a priori penser que ses blessures et leurs séquelles – une jambe cassée, l’autre jambe surtout fracassée par un boulet de canon et qu’il fera au péril de sa vie, retour à Loyola, parce que les os se sont mal ressoudés, de nouveau briser au maillet par deux médecins terrorisés – sont essentiellement les causes d’une conversion pratique, pour ainsi dire jésuitique au sens devenu banal du terme, que le mot de reconversion pourrait bien faire comprendre à nos esprits modernes si, dès avant la bataille, se reprochant que son éloquence, car il est parvenu à convaincre ses supérieurs de défendre plutôt que d’abandonner une Pampelune perdue d’avance, allait être cause de la mort de tant d’hommes, Inigo a cherché à se confesser et, ne trouvant là aucun prêtre, l’a fait à un soldat anonyme et dont il n’est pas bien certain qu’il ait compris ses paroles ; si, au milieu de la bataille ne lui étaient encore venues ces pensées-là :
« Il se reprocha de n’en avoir pas dit assez à son compagnon d’armes. Il ne lui avait avoué que des fautes visibles, bien nettes, sur lesquelles tout le monde pouvait mettre un nom : des galets sur une grève. Il n’avait pas évoqué ce tuf dans lequel ces fautes étaient prises, la pâte dans laquelle elles avaient levé. Comme s’il eût été encore en train de se confesser, il cherchait des comparaisons qui eussent permis à l’inconnu de comprendre. Il voyait mieux soudain que ces fautes n’étaient pas séparables de certaine façon de vivre, qui les avait rendues possibles, si bien que si la faute lui semblait grave, ce n’était pas seulement à cause de l’acte lui-même et de ses conséquences, mais à cause de cette espèce de sombre lumière qui l’enveloppait, et qui envelopperait toujours à l’avenir les fautes de même qu’il ne pourrait s’empêcher de commettre. La faute commençait avant la faute, dans ce tremblement où se mêlaient la gaieté, l’espoir, la jalousie et le chagrin qui le prenait au moment même où une femme commençait de l’attirer ; dans les rêveries sans fin où il jouissait qu’on l’admirât de pouvoir tout sacrifier pour son roi, sauf son honneur, dont il ne pourrait jamais se déprendre ; dans la rage sourde à se frayer, à coups d’épée, un chemin vers il ne savait quoi, dans ce désir d’un royaume qui serait le sien et dont il avait pourtant, parfois et de manière fugitive, ressenti l’indicible tristesse. » (p.39)
La langue simple et limpide de François Sureau permet au lecteur d’accéder à des états extraordinairement complexes, dont aucune dimension n’est absente, de l’introspection douloureuse à la contemplation des paysages, et de suivre ainsi Inigo dans cette descente aux enfers de la quête de la sainteté et de l’imitation de Jésus-Christ ; non qu’il simplifie les choses pour les donner sans effort à entendre à qui veut – aucune vulgarisation, finalement, ici – mais plutôt qu’il éclaire, le temps de la lecture, ce qui par ailleurs demeure obscur et enchevêtré. La sainteté n’est aucunement présentée ici, pour autant d’ailleurs qu’elle soit même affichée comme un but, sous les augures imbéciles de la bonté et de la gentillesse, pour ne rien dire du dérisoire et très moderne côté « sympa » de cette affaire, comme s’il ne tenait en définitive qu’à je ne sais quelle bonne éducation d’écarter poliment le mal d’un revers de la main pour se trouver avec toutes assurances et garanties dans quelque hypothétique camp du bien, mais sous celle d’un combat terrifiant qui, une fois engagé, ne peut en quelque sorte plus être renoncé, et peut éventuellement mener celui qui n’y reste pas, car on y risque sa peau et pas du tout métaphoriquement, à cette sainteté, à ce souverain bien qui ne se trouve en somme, pour emprunter à Nietzsche, que par-delà bien et mal, par-delà ce bien et ce mal qui sont face et revers de la même monnaie sociale, de la même corruption.
« Un matin, il s’aperçut que le Roi d’Espagne ne lui suffisait plus. Ni le roi ni sa cour, ni ses généraux ni ses prêtres : ils n’étaient que des hommes arrêtés à mi-chemin et qui se satisfaisaient de peu de chose. Ils portaient de l’or et de la pourpre, mais vivaient d’arrangements, comme le moindre des fermiers du Guipúzcoa. Il passa tout le jour à chasser cette pensée, qui revenait sans cesse. » (p. 74)
C’est dans cette chambre, à Loyola, dans la demeure de son frère aîné et de son épouse, à laquelle il n’est pas aussi indifférent qu’il le voudrait et devrait, qu’Inigo, après cette terrible « opération » de la jambe, ayant rouvert les yeux le jour de la saint Pierre et saint Paul, alors que tout était prêt pour la veillée funèbre, va réellement, sans bien le savoir encore, débuter sa conversion – moins au sens où l’être par on ne sait quel enchantement changerait qu’à celui où, demeurant lui-même, il change radicalement de direction. Point de prêtres pourtant ici, ni donc de confession, du silence et des lectures. La Légende dorée de Jacques de Voragine, La Grande Vie de Jésus-Christ de Ludolphe le Chartreux. Amadis de Gaule et la terrestre chevalerie rêvée s’éloignent ; parce que leurs récits, le siège de Pampelune lui en a donné l’assurance, sont inconciliables à la réalité ; parce que la réalité de la guerre et la condition d’homme de guerre deviennent inaccessibles, malgré les appels du pouvoir à un homme de valeur, à un individu dans son état physique ; enfin, surtout, parce que la sainteté, ou du moins, l’imitation de ce Christ qu’il connaît si mal – il s’en avise – par l’imitation de ces saints qui, très diversement, l’imitèrent, lui apparaît pour la première fois comme la chevalerie de Dieu. Inigo lit, commence d’écrire – colligeant en quelque sorte ce qu’il apprend et découvre en un livre, manière très personnelle de philocalie, qui plus tard lui servira à écrire ses Exercices spirituels. Marchant mal, mais marchant, et donc quittant enfin la chambre, Inigo surprend ses proches :
« Madeleine [la femme de son frère] avait peur pour lui. Se pouvait-il que Dieu lui-même se fût adressé à Inigo, et seul à seul, sans prêtre, sans messe, sans cérémonie ? Martín Garcia fut également désarçonné lorsqu’Inigo lui fit part de ses résolutions. Sans le lui avoir jamais dit, il admirait son frère. Lui-même tenait sa place avec autorité, mais Inigo s’était montré capable d’accomplir plus que son devoir. Il aurait pu faire de grandes choses, et donner au nom de Loyola un surcroît de gloire. Et voici qu’il prétendait renoncer à ses biens et se cloîtrer dans quelque désert. » (p. 82)
Sans la protection même symbolique d’un ordre, plus proche peut-être en cela de la tradition orientale du christianisme que de l’occidentale, Inigo part seul pour Jérusalem, fait au passage ses adieux au duc de Najera – qui, avec une certaine bienveillance, lui permet de ne pas le rencontrer –, joint la Catalogne, le monastère bénédictin de Montserrat où il abandonne son épée de parade et ses habits de soldat, puis, non loin de là, Manrèse, chez les dominicains, où il se met au service des malades, des enfants, manquant mourir à force de jeûne, poursuivi d’hallucinations agréables et diaboliques, désespérant du silence de ce Dieu pour lequel il a tout abandonné.
« Il serait donc enseveli à Manrèse. Il avait échoué. Peut-être n’y avait-il pas de Dieu. Si Dieu existait, peut-être était-il méchant. Si Dieu ne l’était pas, sûrement lui avait-il déplu au point de devoir errer désormais sans but sur la terre, sans but et sans consolation, comme Caïn l’avait fait. » (p. 129)
« Une nuit qu’il ne pouvait plus prier en silence tant sa confusion était grande, il se mit à hurler en appelant Dieu au secours. Il lui disait n’avoir trouvé aucun remède chez les hommes ou en lui-même. Il suppliait que Dieu lui montrât ce qu’il devait faire pour être délivré. Il se dressait éperdu devant le Créateur, et d’une voix inhumaine lui promettait de suivre même un chien, si c’était ce qu’il devait faire. Réveillés par le bruit, deux frères dominicains, alarmés, vinrent frapper à sa porte. Il ne leur ouvrit pas. Il était au-delà de la charité des autres. Il n’avait plus confiance que dans ce Dieu invisible qui s’était pourtant retiré de sa vie. » (p. 130)
Le portrait de François Sureau ne nous fera pas suivre Inigo jusqu’à Jérusalem, mais nous le montre à présent « tournant » en quelque sorte entre Montserrat et Manrèse, multipliant les confessions, toujours la même en fait, qu’il ne parvient pas à achever, creusant et creusant sans répit sa parole. Car son enfer, finalement, est aussi un enfer de la parole, et Inigo, qui suit si bien l’errance d’Inigo, un livre sur la parole. La confession qu’Inigo a commencée au siège de Pampelune, il ne parvient pas à la finir. Elle est toujours refaite, parfois même écrite, jamais achevée.
Peut-être même l’empêche-t-elle d’entendre ce qui lui disent ses confesseurs – ou même cette « sainte inconnue », vivant retirée à la manière des béguines, à qui il se confie – comme cet extraordinaire Dom Jean Chanon qui « n’aime pas beaucoup que l’on parle de Dieu », mais comprend d’emblée que cet Inigo qui fuit le monde doit y être en quelque manière renvoyé :
« Inigo lui ayant expliqué son projet d’aller à Jérusalem, il ne le découragea pas, mais cita en souriant : « Que d’autres que toi aillent à Jérusalem ; toi, va jusqu’à l’humilité, et la patience. Ceci en effet, c’est pour toi sortir du monde, cela t’y enfoncer. » Inigo entrevit que nul exploit ne le rapprocherait de Dieu, et surtout qu’il était inutile qu’il prétendît conquérir un amour qui lui avait été accordé avant même qu’il n’existât. » (p. 110)
Plus tard, à propos d’une autre confession, à un autre confesseur :
« Mais, venues des profondeurs du passé, de nouvelles fautes lui apparaissaient encore. Quant à celles qu’il avait avouées à Dom Chanon, il doutait de les avoir décrites avec assez de précision. Il y revenait sans cesse. Il entreprit d’écrire une autre confession générale, et il obtint de nouveau l’absolution. A peine était-il sorti de l’église que les doutes l’assaillaient de nouveau. Derrière chaque faute avouée, il en découvrait d’autres, plus précises, plus ténues, non moins graves. Il n’en serait jamais quitte. » (p. 128)
L’épreuve est trop dure. Le silence de Dieu l’écrase et sa parole à lui est impuissante. Mais Inigo continue de s’en remettre à Dieu, terriblement, décidant de jeûner jusqu’à ce que Dieu lui vienne en aide, ou qu’il meure. Il suffira pourtant d’un hasard – le mot est volontaire – pour qu’au bout d’une semaine de ce traitement d’un optimisme à la limite de la folie, Inigo soit enfin délivré. Un religieux qu’il ne connaît pas remplace son confesseur.
« Avant même que le pénitent ait commencé de parler, il s’entendit dire : « Croyez à la miséricorde du Christ. » Inigo lui parla du jeûne qu’il s’infligeait. Le prêtre lui ordonna, d’une phrase calme et brève, d’y mettre fin immédiatement. Puis, levant la main et sans même l’avoir entendu, il lui remit tous ses péchés, volontaires ou involontaires, connus ou inconnus de lui, visibles ou cachés. » (p. 132)
Voilà. Les scrupules s’évanouissent, tentent bien de revenir, disparaissent. Privé de ressasser sa vie passée pour y trouver de nouvelles fautes qui ne lui auraient pas déjà été remises, puisque toutes le lui ont été, débarrassé en quelque sorte de ce travail, de cette torture de parole toujours au moins incomplète et peut-être même fausse, qu’accompagnait un jeûne démesuré, le silence de Dieu s’impose à lui enfin, non plus pour l’accabler ou l’écraser, mais pour le porter dans la joie, l’amitié.
Dernière phrase de cette cinquième partie :
« Il était libre. » (p. 140)
Ces cinq parties sont suivies de ce que j’appelle une apostille, laquelle prend son titre du début de sa première phrase : J’ai longtemps détesté Ignace de Loyola… et j’avoue m’être demandé au moment de la lire pourquoi l’auteur, jusqu’ici si absent, si retiré, avait eu besoin pour finir de nous parler de son rapport à Ignace de Loyola. Pour conférer à son sujet une actualité plus grande, ou, disons, plus manifeste au lecteur, que celle de sa simple inactualité capable pourtant de pulvériser nos insignifiantes et mièvres actualités ? Pour, simplement, le justifier (au sens le plus courant) ? Je mentionne ces questions parce qu’elles se sont posées à moi au point de me faire repousser la lecture de ces quelques dernières pages. Les ayant lues, les questions demeurent, quoique en arrière-plan, presque dénuées d’importance. Car cette apostille, surtout, réouvre la lecture, peut-être d’abord de signaler au lecteur que ce petit livre, essentiellement centré sur deux années de la vie d’Ignace de Loyola ne raconte pas seulement, n’explore pas seulement ce qui fait rupture mais peut-être surtout ce qui fait continuité : « Si la conversion – celle-là comme les autres – est intéressante à méditer, c’est parce qu’elle constitue un retournement, le changement de direction d’une personne qui reste au fond la même. […] La rudesse d’Ignace tranche même sur celle de ses contemporains. Sa conversion n’y a rien changé – sauf bien sûr l’objet de tant d’énergies. Avant, de peur de boiter et de perdre son pouvoir sur les femmes, encore convalescent, il fait briser sa jambe mal consolidée. Après, dans les grottes de Manrèse, il jeûne tant qu’il tombe malade à en mourir. C’est le même Ignace. » Mais, plus profondément, cette apostille ne réouvre-t-elle pas seulement la lecture de ce seul livre-là, mais, en en inversant en quelque sorte la polarité, bien plus profondément peut-être qu’un Ducasse, la lecture elle-même, et partant, la littérature : notant que les commentaires aux Exercices spirituels leur ont toujours refusé le statut d’œuvre, l’auteur écrit : « Mais la langue des Exercices n’est pauvre que pour ceux qui croient au « beau style ». Pour les autres, elle sert, y compris sur un plan spirituel, une tentative profondément novatrice d’ouvrir l’existence humaine au discours attendu de Dieu, et la perfection avec laquelle elle atteint ce but lui confère une beauté sans exemple, qui obligerait plutôt à réhabiliter, en Ignace, la littérature entière. » La question est posée là non pas tant de la langue comme fin en soi, mais de ce que sa pauvreté ou sa richesse dépendent de ce qu’elle sert et de la perfection avec laquelle elle le sert, à quoi me semble faire humblement allusion la dernière et très belle phrase de ce livre : « Sans doute ai-je espéré, en m’approchant de ce domaine mystérieux, attirer sur mes proches et sur moi, au-delà du temps, l’amitié de mon objet d’étude, et en recueillir des bienfaits insoupçonnés. »
Un dernier mot, tout de même, sur l’épigraphe de Rimbaud. Tirée d’ « Adieu », dernière partie d’Une Saison en enfer, la fin de la phrase a été ôtée.
« Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d’hommes ; mais la vision de la justice est le plaisir de Dieu seul. »