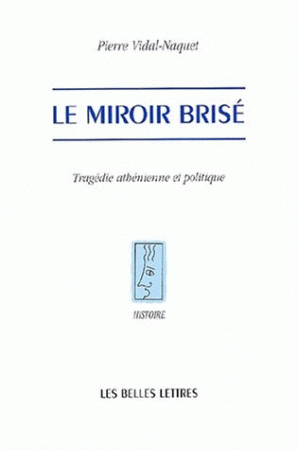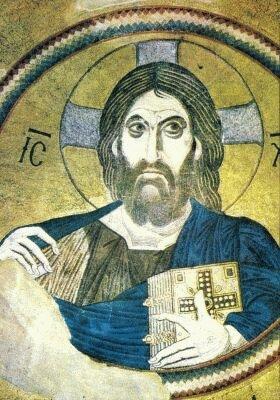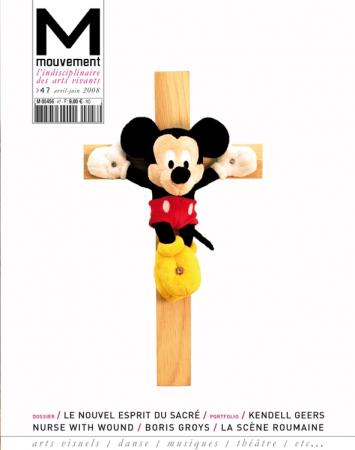Ceux qui prennent des décisions dans la tragédie, souvent pour le pire, rarement pour le meilleur, ce sont les héros.
Le grand historien Pierre Vidal-Naquet ne cherche pas seulement, dans ce tout petit livre passionnant, issu d’une conférence ultérieurement développée, à lire le théâtre grec antique à la lumière de la connaissance historique, il cherche également à comprendre la politique athénienne par le théâtre de ses tragiques – et du grand Aristophane.
Mais la tragédie athénienne est un miroir brisé.
Elle ne donne pas prise, ou bien peu, à ce que nous appelons la politique.
D’abord parce que peu d’évènements contemporains sont représentés. Les histoires sont celles encore des épopées homériques, de la guerre de Troie, etc.
Sur les trente-trois drames athéniens, quatre seulement sont censés se dérouler partiellement ou totalement sur le sol attique, quatre autres concernent « le jugement d’un étranger (Oreste) ou l’accueil d’un groupe d’étrangers menacé par ses concitoyens et suppliant Athènes de le recevoir. »
Si nous prenons l’ensemble du corpus, on constate qu’il n’est pas un seul drame où l’opposition entre Grecs et Barbares ou entres citoyens et étrangers ne joue pas un rôle significatif. J’ai demandé à un ordinateur si le mot xénos ou les mots de sa famille étaient présents ou absents dans le corpus tragique. La réponse a été qu’il était présent partout… sauf dans les Perses où, bien sûr, le mot barbaros est abondamment représenté.
Le livre se conclut ainsi :
Quand Napoléon rencontra Goethe, il lui dit, selon la tradition : « Aujourd’hui, Monsieur, la tragédie, c’est la politique. » Chez les Athéniens, c’était une affaire beaucoup plus compliquée.
Pas moyen donc, par leurs œuvres, de savoir ce que pensaient les tragiques de la politique démocratique de leur temps.
Voici pour Eschyle :
Chacun est d’accord pour dire que le jugement final de l’Orestie, le jugement et l’acquittement d’Oreste, grâce à l’ultime intervention d’Athéna, font référence, en 458, à l’importante réforme d’Ephialte, en 462, qui mit un terme au rôle de l’Aréopage comme Conseil de gardiens des Lois, limitant ses fonctions à celles de Tribunal chargé des crimes de sang, tandis que la Boulè, tirée au sort, devenait, aux côtés de l’Ekklésia – l’assemblée populaire –, le seul organe délibératif ayant une fonction politique. Chacun admet aussi qu’il s’agissait d’une réforme profondément démocratique, qui suscita assez de troubles pour que son instigateur, Ephialte, soit assassiné l’année suivante, laissant ainsi la place de leader du parti démocratique à Périclès.
Cela dit, pouvons-nous passer de la lecture des Euménides à une information sur l’attitude personnelle d’Eschyle ? En d’autres termes, pouvons-nous deviner, grâce au texte des Euménides, comment Eschyle vota, s’il vota, lors de la session de l’Ekklésia qui entérina la réforme d’Ephialte ? Il est frappant de constater que les interprètes se divisent en deux camps. Les uns admettent qu’Eschyle est un partisan de la Réforme – tel est le cas, par exemple, de Paul Mazon ; les autres estiment au contraire qu’Eschyle était un laudator temporis acti, un partisan de la tradition.
Quant à Sophocle, le seul des trois grands tragiques à avoir fait « ce que nous appellerions aujourd’hui une carrière politique. Elu stratège, il prit part aux côtés de Périclès à la répression de l’insurrection de Samos », voilà ce que dit de lui son contemporain Ion de Chios : « En matière politique, il n’était ni habile ni particulièrement pénétrant, il était comme un quelconque athénien de qualité ». Et Vidal-Naquet de conclure :
Quelque chose de ce cursus passe-t-il dans son œuvre tragique ? A mon grand regret, je dois répondre que non, ou si peu.
Et plus loin :
Décidément, à quelque niveau qu’on se situe, la tragédie de Sophocle n’est pas la tragédie politique d’Athènes. Cette tragédie-là, c’est Thucydide qui l’a décrite, non Sophocle. Eschyle a dépeint la bataille de Salamine. Sa description, antérieure de plusieurs décennies à celle d’Hérodote, reste notre source historique principale, même si Eschyle n’a pas composé sa narration à notre intention, mais à celle des spectateurs de 472. Euripide reporter et auteur tragique a multiplié les allusions, même si on lui en a prêté trop et si la distanciation ne lui était pas étrangère. Il y a chez Sophocle une hauteur de ton qui rend pratiquement impossible toute interprétation actualisante.
Ce qui n’entraîne pas que Vidal-Naquet mésestime les adaptations postérieures.
Il revient même plusieurs fois sur l’Antigone d’Anouilh et voit dans les reprises successives de l’histoire d’Antigone – par Hölderlin, par Brecht s’appuyant sur Hölderlin, par Anouilh aussi… – celle qu’on peut faire de la conscience européenne.
*
Le théâtre n’est sans doute pas la chose gentillette pour laquelle notre époque a intérêt à le faire passer.
J’ai conservé pour la fin ces quelques phrases, celles sans doute qui m’ont le plus marqué :
Oserais-je le dire ? Ce qui à mes yeux fait écho à la tragédie athénienne, n’est pas telle ou telle pièce de théâtre, mais bien cette série de représentations politiques à l’usage des masses que furent les procès de Moscou dans les années 1936-1938 ou de Budapest, Sofia et Prague, sans oublier Tirana, à la fin des années 40 et au début des années 50.
La différence est évidente. Ces procès se terminent par une balle dans la nuque ou une corde autour du cou. Mais où est la ressemblance ? Il s’agit de grands personnages de l’Etat que l’on montre au peuple et que l’on brise. La dimension théâtrale est manifeste. Chaque acteur, accusé, procureur, président, avocat, joue un rôle qu’il a appris par cœur au cours des semaines ou des mois qui précèdent. Si un acteur s’écarte de son texte, comme cela arriva à Sofia au procès de T. Kostov, c’est toute la représentation qui est mise en question. Quand le rideau tombe, le héros est bon pour la mort. Sommes-nous vraiment si loin de la tragédie athénienne ou de celle de Shakespeare ?