
*
Le livre que voici ne s’adresse pas aux seuls érudits ; il convient que tous les lettrés puissent lire le poème vénérable et s’y plaire. A leur intention, pour leur rendre l’effort moins rude et les assister chemin faisant, j’imprime en regard du texte ancien une transcription de ce texte en langage d’aujourd’hui, une « traduction ». Ainsi ont fait avant moi deux autres éditeurs, Francis Génin et Léon Gautier.
Par définition, ces traductions juxtalinéaires et qui rendent le mot par le mot, ne se suffisent pas à elles-mêmes. L’auteur d’une adroite traduction en vers de notre poème, M. Henri Chamard, me l’a souvent remontré, tandis qu’il s’employait amicalement à réviser ma prose. Des traductions telles que la mienne ne prétendent qu’à l’exactitude littérale, et cette prétention même vise trop haut. On est inexact, et de la pire des inexactitudes, du seul fait que l’on transcrit en prose un ouvrage de la poésie.
Privée de la forte cadence des décasyllabes et de la sonorité des belles assonances, la strophe du vieux trouvère n’est qu’un moulin sans eau. Que de fois, au cours de mon travail, me suis-je remémoré, avec mélancolie, certain chapitre, très sage, de la Défense et illustration de Joachim du Bellay ! Il est intitulé : « De ne traduire, poète ou prosateur, aucun bon écrivain. » Car, poésie ou prose, l’art d’écrire réside tout entier dans la convenance de l’idée et du sentiment au rythme et au nombre de la phrase, au son, à la couleur, à la saveur des mots, et ce sont ces rapports subtils, ces harmonies, que tout traducteur dissocie nécessairement et détruit, puisqu’il est l’esclave de la littéralité et qu’il peut bien rendre en son propre langage la pensée, mais non pas la musique de la pensée, non pas cette petite chose, le style. Dès lors, on peut presque dire qu’il n’est guère de bons traducteurs que de médiocres écrivains.
Pourtant, il est un caractère de la Chanson de Roland que je crois avoir reconnu et senti avec une vivacité assez particulière et que, dans ma traduction, je me suis attaché, de toute ma ferveur, à sauvegarder. C’est bien à tort, il me semble, que tant de critiques ont déploré la pauvreté des moyens d’expression du poète, ont cru devoir chercher des excuses à ce qu’ils appellent sa « gaucherie », sa « naïveté toute populaire ». J’admire au contraire les allures aristocratiques de son art, les ressources et la fière tenue, très raffinée, d’une langue ingénieuse, nuancée, volontaire, et qui révèle un souci constant de distinguer l’usage vulgaire du bon usage. Ce style est déjà d’un classique, il est déjà un style noble. Dès le début du XIIè siècle, la France des premières croisades tend de la sorte à créer, à constituer en dignité, par-dessus la diversité et la rusticité de ses dialectes et de ses patois, cette merveille, une langue littéraire. Ce fut, à cette date, l’œuvre de trois ou quatre grands poètes. Ce fut, avant eux, éparse dans les classes les plus cultivées, l’œuvre mystérieuse de plusieurs siècles d’efforts spirituels et de vertus. J’ai voulu sauver dans ma traduction cette qualité souveraine du vieux maître, la noblesse. Comment y parvenir ? Tant d’éléments de sa syntaxe, après huit siècles écoulés, sont tombés en désuétude ! Tant de termes de son vocabulaire ont péri, ou, ce qui est pire, survivent, mais détournés de leur sens premier, affaiblis ou avilis ! Je n’ai tenté d’en restaurer aucun : ce qui est mort est mort. Archaïser selon les procédés usuels, ç’eût été courir les périls du style marotique, dont le moindre est d’accumuler les disparates. Pour répondre à l’effort du poète par un effort qui ressemblât au sien, j’ai évité dans ma traduction les mots récents, comme il évitait les mots bas. Exception faite, il va sans dire, pour les termes techniques qui désignent des choses d’autrefois, armes, vêtements, monnaies, coutumes, etc., j’ai essayé de n’employer que des mots et des tours bien vivants encore, mais qui, persistant dans notre usage, puissent se prévaloir de très anciens titres, plus anciens que la Renaissance. Une telle gageure méritait d’être tentée ; mais elle était difficile à soutenir, et, je ne le sais que trop, j’ai maintes fois gauchi.
Joseph Bédier,
extrait de l’ « Avant-propos » à la Chanson de Roland,
éditions d’art H. Piazza.
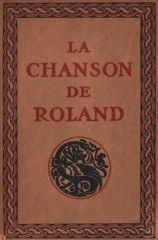
Joseph Bédier fut à ma connaissance un des maîtres de Péguy, que ce dernier chercha à faire collaborer autrement que de façon épisodique aux Cahiers de la Quinzaine…
La Chanson de Roland de Bédier fut publiée en 1920 chez Piazza ; mon édition de 1937 précise être la 135ème.
Autour du même livre :
La littérature, combien de divisions ?