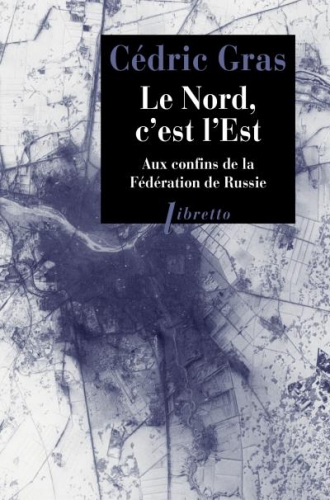A propos de ces attentats de Paris en janvier, et à présent de Copenhague, ma pensée refuse de se fixer. Je ne suis pas capable de dire quelle est exactement ma position, pas capable d’en affirmer clairement une à laquelle j’adhérerais pleinement, et finalement, je m’y refuse. Ce n’est pas faute de faire le tour, dans les médias et autres réseaux sociaux, de ce qu’il nous est proposé de penser, c’est-à-dire, désormais, de répéter. Liberté d’expression, islamisme, djihadisme, antisémitisme, République, terrorisme, amalgame, haine… Les mots tournent en boucle, les propositions apparemment raisonnables varient, se succèdent en désordre ; et je ne me fixe pas, je ne joue pas, je ne vois là qu’un immense jeu de bonneteau médiatique, au fond. Pourquoi devrais-je absolument, immédiatement, avoir une opinion ? Qui, au fond, s’en soucie ? Personne. Mais ça occupe, j’en conviens ; et ça m’occupe, d’ailleurs. Et pas moins que ceux qui savent exactement ce qu’ils pensent, et souvent aussi, ce que les autres devraient penser sous peine d’être de parfaits crétins, voire quelquefois, de pauvres criminels malgré eux. Pourtant, rien dans ces attentats, ne me laisse indifférent. Pourtant, après la colère, l’engueulade pour rien parfois, je retourne à mes petites affaires. Et là, tout de même, en regardant les choses écrites par moi, et représentées parfois depuis une petite dizaine d’années, je me dis que je ne pourrais plus du tout faire aujourd’hui ce que je faisais en 2007 ou en 2008. Que ça ne passerait pas ; entendons-nous : qu’on ne laisserait pas passer. Non pas au sens où ça ferait du bruit, où il y aurait débat, ou procès – puisque les débats ont quand même très souvent lieu entre gens d’accord sur l’essentiel et qui se chipotent puérilement des détails ; non, au sens où en amont la possibilité de faire représenter ces textes sur une scène est complètement obstruée. Et pourtant, ces choses dites, même affirmées, me semblent mesurées, responsables, avec ce qu’il faut d’humour et de violence mais composées, et en tout cas dénuées de toute volonté d’insulter qui que ce soit. C’étaient des fictions, voilà. Plusieurs points de vue plus ou moins cohérents y avaient place et, les personnages servent aussi à cela, tous subissaient un traitement réellement ironique. Peu importe. Cet état de la parole dans notre pays m’a conduit, au tournant de 2011 et 2012, à cesser la plupart de mes activités visibles – en tout cas pour ce qui concerne mon travail de dramaturge. A quoi bon perdre tant d’énergie, de temps ? J’ai continué d’écrire, et plus librement que jamais, puisque je n’avais plus à me poser la question de comment passer la censure, latente mais réelle, et à son abyssale imbécillité près nécessaire, du milieu culturel. En 2014, je me suis pris à écrire un discours ironique, violent, peut-être un poil pamphlétaire, intitulé HBL (je ne déchiffre pas, hein) ; en l’écrivant, il m’est apparu brutalement que c’était cela qu’il fallait dire de notre époque sur un plateau de théâtre, et simultanément, que c’est cela qu’on ne pourrait pas y mettre. J’ai commencé il y a deux semaines d’écrire des bribes d’un Ubu djihadiste ; je ne vous explique même pas que je ne pourrai rien en faire ici, en France. Oh, ça ne me dissuadera pas pour autant de l’écrire. Mais franchement, je me dis parfois que je ferais mieux d’aller à la pêche, ou, ce qui revient au même, d’écrire un gentil petit roman bien foutu avec des phrases bien courtes. Ou bien, tout simplement, de ne plus rien écrire, et simplement de lire. Et c’est ce que je me disais hier, après avoir fait un tour des différents médias à propos des attentats de Copenhague : – Va lire ! Et c’est ce que j’ai fait. Je lis en ce moment un livre très agréable, acheté un peu par hasard, une relation de voyage, qui s’appelle Le Nord, c’est l’Est (Aux confins de la Fédération de Russie) d’un auteur dont je ne sais rien, Cédric Gras, sinon qu’il est géographe de formation et aventurier de tempérament. A la page 107 où j’étais arrêté hier soir, l’auteur se dirigeant vers l’île de Sakhaline (c’est le titre du chapitre, en tout cas), ma lecture a repris par ce paragraphe :
« Voyager en Sibérie, c’est passer son temps dans les halls de gare où un immense tableau affiche les horaires sur deux colonnes : « vers l’ouest » et « vers l’est ». Un haut-parleur grésillant diffuse L’Adieu des Slaves pour donner un peu de solennité au départ du train pour Moscou. Je suis sur le perron voisin, attendant qu’on m’emporte dans la direction opposée. Mais cette musique qu’on donne dans toutes les stations de Russie pour les liaisons avec la capitale, je la connais par cœur : Nous t’aimons sans réserve terre sainte de Russie. Chaque fois, je me dis que c’est bien ainsi qu’il faut chérir. Nous sommes tous devenus des émetteurs de réserves, de circonspects spectateurs, des lâches de l’amour. Si la perfection n’existe pas, c’est que les qualités sont souvent incompatibles. La raison aura toujours des réserves. »