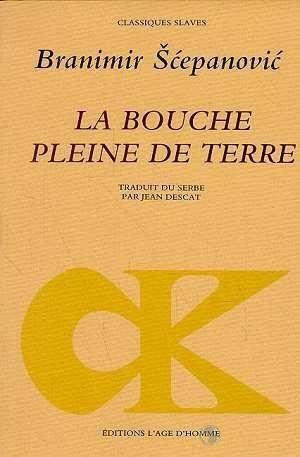
« Après un long silence quelqu’un dit : « Et si, par hasard, cet homme n’existait pas ? » Il y avait dans cette question inattendue et apparemment absurde, quelque chose d’effarant et de dangereux qui passait notre entendement. Et, tous, nous nous mîmes à invectiver ce fou, qui se figurait que pendant une journée entière il avait poursuivi une ombre ou un pressentiment. »
Quelques évocations qu’on y trouve de la vie moderne et de ses objets – trains, villes, travaux de chimie, fusils, tourisme… –, La Bouche pleine de terre est une fable antique, une histoire immémoriale dont on s’explique mal en vérité qu’elle n’ait pas été écrite il y a deux ou trois mille ans. La sûreté avec laquelle Šćepanović écrit cette traque à travers la plaine, puis la forêt, vers la montagne (montagne de l’enfance, non sans portée symbolique), paraît n’avoir aucun équivalent, comme si l’histoire, venue de temps très anciens, naissait pourtant d’elle-même, indifférente à la nasse de l’histoire littéraire, exception faite peut-être de quelque légende improbable, secrètement transmise de bouche à oreille, et se trouvant tout à coup, presque par miracle, écrite, et définitivement.
« Il voulait seulement s’épargner toutes les humiliations auxquelles il se serait autrement exposé, soit qu’il réclamât de la compassion, soit qu’il fût contraint d’en accepter. »
L’homme malade, condamné, usé, qui fait retour vers son pays natal pour y mourir, s’y tuer plus précisément, cherchant à éviter la main tendue, la compassion et même simplement le regard de ses contemporains, les fuyant pour ne pas leur céder, c’est-à-dire céder sur sa résolution de mourir, provoque leur ire, au point que deux campeurs paisibles, en vacance de quelque activité dont nous ne saurons rien, se mettent à le traquer, d’abord au prétexte sympathique d’éclaircir les raisons de sa fuite, puis bientôt, l’homme continuant de fuir, pour tout bonnement le tuer, rejoints bientôt par d’autres gens, sans autre raison que celle qu’ils s’imaginent ou s’inventent, de plus en plus nombreux.
Si l’histoire paraît à ce point évidente en sa complexité, à la fois sinueuse et profonde sans cesser d’être limpide, n’hésitant pas à faire peut-être aussi de la haine un des moyens apparents du salut, force est de reconnaître que l’alternance par paragraphes serrés de deux récits, qui ont d’abord l’air tout à fait indépendants avant de se faire face, cruellement dirais-je, rien ne semblant pouvoir jamais résorber même un peu la béance les séparant : le premier, en caractères romains, raconte les actes, pensées et sentiments des deux campeurs (et de leurs suiveurs bientôt) dont l’un – et c’est un point à mon avis crucial – est narrateur, quoique l’effet de groupe et d’entraînement y fasse depuis le départ prédominer la première personne du pluriel ; le second, en italiques, raconte à la troisième personne du singulier les actes, pensées et sentiments de l’homme fuyant le monde, qui avait décidé de mourir et qui fuyant les hommes, supposant qu’ils voudraient l’en dissuader, a déclenché leur colère, leur folie meurtrière, laquelle à son tour a réveillé en lui un besoin de vie formidable… force est de reconnaître, disais-je donc plus haut, que l’alternance de ces deux récits place son extrême modernité – mais c’est une modernité concise, dénuée de tout bavardage ou de toute exhibition d’elle-même, bref de toute son ordinaire esbroufe – au service simplement de cette question du salut (ou non) par la fuite, et peut-être même par la traque. L’acmé du livre, et le point d’ignition de l’hypothétique salut de l’homme traqué, tient dans cette scène extraordinaire précédant l’ultime course, où, après la traversée de la forêt, sur un plateau jauni, l’homme seul, à bout de forces, se retourne et fait face à la meute d’hommes le chassant, retournant en quelque sorte contre eux leur propre haine, et, leur faisant face, les arrête, comme sidérés :
« Il lui sembla alors que dans le spectacle qui, l’instant d’avant, lui avait brûlé les yeux, quelque chose avait changé, mais il ne parvint pas tout de suite à saisir ce que c’était. Ce n’est qu’au bout d’un moment qu’il s’aperçut que cette foule éreintée et suante se retirait lentement, reculait devant lui, comme si elle avait eu peur de le voir s’approcher de trop près. Il sourit à nouveau, surpris du tour inattendu et presque invraisemblable que prenaient les choses, et il pensa qu’en lui aussi un changement commençait à s’opérer, car dans le frisson agréable qui parcourait son corps, il percevait déjà une sensation forte et tout à fait nouvelle qui, au bruit assourdi de son pouls, étouffait tout ce qui, jusqu’à alors, avait existé en lui.
En fait, nous reculions devant sa haine presque inhumaine, qui, sans nous faire peur, nous rendait tout à fait incapable de nous opposer à lui de quelque façon que ce fût. »
Mais les choses et les sentiments, jusqu’à même la géographie, tout dans ce livre tremble, à la fois présent et absent, infiniment volatile, et rien n’est assuré : l’homme traqué est-il vraiment revenu vers la montagne de son enfance, la Prékornitsa, ce toit du monde pour lui, ou se le figure-t-il seulement ? Et sa propre résurrection même, ou ce qu’il vit comme telle – utilisant comme moteur de sa fuite l’histoire entendue dans l’enfance de son bisaïeul se relevant de son lit de mort, mangeant d’un coup le repas prévu pour les funérailles, brisant à la hache son cercueil, chassant tout le monde de sa maison, puis vivant de nombreuses années, non sans porter à chaque enterrement d’un de ses proches des sous-vêtements taillés dans son prétendu linceul – eût-elle seulement pu avoir lieu sans cette chasse à mort lancée pour presque rien, pour un salut – au sens le plus quotidien, cette fois – ou une banale conversation de trois fois rien qu’on refuse ? De sorte qu’il semble bien que ce que je nomme ici tremblement, faute de mieux sans doute, soit la manifestation dans ce livre de la réversibilité de tout ; il y a et il n’y a pas salut.
Il me paraît tout à fait possible, mais absolument pas souhaitable, de tenter plus avant une ébauche d’interprétation de ce qui est en question, réellement, dans ce livre qui, d’évidence, est aussi parabole ; cette rare maîtrise de l’artificialité fait de La Bouche pleine de terre un livre de haute poésie, non pas au sens seulement où il serait très bien écrit, mais au sens où un enseignement, même non formulable – ou plutôt, peut-être : à quoi bon tenter de le formuler, d’une manière qui serait fatalement réductrice, et tellement inférieure à celle par laquelle l’auteur l’a très exactement écrit ? –, peut et doit en être tiré.
La Bouche pleine de terre, de Branimir Šćepanović, L’Âge d’Homme, traduit du serbe par Jean Descat, 1975