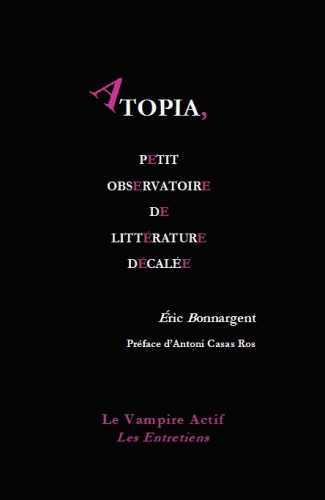
Promenade tragique autour d'Atopia (1)
Si vous enlevez le mensonge vital à un homme ordinaire, vous lui enlevez aussi le bonheur.
Relling, dans Le Canard sauvage d’Henrik Ibsen, cité par Dag Solstad dans Honte et dignité, cité par Eric Bonnargent dans Atopia, et par moi ici
Voici peut-être que se profile le nœud du problème que pose au fond la lecture de ce livre : si Atopia est en lui-même passionnant, pour ce qu’il dit que dit de la vie, ou de l’existence, la littérature, il l’est encore davantage par ce qu’il ne sait pas qu’il est, peut-être, ou ne veut pas savoir :
« Cet ouvrage se voulant lui-même décalé, j’ai aussi choisi de parler de livres que l’on n’a guère l’habitude de rencontrer dans des essais sur la littérature, soit parce que leurs auteurs sont peu ou mal connus du grand public, soit parce que, lorsque ces écrivains sont célèbres, il s’agit de textes oubliés ou si décalés qu’ils ont du mal à trouver une place bien définie dans leur corpus. »
Ce parti-pris, posé dans l’introduction I would prefer not to, est tout à fait tenu au long de l’ouvrage et ces œuvres pour la plupart inconnues au lecteur en sont si bien éclairées qu’elles lui paraissent bientôt familières, presque évidentes ; au point que cette réussite mérite d’être convenablement interrogée.
Il n’est pas anodin de faire une remarque ici quant aux genres littéraires : d’un côté, de façon assez convenue, les trente livres qu’a choisis Bonnargent pour représenter la modernité selon lui depuis les années 30 du vingtième siècle sont en très grande majorité des romans ou des récits – ce qui, dans une époque où les romans s’accroupissent aux étalages, est le lieu du moindre décalage ; de l’autre, la notion de genre semble relativement peu importante à l’auteur : que Le Roi se meurt de Ionesco soit une pièce de théâtre ne paraît pas influer une seconde sur la lecture – au demeurant intéressante, quoique paradoxalement un peu restreinte – qu’il en fait, au point qu’il ne trouve pas même utile d’en faire mention, ne reconnaissant donc à cette particularité dramatique dans son choix aucun autre caractère d’exception que celui d’être un prétendu « classique ». Il semblerait donc que la notion de littérature décalée rende ici obsolète les anciens (donc) genres littéraires, ce que semble également attester le « Cet ouvrage se voulant lui-même décalé […] » que nous venons de citer, laissant entendre que ce décalage enjamberait sans ambages ce qui relève de la fiction et ce qui n’en relève pas. Qu’Atopia puisse être en ce sens le trente et unième livre – pour ainsi dire invisible, extraordinairement décalé des trente qui constituent son objet – qu’Eric Bonnargent recommande discrètement au lecteur n’est pas tellement problématique ; c’est peut-être même, posée au seuil de l’ouvrage et tendant à passer inaperçue, une véritable clé de lecture contribuant, avec pour le fond ce léger surplomb philosophique constant et pour la forme ce classement thématique a priori superfétatoire, à ne pas faire de ce livre une simple suite de séquences, ou seulement en apparence.
La clarté, toujours concise, d’exposition de Bonnargent, son art délicat de la citation, placent en effet le lecteur dans une situation agréable : à la différence de tant d’ouvrages érudits ou simplement universitaires, aucune lecture préalable des œuvres abordées ne paraît requise ; et cette évidence à comprendre ce qui est en jeu dans chacun de ces ouvrages fait aussi qu’après coup, dans bien des cas, leur lecture effective ne manquera toujours pas. L’unité de cet ouvrage en récapitulant trente, presque les compilant – tant au sens moderne usuel qu’au sens des grands compils médiévaux –, classant par thèmes cette imitation du foisonnement de la vie qu’est la littérature, est telle qu’il se transforme en une manière plaisante de petit roman philosophique, léger et pertinent, finalement positif dans sa façon de traiter telle négativité existentielle dont la littérature serait le douloureux écho, et se suffisant tout à fait ; de sorte qu’en même temps qu’Atopia donne une idée des plus claires de ce qu’est la littérature moderne, « décalée » – c’est-à-dire, désormais, la littérature –, il semble dispenser le lecteur de s’y colleter vraiment, chose qui ne paraîtra négative qu’à qui fait de la littérature une idole.
Eric Bonnargent aurait en quelque sorte lu pour nous, et si bien, d’une façon si cohérente, et nous aurait restitué sa lecture dans une forme si claire, si évidente que, sauf à mettre en doute la totalité de ce qu’il dit, aucune nécessité ne se fait jour de quitter cet agrément pour se plonger tout à fait dans ces histoires aux affres terrifiantes ; nous scrutons certes l’atroce nuit littéraire, ou la noirceur de l’âme humaine, mais derrière une vitre épaisse nous protégeant, et comme avec des jumelles infrarouges qu’au surplus nous tiendrions à l’envers, maintenant ainsi pour la conscience les pires monstres existentiels dans une distanciation très rassurante et accréditant l’idée, fût-elle quelque peu fallacieuse, que toute cette théorie de dangers dont nous examinons confortablement les détails ne nous menace pas directement, là, tout de suite. C’est cette réussite-là, tout de même assez sidérante, justifiant diablement le terme a priori seulement décalé d’observatoire, qui nous semble mériter d’être questionnée.
D’un point de vue strictement littéraire, considérant Atopia comme un objet finalement capable de se suffire à lui-même et peut-être même pensé pour cela, le lecteur pourrait même regretter que les trente livres alignés là existent vraiment dans la réalité et ne soient pas l’invention quelque peu borgésienne de Bonnargent, mais le plaisir de la sensation d’accéder à ces livres sans avoir pourtant à les lire, lui fera plutôt regretter que l’ouvrage n’en contienne pas davantage (2)!
Le paradoxe de ce livre dispensant de lire les livres qu’il défend pourtant tient peut-être à cet effet de filtre – ou de philtre ! – par lequel le lecteur d’Atopia lit la lecture que fait Bonnargent de ses lectures. Exactement comme ayant traversé plusieurs œuvres nous parvient intacte, mais dégagée de son contexte dramatique initial et désormais seulement informative – l’information serait-elle philosophique –, la phrase d’Ibsen citée plus haut, le livre nous offre une agréable flânerie dans les régions dévastées de l’âme humaine et à aucun moment ne nous fait éprouver réellement ces noirceurs en question. Il serait sans doute pleinement légitime d’avancer ici que c’est justement par son côté critique que ce livre parvient à une telle distance observatrice, mais l’hypothèse semble ne pas pouvoir être retenue : Bonnargent traite ces trente livres, pour reprendre notre expression, pour ainsi dire sur un pied d’égalité, refusant toute hiérarchie non seulement entre eux-mêmes mais aussi, finalement, entre eux et les livres de la littérature de simple divertissement, et ne semble même émettre formellement aucun jugement assertif, étayé ou non, à leur égard.
Le problème n’est évidemment pas de trancher ce nœud d’un jugement moral plus ou moins hâtif, mais d’explorer comme faire se peut, sans doute à coups de maladroites improvisations, ce qui nous semble être l’extrême richesse, fût-elle en apparence aporétique, d’Atopia – et son côté Bonnargent contre Bonnargent.
A suivre...
(2) Et c’est peut-être ce qu’indique finalement l’étrange première phrase un peu ratée d’Antoni Casas-Ros ouvrant la préface, et donc le livre : « Ce Petit observatoire de littérature décalée n’est pas un recueil d’articles mais une longue coulée d’obsidienne sur laquelle flottent les pépites laissées par les spéléologues de l’âme humaine, les écrivains qui choisissent de naviguer dans l’obscur, sous des apparences rassurantes. » (Hors le titre, c’est nous qui soulignons cette bonnargentique « coulée d’obsidienne » qui d’abord nous avait parue déplacée, pour ne pas abuser de tel autre adjectif…, et ces décoratives « pépites » à quoi sont ramenées les œuvres étudiées. )