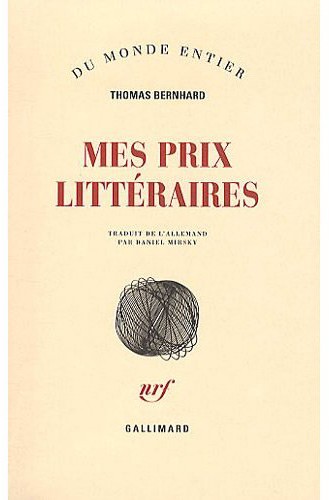(Article initialement publié sur RING)
« Si l’on songe à quel point, peu importent les circonstances, un seul poète ou écrivain est déjà ridicule et difficilement supportable à la communauté des hommes, on voit bien combien plus ridicule encore et intolérable encore est un troupeau entier d’écrivains et de poètes, sans compter ceux qui sont persuadés d’en être, entassés en un seul endroit ! »
Dès l’abord, à propos de choses si méprisables, la traduction en français du titre Meine Preise rend un son des plus plaisants, même affublée d’une épithète de circonstance : Mes prix littéraires.
La quatrième de couverture corrobore :
« Sous prétexte de parler de tous les prix littéraires qu’il a reçus, Thomas Bernhard se livre, dans ces textes inédits, à ce qu’il fait le mieux : exercer sa détestation ».
C’est hélas assez faux. En effet, c’est bien pire que ça.
Parce que c’est bien plus juste.
Bernhard ne nous la fait pas à la française (et sans doute pas non plus à l’autrichienne : il nous la fait à la Bernhard).
Il ne prend pas son opinion pour la vérité même et ne nous exhorte pas, sous peine de n’être qu’un parfait crétin, à répéter ses dires ; il ne prend pas les choses du dessus, comme s’il était lui-même le truchement nécessaire d’une quelconque révélation de toilettes publiques, et sa parole ne descend pas sur nous comme celle d’un prédicateur gallican de magazine télévisé pour pourfendre cette médiocrité avérée, à tous évidente, que sont les prix littéraires ; il ne nous la joue pas non plus, un peu plus finement, expert en la matière, spécialiste des milieux littéraires, dernière exception en date d’une lignée d’exceptions exceptionnelles, l’homme de l’intérieur averti et à qui, cela va sans dire, on ne la fait pas. Il ne développe aucune rhétorique ouvertement faux-cul, condamnant par exemple le système en général mais justifiant en particulier ceux que lui-même a reçus. Non, décidément, sa position n’est pas française, je veux dire qu’elle n’est pas celle d’un intellectuel – au sens où nous, ici, l’entendons. Et tant mieux.
Bernhard fait pire, entendez : beaucoup plus simple : il dit simplement ce qu’il faisait et comment il vivait quand on lui a remis son prix, ce qu’il pense a priori du prix et de son montant (car il ne les accepte que parce qu’il a besoin d’argent), ce qu’il compte faire de l’argent (et ce qu’il en fera effectivement, acheter une auto, une ruine en montagne), puis comment il s’y rend (flanqué en général de sa tante, qu’il aime beaucoup), ce qu’on lui dit, ce qu’il répond, ce que cela provoque – que ce soit un scandale ou rien du tout ; à mesure que les neuf prix se succèdent, et qu’il en comprend le fonctionnement idiot, devenant même occasionnellement juré de certains, Bernhard en vient à comprendre qu’il doit les refuser…
L’ensemble est très drôle.
Tellement drôle, même, que le livre écrit entre 1978 et 1980 et traitant des prix qu’il a reçus entre 1965 et 1970 (puisqu’il les a donc ensuite refusés) n’est sorti en Allemagne qu’en 2009 pour les vingt ans de sa mort.
Neuf brefs récits qui se lisent chacun comme une petite nouvelle, auxquels s’ajoutent en fin de volume les discours qu’il a effectivement prononcés.
Moitié parce qu’il est timide et n’ose se présenter à l’entrée du théâtre, moitié parce qu’une heure avant la cérémonie il s’est aperçu qu’il ne pouvait décemment se présenter à la remise du prix Grillparzer dans ses vieux habits élimés, Bernhard s’est acheté un costume ; du coup personne ne le reconnaît et il s’installe dans la salle avec le public, retardant ainsi le commencement de la cérémonie ; prix qui s’avère finalement n’être pas doté (et le costard est tout entier pour sa pomme !).
Ainsi commence en gros le bouquin, dans lequel la narration ne laisse au hasard aucun détail… Les anecdotes s’accumulent, et si chacune peut passer pour n’être justement qu’anecdote, l’ensemble tisse la toile d’une médiocrité terrible, écrasante, à laquelle, d’ailleurs, l’auteur ne prétend guère échapper, ne serait-ce que parce qu’il en participe.
Un autre prix, à Ratisbonne, doit être remis à monsieur Bernhard et madame Borchers (un poète) ; il est remis sans sourciller à madame Bernhard et monsieur Borchers ! Bernhard rassure alors sa co-lauréate :
« Je lui pressai la main pour la rassurer et lui dis de ne penser qu’au chèque, peu importe qu’ils évoquent monsieur Borchers et madame Bernhard ou monsieur Bernhard et madame Borchers, ce qui aurait pourtant mieux correspondu à la réalité. »
Maître-mot que celui de réalité, réalité-maîtresse que celle de l’argent. Il faut dire que ce prix-là lui était remis pour ainsi dire à titre pré-posthume, Bernhard « vivant » alors dans un mouroir hospitalier, à cet étage des maladies pulmonaires où en trois mois tous les patients ont claqué, sauf l’auteur (une sorte d’erreur de diagnostic !) et un jeune théologien catholique que Bernhard était parvenu à « convertir » au doute…
Les prix littéraires n’ont communément aucune importance.
Le seul intérêt de ceux qui les remettent est de se faire mousser de mondanités en mondanités et l’argent seul dont ils sont dotés parvient à motiver Bernhard à vaincre la profonde et croissante répugnance que ces prix lui inspirent. Parce que l’écrivain est vénal ? Du tout. Parce qu’il est dans la dèche, et plutôt sacrément. Fait qu’il ne vit d’ailleurs aucunement comme une injustice.
« Les poètes et les écrivains ne doivent pas être subventionnés, encore moins par une Académie elle-même subventionnée, ils doivent être livrés à eux-mêmes. »
On retrouve Bernhard après la publication de Gel, un de ses premiers romans, plaquant la littérature (« J’étais persuadé que l’erreur d’avoir placé tous mes espoirs dans la littérature allait m’étouffer. Je ne voulais plus entendre parler de littérature. Elle ne m’avait pas rendu heureux, mais jeté au fond de cette fosse fangeuse et suffocante d’où l’on ne peut plus s’échapper, pensais-je à l’époque ».) pour devenir livreur de bière, puis lassé de livrer la bière, partant à la campagne avec sa tante, non sans s’apercevoir au moment même du départ de la haine qu’il voue à la campagne ; ce qui le conduira, presque logiquement, à s’acheter une fermette isolée, délabrée, au plancher au travers duquel on peut à tout instant passer, avec les sous du prix de littérature de la ville hanséatique libre de Brême… Ferme qu’il retapera ensuite tout au long de sa vie…
Ce récit du prix de littérature de la ville hanséatique libre de Brême est un petit chef d’œuvre, dans lequel l’écrivain, pour faire bonne mesure, narre aussi la participation qu’il y eut, quelques années plus tard, en tant que juré. C’est formidable : Bernhard arrive avec, en tête, l’idée de défendre bec et ongles Elias Canetti et son Auto-da-fé, mais d’autres noms sont lancés et lorsque Bernhard mentionne en effet Canetti, il ne se voit répondre qu’un gêné : « Lui aussi est juif » évoquant manifestement Canetti, et que Bernhard ne comprend guère. Cependant, l’on palabre et aucun nom ne s’impose ; puis alors que le temps presse, le nom d’Hildesheimer sort comme par magie, auquel tout le monde – sauf Bernhard, qui a décidé de se taire – se rallie illico.
« Mais voilà que déjà ils transmettaient un communiqué à la presse, comme quoi le prix avait été attribué à Hildesheimer au bout de plus de deux heures de négociations. »
Bref, tout était décidé d’avance (et lui n’était pas au courant) et le prix fut remis à cet poète seulement parce qu’il était juif… Et Bernhard a encore passé pour un emmerdeur avec son Canetti, qu’il défendait pour sa littérature et non pour son appartenance au peuple juif.
Et tout cela va de mal en pis.
« L’Etat décerne un prix équivalent à un salaire minable, la fédération des industriels fait de même, et tous deux en profitent pour se présenter sous un jour favorable aux yeux du public, qui ne se rend même pas compte de la bassesse et de la perversité de la chose. »
Le petit prix d’Etat autrichien de littérature, émanant du ministère de la Culture, que Bernhard déteste, lui est remis. Comme ce prix n’est remis que sur candidature, Bernhard qui n’a bien sûr rien demandé doit se justifier de ce que son frère, sans son avis, l’a déposée pour lui, alors qu’il n’a plus l’âge de ce prix d’encouragement… Puis de ce qu’il tient tous les lauréats de ce prix pour de purs et simples trous du cul décorés par ce Sénat des Arts autrichien qu’il exècre réellement (pour le coup).
« Oui, répondais-je, au Sénat des Arts ne siègent que des trous du cul, à savoir des trous du cul catholiques et nationaux-socialistes, flanqués de quelques Juifs alibis. »
Bernhard s’oblige à se motiver, à ne penser qu’à l’argent.
Le scandale sera à l’arrivée. Le ministre de la culture manquera de lui casser la gueule en public, fera annuler la réception d’un autre prix la semaine suivante devant être également remis à Bernhard en sa présence…
« Un journal viennois dénommé Wiener Montag écrivit en première page que j’étais une punaise qu’il fallait exterminer. »
Et en plus, oui, il faut écrire des discours et remercier ces connards. Bernhard fait court, trop court ; et brutal – mais essentiellement parce qu’il n’a rien à dire ; extrait :
« Nous sommes autrichiens, nous sommes apathiques ; nous sommes la vie en tant que désintérêt généralisé pour la vie, nous sommes, dans le processus de la nature, la mégalomanie pour toute perspective d’avenir. »
Ou encore :
« […] le temps des contes est terminé, les contes des villes et les contes des Etats et tous les contes scientifiques ; celui des contes philosophiques aussi ; il n’y a plus de monde des esprits, l’univers lui-même n’est plus un conte ; l’Europe, la plus belle Europe, est morte ; voilà la vérité et la réalité. La réalité, tout comme la vérité, n’est pas un conte, et la vérité n’a jamais été un conte.
Il y a cinquante ans, l’Europe tout entière était encore un conte, le monde entier était un monde de contes. Aujourd’hui, il y en a beaucoup qui vivent dans ce monde de contes, mais ils vivent dans un monde mort et d’ailleurs il s’agit de morts. »
Il y aura tout de même deux prix qu’il sera plutôt content de recevoir. Le prix Julius-Campe, parce qu’il admire Julius Campe qui fut l’éditeur de Heinrich Heine – ce qui l’amène à comprendre que si personne ne sait qui est Julius Campe, personne (ou presque) ne sait non plus qui est Heinrich Heine. Et le prix de littérature de la Chambre fédérale de commerce, remis pour son roman La Cave, dans lequel il raconte son expérience, jeune homme fuyant le lycée, d’apprenti de commerce ; prix que les commerciaux lui remettent comme à l’un des leurs, sans considération littéraire, dans une ambiance détendue, bonne franquette, et pour finir, même, réellement émouvante.
Quant au prix Büchner – le dernier qui lui fut remis –, la raison de l’accepter (outre son admiration pour le poète) fut peut-être que sa réception coïncidait avec l’anniversaire de sa tante, fournissant ainsi l’occasion de lui offrir un beau voyage et un grand dîner ! Ce qui ne l’empêche pas de causer avec le grand scientifique Werner Heinsenberg, auquel on remet concomitamment un prix de prose scientifique (cela se passe bien avant Houellebecq, et pourtant) :
« Et c’est paradoxalement Heisenberg, le spécialiste en physique atomique, qui m’a demandé plusieurs fois pourquoi les écrivains voyaient tout d’un œil aussi noir, le monde n’était pas comme ça, après tout. Naturellement, je n’avais rien à répondre à cela. »
Thomas Bernhard est d’une humilité d’acier.