« A la guerre, l’homme change vite, et si, le premier jour, un mort peut l’effrayer, au bout d’une semaine il est capable de manger de la viande en daube confortablement accoudé sur une tête arrachée. »
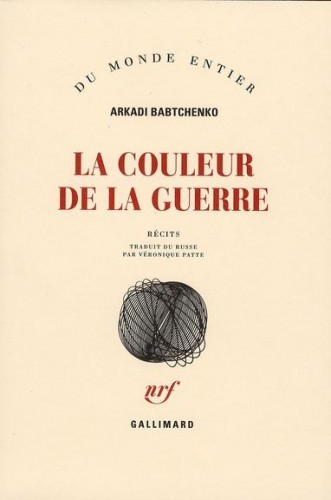
(Article initalement paru sur Ring : ICI)
Pas d’héroïsation, pas de victimisation, ni géopolitique ni misérabilisme, juste le pauvre troufion jeté dans une guerre à laquelle il ne comprend rien, sinon qu’il va être tellement difficile d’en sortir vivant qu’en sortir entier ou pas n’a aucune espèce d’importance. Et tout de suite, on y est. Dans le froid, la boue, la flotte, l’organisation merdique et la violence. Pas de lyrisme, pas de surplomb intellectuel ou métaphysique, juste le récit. Et nous suivons les pérégrinations du soldat Artiome aux environs de la petite ville d’Alkhan-Iourt où la bataille est engagée contre les « Tchèques », c’est-à-dire les Tchétchènes.
« Sous les roues défilait la Chaussée fédérale « Caucase », la fameuse voie dont il avait tant entendu parler au journal télévisé avant son service. Naguère, ce nom le fascinait. Pour lui il chantait, exprimait quelque chose d’immense, un peu comme l’Empereur de Toutes les Russies, non pas le tsar, mais l’Empereur ! Là, il ne s’agissait pas d’une route ordinaire, mais d’une Chaussée fédérale.
Or maintenant qu’il la parcourait, il n’y voyait rien de fédéral ni d’immense ; c’était une route fédérale à trois voies, banale, pas entretenue ni refaite depuis longtemps, percée de trous d’obus et encombrée de branches, pitoyable, comme tout en Tchétchénie. »
Extrait tiré de la page 17 où les soldats sont en route pour Alkhan-Iourt et qui sonne ici comme « l’art poétique » d’Arkadi Babtchenko. Pour l’instant, tout cela est très lisible, presque désagréablement agréable, mais ce principe littéraire consistant à ne jamais se détourner de la réalité va dans le cours du livre placer le lecteur dans des conditions assez éprouvantes, tempérées toutefois par le fait que lire ce qu’il lit est d’évidence beaucoup moins atroce, tout de même, que de le vivre. Contradiction motrice.
« Alkhan-Iourt » est le premier des treize récits composant La Couleur de la guerre. C’est aussi le titre original du recueil. Que je ne sais quelle volonté éditoriale et commerciale a ainsi poétisé en Couleur de la guerre, à rebours de tout le travail d’écriture de l’auteur. Guère plus littéraux, mais un peu plus fidèles à l’esprit général, les anglo-saxons ont traduit par One Soldier’s War.
La Couleur de la guerre, donc, est composé de deux parties. Chaque partie est composée d’un grand récit, « Alkhan-Iourt » inaugurant la première, le difficilement soutenable « Mozdok-7 » éclatant peu après le début de la seconde.
Babtchenko ne romance pas, il dit. Cela ne l’empêche absolument pas de savoir écrire et composer. Ainsi entrons-nous dans son livre directement au cœur de la guerre, au cœur de cette seconde campagne de Tchétchénie, tandis que la seconde partie aura trait à la première guerre. Au moins entrons-nous directement dans la guerre, dans les faits de guerre, en suivant Artiome et l’armée russe en loques, sans intendance digne de ce nom et ne songeant pas un instant à cacher à ces soldats qu’ils sont juste de la chair à canon, vers Alkhan-Iourt ; et donc sans nous douter que l’extrême violence de cette guerre nous sera beaucoup moins insupportable que les moments de paix relative, dans un camp en léger retrait du front, que le soldat Babtchenko nous fera vivre plus tard…
Les Russes aux environs d’Arkhan-Iourt sont aux prises avec des snipers « tchèques ». Artiome en repère un, dans une maison. Tous les soldats présents mitraillent la baraque, que l’on finit d’une roquette. Le lendemain, Artiome apprend que se trouvaient seulement dans cette maison un grand-père et sa petite fille.
« Si Artiome n’avait pas hurlé : « Il est là ! » le commandant de bataillon aurait donné l’ordre de mitrailler le bourg une minute plus tard, et la petite fille et son grand-père auraient eu le temps de se réfugier dans la cave.
La veille, il avait tué un enfant.
Artiome se sentit mal.
Mais il n’y avait rien à faire, il n’existait aucune issue, il ne pourrait demander pardon à personne. Il avait tué, point final, son crime était irréversible.
Désormais, toute sa vie, il resterait un assassin d’enfant. Et il vivrait avec ce boulet. Manger, boire, élever des enfants, se réjouir, rire, avoir de la peine, tomber malade, aimer. Et…
Embrasser Olga [sa fiancée à Moscou]. Effleurer cette créature pure, lumineuse, aérienne, de ces mains meurtrières. Toucher son visage, ses yeux, ses lèvres, ses seins si tendres et vulnérables. Et laisser sur sa peau transparente les empreintes de la mort, les traces sales, graisseuses de la mort. Des mains, des mains, des mains maudites ! Il faudrait les jeter. Les couper et les jeter au diable. Il n’existait désormais plus aucun moyen de se purifier. »
Il raconte à Oleg ce qu’il a fait, et celui-ci lui dit :
« Si tu te prends la tête chaque fois, tu vas devenir dingue. Ici on tue, c’est comme ça. Eux nous tuent, nous on les tue. Moi aussi j’ai tué. C’est la guerre, merde. »
Et aussi, à propos de la petite fille :
« Elle est morte, toi tu es vivant, mais tous deux vous pourrissez : elle sous la terre, toi au-dessus. Qui sait, peut-être un jour seulement vous sépare ? »
Artiome pense à se tuer, met le canon dans sa bouche. Mais non. Le lendemain, les soldats quittent la plaine.
« Mais cette plaine, jamais il ne pourrait l’oublier. C’est là qu’il avait perdu la vie, là que l’homme était mort en lui […]. Et c’est là qu’était né le soldat. Un bon soldat, vide, avec une tête creuse, des entrailles de glace et une haine pour le monde entier. Sans passé ni avenir. »
Nous sommes en gros à la fin du premier récit, au quart du livre, vers janvier 2000. Et nous commençons à comprendre que nous venons seulement d’arriver. Qu’Arkadi Babtchenko nous a jusque ici prodigieusement ménagé. Il y a plusieurs narrateurs, tous ne sont pas identifiés, dont l’auteur lui-même. Des moments pris selon des points de vue proches, mais différents. A Artiome considéré plus ou moins comme déserteur à l’issue d’une permission et qui reçoit comme sanction non de retourner au front mais de ramener les corps de ses camarades tués à leurs parents, correspond dans la seconde partie le jeune soldat Babtchenko dans la première guerre (1996), déchargeant les corps que les hélicos ramènent du front. A ces vieillards de vingt années après la guerre correspondent aussi ces puceaux ignorant presque tout de la vie avant de partir au front parce que leurs parents ne sont pas assez riches pour leur payer une dispense… A cette innocence des soldats débarquant souvent de provinces reculées de l’Empire correspond aussi ce profond cynisme des vétérans qu’ils seront quelques années plus tard :
« Nous sommes pires que des centenaires décrépits. Eux au moins ont peur de la mort, alors que nous, nous n’avons plus peur de rien. Nous sommes des vieillards, car être vieux, c’est vivre du passé, n’est-ce pas ? Or il ne nous reste que le passé. La guerre a été l’acte le plus important de notre existence, et nous l’avons accompli. La meilleure partie de notre existence, sa partie la plus lumineuse, a été la guerre. Il n’y aura désormais rien de meilleur. Et sa partie la plus noire, la plus sordide a aussi été la guerre. Il n’y aura rien de pire non plus. J’ai vécu ma vie. »
Car nous allons en croiser des soldats cassés, des mutilés, des rendus vides et à peu près inaptes à tout, des assoiffés de sang, des cinglés. Des officiers écroulés de rire en regardant comme sur un écran par la fenêtre monter leurs propres soldats à l’assaut et se faire laminer. Et tous eux-mêmes pris dans une armée désordonnée, monstrueuse, violente, où du haut jusqu’au bas de la hiérarchie la parole a disparu et où l’on ne s’exprime plus, au mieux, qu’à coups de pains dans la gueule, voire carrément de torture, et jusque dans les moments de paix relative, de calme, de cessez-le-feu. Nous allons en croiser des soldats qui, revenus à la vie civile, ne sont pas sortis du tout de cette guerre au point, assistant à une cérémonie dans un cimetière, de ne plus savoir s’ils sont chez eux ou là-bas, et si ce sont des croix ou des croissants qui ornent les tombes. Et à tel point que comme Arkadi Babtchenko lui-même, ces soldats de la première guerre de Tchétchénie qui ont vécu l’enfer, n’auront finalement d’autre choix que de se porter volontaires pour y retourner lors de la seconde guerre. Nous allons en croiser des mères russes venues de toutes les Russies rechercher leurs fils, dont elles sont sans nouvelles, jusqu’au cœur des combats, quitte à servir de cibles aux condisciples de ceux-ci dans tel ou tel bourg tchétchène en ruine, au risque de se faire enlever, violer, égorger, ou, au mieux, esclavagiser par les « barbus » tchétchènes… Oui, nous allons en croiser des gamins de dix-huit ans, n’ayant jamais connu l’amour et presque rien du reste, propulsés directement en enfer, c’est-à-dire, en premier lieu, dans l’armée russe. Des soldats à peine sortis des « classes » que personne n’entraînera, auxquels personne n’apprendra le maniement des armes avant de les envoyer se faire massacrer par les « Tchèques ». Des soldats affamés, aux plaies purulentes pas soignées, vendant leurs propres munitions aux « Tchèques » pour avoir de l’argent à donner à leurs supérieurs qui les rackettent chaque fois qu’ils reviennent du front, des soldats torturés pour avoir vendu des armes à l’ennemi, battus à mort, pendus par les pieds, affublés d’un gilet par balle et servant de cibles à des officiers bourrés à la vodka… Des soldats qui, revenus à la vie civile, seront capables de se reconnaître entre eux simplement à cause de leur regard. Des soldats qui, cantonnés en léger retrait du front, et déchargeant chaque jour les hélicoptères bourrés de soldats morts, estropiés, partis en fumée qu’on ramène et fout en tas, supplieront d’aller au combat plutôt que de rester là, à se faire battre, torturer ou violer. « La nuit, dérouillée sur dérouillée… Et le jour, on décharge les cadavres. » Des soldats qui, au front, en viennent à envier leur camarade à la mâchoire arrachée parce que lui, au moins, va pouvoir rentrer à la maison, même atrocement mutilé. Des « esprits », jeunes appelés, battus, estropiés, qui, devenus « quillards » (c’est-à-dire proches enfin de la quille) à leur tour, ne se comporteront pas différemment avec les nouveaux venus. Des bleus incapables de supporter la première journée et qui désertent, partent en pleine Tchétchénie sans presque aucun espoir de survivre aux « Tchèques », préférant finir égorgés par les barbus, ou mutilés par les « pièges à cons », ou esclaves. La dedovchtchina, que le terme potache de bizutage est incapable de traduire, est proprement invraisemblable. Les récits de la seconde partie sont à cet égard terrifiants. Le narrateur ici s’appelle Babtchenko.
Finalement, s’il arrive une chose terrible à ce livre terrible, c’est bien de nous avoir pour lecteurs, nous, occidentaux ; parce que cette plongée de quelques heures de lecture au cœur même de ces atroces campagnes de Tchétchénie, peut-être apparentée au plus sordide tourisme littéraire, ne peut que nous faire préférer notre léthargique hyperfestivisme par temps de crise, avec son fascinisme de pacotille et ses désirs à peine sortis de chambre froide ; et ne nous laissera pas entrevoir, peut-être, que lui aussi, avec ses idéologies délirantes d’utopies de tous poils et l’exacerbation volontaire de communautarismes plus ou moins culturels, pourrait bien également nous plonger quelque jour dans des affres dont on ne peut pas souhaiter qu’elles soient jamais comparables à celles que nous décrit si « bien » Arkadi Babtchenko.
« Pour nous, il n’existe pas d’autre châtiment que la mort, parce que tout le reste c’est la vie. »
Arkadi Babtchenko, La Couleur de la guerre, Gallimard (2009), Collection « Du monde entier », traduit du russe par Véronique Patte, 26 euros.